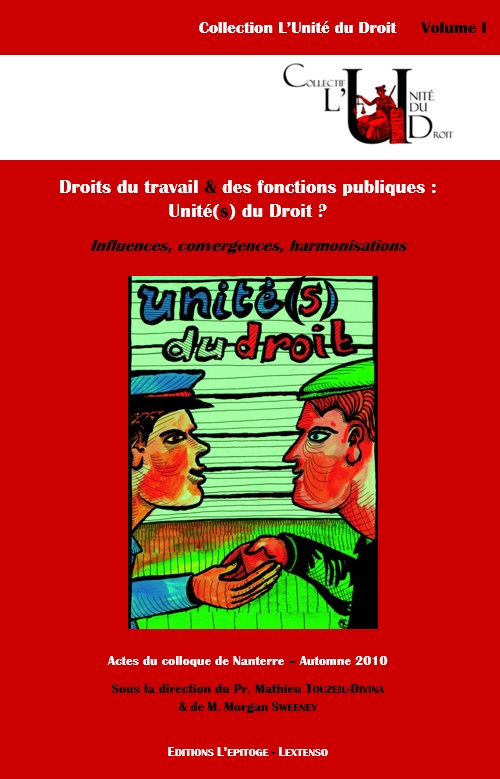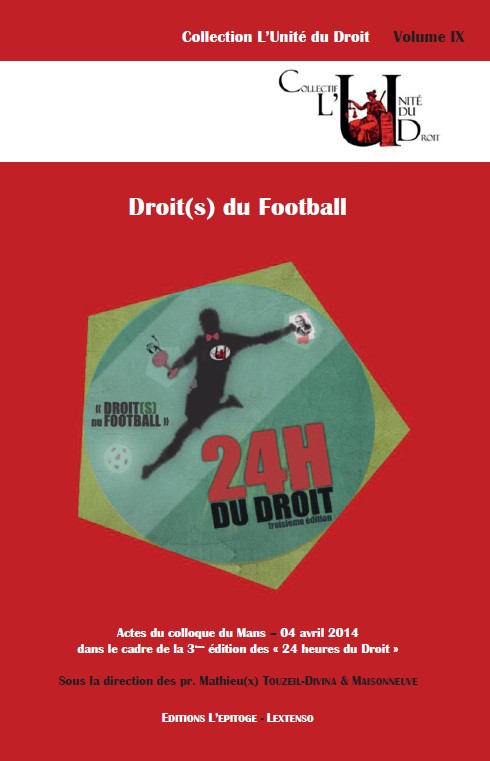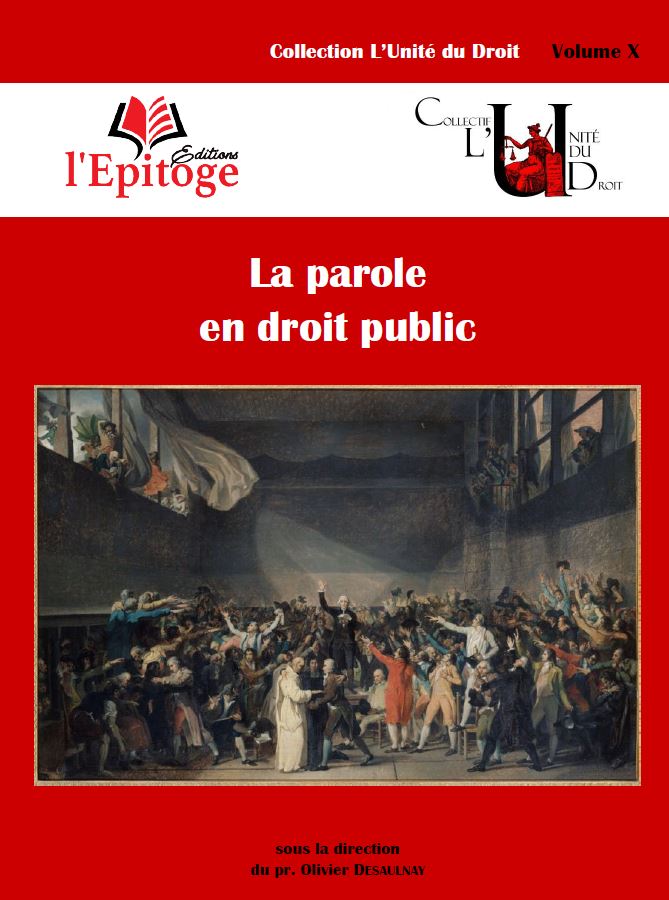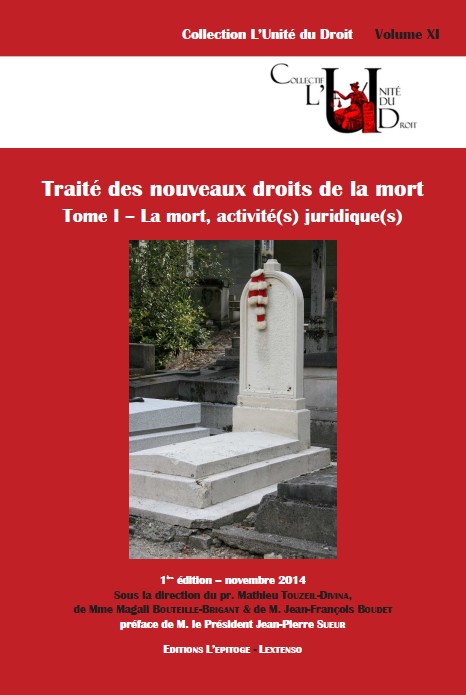Voici la 4e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 7e livre de nos Editions dans la collection L’Unité du Droit, publiée depuis 2012.
L’extrait choisi est celui de l’article du désormais docteur en droit public Antonin Gelblat à propos de l’opposition parlementaire dans les séries télévisées.

Volume VII :
Le Parlement aux écrans !
Ouvrage collectif
(Direction : Mathieu Touzeil-Divina)
– Sortie : automne 2013 / Prix : 39 €
- ISBN : 979-10-92684-01-8
- ISSN : 2259-8812

De l’opposition parlementaire
dans les séries télévisées
Antonin Gelblat
Ater de droit public à l’Université
Paris Ouest Nanterre La Défense, Credof,
Associé au laboratoire Themis-Um (ea 4333),
membre du Collectif L’Unité du Droit
« Il y a deux choses au monde dont il ne faut pas expliquer la fabrication :
les lois et les saucisses »[1] !
Ces propos du secrétaire général de la Maison-Blanche dans la série The West Wing semblent contredire l’ambition pédagogique de la série télévisée politique. Celle-ci est généralement considérée comme un genre moins noble que le cinéma mais elle n’en mérite pas moins une étude spécifique. D’abord parce qu’il s’agit d’un genre en pleine expansion (on en trouve aussi bien aux Etats-Unis qu’en Corée, en Israël ou en Australie) et que ces productions sont susceptibles de toucher un public plus large que le cinéma. Leur impact sur le spectateur (et le citoyen) est peut-être plus important. Elles prétendent ensuite, à la différence du film politique qui est le genre de l’exceptionnel et relate le plus souvent un évènement particulier, décrire la quotidienneté du travail politique et ses coulisses. Les séries politiques ont donc une prétention, fut-elle implicite, à révéler une certaine réalité du fonctionnement des institutions. Mais le traitement qu’elles réservent l’opposition peut aussi éclairer les représentations et les idéologies politiques que ces séries véhiculent. C’est ce dont cette étude cherchera à rendre compte.
Faute toutefois de pouvoir prétendre à l’exhaustivité, on s’en tiendra à comparer deux œuvres particulières, The West Wing[2] et Borgen[3]. Ce choix doit permettre de déterminer ce qui, dans la construction d’une représentation de l’opposition, relève du système institutionnel retenu et de la manière dont l’opposition s’y déploie d’une part, et ce qui relève de jugements de valeur, de prises de position sur ce que devrait être l’opposition, d’autre part. Toutefois, avant de justifier ce choix, il convient de lever un premier obstacle tenant à la définition de l’objet d’étude.
Il était fréquent, chez les constitutionnalistes français, de relever la pauvreté de la littérature juridique relative à l’opposition[4] et de l’expliquer par l’inconfort que suscite, pour la doctrine, une telle notion qui renverrait à « une réalité insaisissable quelque part entre droit et politique, entre le jeu des institutions et celui des rapports de forces »[5]. Dès lors, on peut constater que « définir l’opposition n’est pas chose facile»[6]. Difficulté accrue si l’on entend se doter d’une définition qui puisse rendre compte à la fois des systèmes américains et danois pris pour objet par les séries en question. Aucun de ces deux Etats ne traite, à la différence de la France depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, de l’opposition dans leurs textes constitutionnels. De surcroit, la définition courante, issue du modèle de Westminster, apparait inadaptée tant à la situation danoise qu’américaine. Pour la première, la difficulté vient du fait que, pour de nombreux auteurs, il ne peut y avoir d’opposition que minoritaire puisque le Gouvernement doit, en Angleterre tout du moins, bénéficier de la confiance explicite d’une majorité parlementaire. Or cette définition arithmétique échoue à rendre compte du régime parlementaire danois au sein duquel le gouvernement peut-être minoritaire. Dès lors, pour rechercher une définition de l’opposition applicable à ce système politique, on pourrait reprendre à notre compte les propositions du Professeur Jan : « L’opposition est autant une action qu’une institution, celle-ci précédant celle-là ; L’opposition […] consiste en une activité politique »[7]. Pour le professeur Pimentel, elle est « l’ensemble des groupes qui contestent le Gouvernement. Autant dire que l’opposition est un rôle, une fonction endossée par un groupe, mais non pas ce groupe lui-même » [8].Toutefois, ces définitions ne permettent pas de traiter de la seconde situation. Certains considèrent d’ailleurs qu’il n’existerait pas « de véritable opposition au sein du Congrès »[9], du fait de l’absence de discipline de vote en son sein[10] et de l’indépendance du Président. Pour les besoins de l’étude, on retiendra donc une conception ouverte de l’opposition qui renvoie à l’ensemble des parlementaires, quel que soit leur nombre et leur appartenance partisane, qui réprouve, ponctuellement ou systématiquement, l’action conduite par l’exécutif en usant des moyens politiques et juridiques que leur offre leur statut pour la contester.
Cette définition doit permettre de comparer les représentations de l’opposition produites par The West Wing et Borgen, deux séries politiques à succès, aussi bien populaire que critique[11]. On peut donc supposer que ce sont celles qui ont l’influence la plus grande sur le public, si tant est qu’elles puissent en avoir une. Ces fictions sont toutes deux focalisées sur l’Exécutif, le Président des Etats-Unis démocrate Josiah Bartlet et son staff d’une part, et le premier Ministre danois centriste Birgitte Nyborg de l’autre[12]. Cela ne constitue toutefois pas un obstacle à l’étude du traitement qu’elles réservent à l’opposition parlementaire. En effet, si le Parlement est rarement représenté directement, suggérant peut-être qu’il n’est pas le centre du pouvoir, l’opposition parlementaire est en revanche au cœur des préoccupations de l’Exécutif. Elle sera donc appréhendée à travers l’attitude que lui témoigne le gouvernement, ce qui permettra de s’intéresser plus particulièrement à la mise en scène des rapports de force politique. Ces deux séries dramatiques entretiennent en outre des liens complexes avec la réalité. Il s’agit bien évidemment de fictions, mais qui n’hésitent pas à entretenir une forme de dialogue avec l’actualité politique[13]. Il leur a même été prêté des capacités à anticiper, voire même à façonner le jeu politique. Ainsi, l’élection de Matt Santos, premier président hispanique des Etats-Unis dans la saison six de The West Wing, a été considérée comme la préfiguration de l’élection de Barack Obama (qui avait lui-même inspiré le personnage alors qu’il était encore sénateur de l’Illinois). De même la création de Borgen a précédé de peu, la nomination de Helle Thorning-Schmidt, première femme à diriger le gouvernement Danois. Il n’en fallait pas plus pour que ces séries se voient dotées d’une capacité d’influence politique, généralement considérée comme progressiste, sur son public. Il semble donc a priori que ces œuvres soient toutes deux empreintes d’un certain réalisme, mais aussi d’un certain activisme, qui justifient que l’on s’intéresse à la manière dont elles représentent l’opposition.
Ces deux séries présentent toutefois des différences notables, tant sur le fond que sur la forme, susceptibles de faire varier ces représentations. Sur la forme d’abord, elles n’adoptent pas tout à fait le même angle de vue, ce qui tient sans doute aux dix années qui les séparent. The West Wing emprunte à l’épopée et exalte la parole publique. Les personnages principaux n’ont quasiment pas de vie privée et apparaissent comme des surhommes très brillants intellectuellement (les femmes sont assez peu présentes et, pour la plupart, reléguées à des rôles secondaires, à l’exception notable de C.J. Cregg qui deviendra secrétaire générale de la Maison-Blanche). Borgen, au contraire, relève davantage de la tragédie et pose un regard plus critique et plus sombre sur la vie politique en s’attachant davantage aux affaires judiciaires et aux scandales médiatiques. La vie privée occupe une place plus importante et la difficulté à concilier les rôles de Premier ministre, de mère et d’épouse est au cœur du scénario. Sur le fond surtout, ces séries prennent pour objet deux systèmes politiques qui semblent, de prime abord, très différents : Les Etats-Unis d’une part, soit un Etat fédéral de trois cents quinze millions d’habitant mettant en œuvre un régime qualifié de présidentiel, bicaméral, et majoritaire; le Danemark de l’autre soit un Etat unitaire de cinq millions et demi d’habitants doté d’un régime qualifié de parlementaire, monocaméral et proportionnel.
Or il apparait pourtant que The West Wing et Borgen produisent une représentation relativement similaire de l’opposition. Elles offrent l’image d’oppositions parlementaires puissantes et respectées par un Exécutif soucieux de recueillir leurs consentements, ce qui revient à faire l’éloge d’une opposition constructive et à travers elle, d’un pouvoir exécutif garant du pluralisme (I). Mais lorsqu’un désaccord survient, l’opposition est surmontée et ne parvient jamais à reconquérir le pouvoir ; ce qui révèle la critique d’une opposition conflictuelle et, en filigrane, de l’institution parlementaire elle-même (II).
I. Eloge d’une opposition parlementaire constructive
L’opposition parlementaire est placée en situation de force politique (A). Elle met ainsi en valeur un pouvoir exécutif soucieux de respecter l’avis de son adversaire, conscient qu’il est des bienfaits du pluralisme des idées et des opinions (B).
A. La force politique des oppositions parlementaires au pouvoir Exécutif
Les oppositions parlementaires sont dans une position politique enviable. A la Maison-Blanche, le Président doit affronter une majorité hostile au Congrès (i), tandis que la coalition gouvernementale danoise est pour le moins fragile (ii).
i. Au Congrès : une majorité hostile
Si les élections constituent un moyen privilégié de représenter l’opposition, la place consacrée aux législatives est faible par rapport aux campagnes présidentielles qui, de la candidature à l’investiture occupent plusieurs saisons. Toujours est-il que dans The West Wing, ces élections tournent généralement en défaveur du camp démocrate auquel appartient le Président, qui verra face à lui, et pendant deux mandats, une majorité républicaine non seulement à la chambre des représentants mais aussi au Sénat. Un épisode relate notamment des midterms qui aboutissent à un statu quo parfait[14]. Un autre décrit les bénéfices politiques que la Maison-Blanche espère tirer de la lame duck session (période post-électorale au cours de laquelle le Congrès siège encore sans que les nouveaux élus ne soient entrés en fonction) mais un représentant démocrate désavoué dans les urnes refuse d’aller à l’encontre de la nouvelle volonté manifestée par ses électeurs en votant le projet défendu par la Maison-Blanche[15]. A cette majorité hostile s’ajoute, du fait de l’absence de discipline de vote, l’opposition ponctuelle de certains parlementaires démocrates. En témoigne la défection de cinq d’entre eux au soutien d’un projet de loi de lutte contre les armes, soutenu par l’Exécutif[16], qui doit en urgence identifier ces opposants de dernière minute et les convaincre de renoncer. Le Président se trouve donc en position de faiblesse face à l’opposition et doit continuellement composer avec elle pour mener à bien sa politique législative.
ii. Au Folketing : une coalition gouvernementale précaire
Dans la série Borgen, la création du cabinet Nyborg est extrêmement délicate. Le parti centriste a fortement progressé aux élections législatives et sa dirigeante a été nommée formatrice royale du Gouvernement. Mais le leader du parti travailliste, qui demeure le plus important de la coalition gouvernementale, revendique le poste de Premier ministre. Toutefois, la brusque chute politique de ce dernier et un « coup de bluff » de la centriste (qui laisse entendre à ses alliés qu’elle pourrait accepter une offre alléchante de l’autre camp et ainsi renverser la majorité) lui permettent de former un cabinet et de s’appuyer sur une majorité composite de 91 voix contre 88 à l’opposition[17]. La majorité gouvernementale est alors, dès l’origine, fragile tandis que l’opposition (constituée des libéraux, de la nouvelle droite et du parti de la liberté) se présente unie. La coalition ne résistera d’ailleurs pas longtemps puisque le retrait du parti de l’environnement conduit à un Gouvernement minoritaire. En vertu du parlementarisme négatif, le Gouvernement, même minoritaire, peut se maintenir tant qu’il ne dispose pas d’une majorité explicite à son encontre, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.[18]. Mais dès lors, l’opposition presse le cabinet Nyborg d’organiser des élections législatives anticipées puisque la conjoncture politique lui est favorable[19]. Le pouvoir exécutif ne bénéficie du soutien déclaré que d’une minorité de parlementaire et doit lui aussi, pour mener à bien son programme législatif, coopérer avec ses adversaires.
B. La prise en compte des oppositions parlementaires par le pouvoir exécutif
Le pouvoir exécutif, qui fait l’apologie du pluralisme et affiche son respect de l’opposition parlementaire, cherche en permanence à prendre en compte son avis. Les compromis, à travers The West Wing (i), et les consensus, à travers Borgen, sont exaltés (ii).
i. A la Maison-Blanche : l’art du compromis
La présidence loue le bipartisme et affiche son respect de l’opposition. Mais ce n’est pas la situation politique qui conduit l’exécutif à adopter une telle attitude, qui n’apparait pas contrainte mais semble plutôt traduire sa croyance sincère dans les vertus du pluralisme et la confiance qu’il place dans le système institutionnel américain[20]. Ainsi le Président peut-il affirmer : « Partisan politics is good. Partisan politics is what the founders had in mind. It guarantees that the minority opinion is heard, and as a lifelong possessor of minority opinions, I appreciate it »[21]. Son secrétaire général apparait même prêt perdre le pouvoir à condition que le débat public en sorte grandi : « We’re going to lose some of these battles. We might even lose the White House. But we’re not going to be threatened by issues. We’re going to put them front and center. We’re going to raise the level of public debate in this country. And let that be our legacy »[22]. La présidence recherche donc constamment le compromis, comme l’illustre la nomination d’un Vice-président démocrate, pourtant jugé médiocre, à partir d’une liste de candidats établie par le speaker républicain de la chambre, pour recueillir la nécessaire approbation du Sénat[23]. La Maison-Blanche va plus loin et tend à reproduire, en son sein même, le dialogue qu’elle mène avec l’opposition parlementaire. Deux exemples permettent de l’illustrer. Il s’agit d’abord de l’embauche d’une conseillère juridique et même d’un secrétaire général adjoint républicains qui intègrent le staff présidentiel, et contribuent à ses débats[24]. Il s’agit ensuite du remplacement du Président par le principal leader de l’opposition. Suite à l’enlèvement de sa fille, le Président, conscient de son manque d’objectivité, invoque le XXVe amendement pour être temporairement suppléer par son Vice-président. Mais celui-ci ayant démissionné du fait d’un scandale sexuel sans avoir été déjà remplacé, c’est finalement au Président de la chambre, un républicain ultra-conservateur, que le Président démocrate transmet ses pouvoirs, au nom de l’intérêt général et au risque de renforcer l’opposition[25].
ii. A Christiansborg : l’importance du consensus
Dans Borgen, le Premier ministre danois affiche également son respect de l’opposition et exalte le consensus sans que, là encore, cette attitude semble uniquement dictée par la situation politique délicate qu’il affronte, mais aussi par une réelle conviction des bienfaits d’une telle démarche[26]. Ainsi, lors du discours d’ouverture de la session parlementaire, et suite à un remaniement ministériel, le Premier ministre célèbre l’unité du peuple danois et de sa classe politique obtenant les félicitations, officieuses, de l’opposition[27]. La priorité du cabinet Nyborg est d’ailleurs un ensemble législatif baptisé « avenir commun », auquel il souhaite associer l’opposition, pour obtenir une approbation parlementaire la plus large possible[28]. Cette volonté de consensus se retrouve également au sein du Gouvernement qui reflète les rapports de force au Parlement. Ainsi, dépendante du soutien du parti travailliste qui progresse dans les sondages, le Premier ministre est obligé de se séparer de son ministre des finances centriste pour céder le poste à un travailliste dont le parti menace, dans le cas contraire, de quitter la majorité[29]. Le consensus demeure donc une nécessité absolue pour la coalition gouvernementale si elle souhaite conserver le pouvoir face à la puissance de l’opposition, comme en témoigne l’apaisement des tensions entre travaillistes et écologistes au sujet de l’opportunité du retrait des troupes d’Afghanistan[30].
L’opposition est valorisée lorsqu’elle collabore avec le Pouvoir Exécutif et accepte la démarche constructive initiée par ce dernier qui a en face de lui un adversaire puissant et qu’il respecte. En conséquence, il recherche toujours une solution constructive et pacifique à leurs désaccords. Mais lorsque l’opposition refuse une telle solution, elle est inévitablement conduite à la défaite.
II. Critique d’une opposition parlementaire conflictuelle
Dans les deux séries, les conflits qui s’élèvent entre le Pouvoir exécutif et l’opposition naissent toujours de la volonté de cette dernière de faire prévaloir ses intérêts particuliers quand l’exécutif n’a de cesse de défendre l’intérêt général, révélant ainsi l’infériorité morale des parlementaires de l’opposition (A).Mais, fort heureusement, le sens tactique et politique de l’Exécutif lui permet toujours de faire triompher ses vues dans une arène parlementaire représentant la « politique politicienne » (B).
A. L’infériorité morale des parlementaires de l’opposition
Les parlementaires de l’opposition symbolisent les intérêts particuliers face à l’intérêt général incarné par l’Exécutif. Cette faiblesse morale de l’opposition prend la forme du clientélisme à la Maison-Blanche (i), et du carriérisme dans Borgen (ii).
i. Au Congrès : le clientélisme
Dans la série américaine, ce phénomène se manifeste par le lobbysme auquel cèdent les parlementaires de l’opposition prêts à sacrifier la défense de leurs convictions contre l’assurance d’une réélection. On peut ainsi voir des représentants démocrates s’opposer à une réforme des droits de succession initiée par la Maison-Blanche car « la 1ère génération de millionnaires noirs va bientôt mourir »[31]. D’autres, convaincus par un groupe d’intérêt féministe, refusent d’entériner le compromis trouvé avec les républicains qui acceptent de voter une loi de protection sociale en échange d’un amendement en faveur du mariage[32]. Ces évènements sont toujours dépeints négativement, comme autant d’entraves à la réalisation du projet présidentiel. Mais cette vision dépréciative ne se retrouve pas quand la Maison-Blanche agit elle-même comme un lobby vis-à-vis du Congrès[33]. D’ailleurs, elle peut tout à la fois initier officieusement un « non controversial bill » portant une réforme d’ampleur du système de retraites et renoncer à en tirer les bénéfices politico-médiatiques, démontrant ainsi la supériorité morale du Président sur le Congrès[34]. Les parlementaires sont prêts à toutes les manœuvres pour se maintenir dans leurs fonctions, contrairement à la Maison-Blanche qui ne manifeste pas un tel électoralisme. En refusant d’installer dans son Etat un lanceur de missile qui ne fonctionne pas, la Maison-Blanche fournit à un sénateur le prétexte attendu pour quitter le parti démocrate et rejoindre les Républicains. Il augmente ainsi ses chances de réélection et ruine celles des démocrates de reconquérir la majorité[35]. Un représentant accepte quant à lui de ne pas surmonter un véto présidentiel, à condition que l’Aile-ouest ne s’oppose pas à sa réélection[36]. Alors que le Président tente de mettre en œuvre son grand dessein pour le pays, les parlementaires se préoccupent avant tout de satisfaire leur électorat[37].
ii. Au Folketing : le carrièrisme
L’opposition permet à Borgen de mettre en scène l’autarcie d’une classe politique et de dénoncer les profits personnels que retirent de leur position des politiciens rongés par l’ambition. Peu avant les élections, tandis qu’il vient d’uriner dans la cour du Parlement, le leader du parti travailliste, alors dans l’opposition, peut affirmer au « spin doctor » de la leader centriste : « Le peuple décide que dalle, c’est un petit cercle de privilégiés qui décide de ce qui se passe au Danemark […] et aussi longtemps que je serai dans ce cercle, ils peuvent appeler ça démocratie ou comme bon leur semble ». Ce petit cercle fait d’ailleurs figure de véritable panier de crabes. Dans le même épisode, le Premier ministre libéral utilise malencontreusement, et dans la hâte, la carte bancaire du ministère pour régler les achats de sa femme, visiblement dépressive, et éviter ainsi le scandale. Mais la facture parvient au leader de l’opposition qui n’hésite pas à l’utiliser lors d’un débat télévisé pour discréditer son adversaire. Dans leur grande sagesse, les électeurs condamneront de telles pratiques, et renverront dos à dos les deux hommes, pour porter au pouvoir la centriste[38]. L’ambition des premiers ministrables est également illustrée à maintes reprises. Dans la minorité d’abord, l’ancien Premier ministre cherche à retrouver sa place en feignant un accord avec son successeur quant au retrait des troupes danoises d’Afghanistan[39]. Au sein même de la coalition gouvernementale ensuite, où se manifeste une opposition interne au Cabinet. Ainsi, le nouveau leader du parti travailliste peut-il faire entorse à la solidarité gouvernementale, désobéir au Premier ministre, et finalement lui avouer qu’il souhaite le remplacer dès à présent[40].
Les parlementaires qui refusent le dialogue et s’opposent à l’Exécutif sont donc toujours placés dans une situation d’infériorité morale vis-à-vis de ce dernier, justifiant le recours à des armes politiques plus lourdes pour surmonter ces oppositions.
B. L’infériorité tactique des oppositions parlementaires
Lorsque l’opposition tombe dans ces travers, elle est sanctionnée par le pouvoir exécutif qui triomphe de son ennemi, pourtant plus puissant et moins respectueux de la morale, grâce à son instinct politique et son talent tactique. La Maison-Blanche, surmonte les coups bas grâce à sa connaissance des rouages de la procédure parlementaire (i) tandis que dans Borgen, c’est la maitrise du temps parlementaire et politique qui constitue le moyen privilégié face à l’opposition (ii).
i. A la Maison Blanche : la maitrise de la procédure parlementaire
L’intelligence tactique du staff présidentiel lui permet de sortir vainqueur des conflits qu’il entretient avec l’opposition. Il n’hésite pas à recourir à la ruse en exhumant une loi sur le patrimoine qui permet au Président de créer un parc national, et ainsi faire obstacle à un amendement visant à autoriser des exploitations minières[41]. Il recourt au même moyen sur le terrain de la procédure parlementaire. Le Président républicain de la chambre ayant constaté que son camp était minoritaire pour un vote sur les cellules souches, il le reporte en espérant que les représentants démocrates rentreront dans leurs circonscriptions en cette période de campagne électorale. Mais ceux-ci vont feindre de quitter Washington et, avec la complicité de la Maison-Blanche, se cacher dans le bureau du Vice-Président au Congrès pour réapparaitre à l’annonce du scrutin[42]. Cet épisode a d’ailleurs trouvé un écho dans la réalité, inspirant une manœuvre à l’opposition britannique. En mai 2006, Le Premier ministre Blair dépose un projet de loi visant à criminaliser l’incitation à la haine religieuse. L’opposition y voit une atteinte à la liberté d’expression. S’inspirant de l’épisode, les conservateurs parviennent à faire rejeter ce texte, la manœuvre restera comme « The West Wing Plot »[43]. L’Aile ouest peut aussi recourir à l’obstruction si nécessaire. Le staff présidentiel souffle alors aux représentants démocrates des moyens pour gagner du temps afin de rallier des parlementaires à sa cause et éviter que le véto présidentiel ne soit surmonté (sortir une banderole dans l’assemblée, demander le vote du calendrier qui oblige la chambre à approuver les travaux de la veille, déposer massivement des amendements…)[44]. Il peut aussi aider un sénateur dans son entreprise de filibustering, en trouvant une astuce réglementaire pour lui permettre de se reposer[45].
ii. A Christiansborg : la maitrise du temps parlementaire
Le Premier ministre danois parvient, par son sens politique, à influencer le Parlement, l’opinion, et en conséquence à contrecarrer l’opposition. Elle use, au moment le plus opportun, des divers outils à sa disposition. Ainsi lorsque l’opposition suggère au Parlement d’adopter une proposition de résolution visant à obliger le Gouvernement minoritaire à légiférer pour abaisser la majorité pénale à 12 ans. Le Premier ministre parvient à y faire échec en proposant la création d’une commission parlementaire paritaire (composé d’experts et de représentants des différents partis) pour réfléchir à cette question. La création de cette commission « Théodule » sera finalement adoptée à une voix de majorité[46]. L’opportunité de procéder à la dissolution du Folketing témoigne également de la maitrise exécutive du temps parlementaire. Alors que le Premier ministre a longtemps résisté aux injonctions de l’opposition qui le presse d’organiser des élections anticipées, il y consent, mais au moment le plus opportun, après le vote du dernier volet de son ensemble législatif « avenir commun ». Il coupe alors l’herbe sous le pied de l’opposition qui reconnait l’habileté de la démarche au sein même de l’hémicycle[47]. Les manœuvres de l’opposition sont donc anticipées et déjouées, ce qui permet au Premier ministre de se maintenir au Pouvoir, ou de se présenter devant les électeurs dans une situation favorable.
Finalement, les représentations de l’opposition
développées dans ces deux œuvres sont assez similaires, sans que l’on puisse
véritablement déterminer ce qui relève des régimes représentés et ce qui relève
des contraintes de production pesant sur ces séries. Si elles prétendent
dévoiler une réalité complexe, elles ne peuvent toutefois s’affranchir d’une
forme de simplification préjudiciable au Parlement. La préférence pour une
opposition consensuelle, qui s’explique sans doute par la nécessité de réunir
le plus grand nombre possible de téléspectateurs par-delà leurs préférences
politiques particulières, si elle semble à priori louable, peut finalement
s’avérer préjudiciable. Elle conduit en effet à présenter la décision politique
idéale comme relevant des juristes et communicants de l’équipe exécutive, au
terme d’un processus rapide et respectueux des minorités plutôt que le produit
d’une délibération parlementaire longue, obscure, et rendue responsable de la
fracture entre gouvernants et gouvernés. Le traitement réservé à l’opposition par
ces séries politique dévoile alors des relents d’antiparlementarisme.
[1] D’après le secrétaire général fictif de la Maison-Blanche, Leo MacGarry : The West Wing (désormais : TWW) / Saison 1, Episode 4 (désormais : S1E4) : Cinq voix de moins (Five votes down).
[2] The West Wing (A la Maison-Blanche), créée par Aaron Sorkin, compte 155 épisodes et fut diffusé entre 1999 et 2006 aux Etats-Unis. L’aile ouest de la Maison-Blanche, qui donne son nom à la série, abrite l’équipe présidentielle.
[3] Borgen est une série danoise produite par Adam Price et diffusée depuis 2010 sur DR1. Elle compte 20 épisodes avant la troisième saison. Borgen qui signifie « Le château » est le surnom donné au Palais de Christiansborg qui abrite les institutions politiques danoises.
[4] Voir par exemple : Jan Pascal,« Les oppositions » in Pouvoirs, L’opposition, n°108, Janvier 2004, p. 26 : « La contribution des lectures produites par la doctrine juridique est décevante »; ou encore Ponthoreau Marie-Claire, « L’opposition comme garantie constitutionnelle » in Rdp n°4, 2002, p. 1128 : « L’opposition a été mise de côté par la doctrine constitutionnelle française car elle a repris à son compte l’objectif que s’étaient fixé les constituants de 1958 : La stabilité institutionnelle ».
[5] Pimentel Carlos-Miguel, « L’opposition ou le procès symbolique du pouvoir » in Pouvoirs, L’opposition, n°108, Janvier 2004, p. 45.
[6] Jan Pascal, « Les oppositions », op. cit., p. 24.
[7] Ibid.
[8] Pimentel Carlos-Miguel, « L’opposition ou le procès symbolique du pouvoir », op. cit., p. 48-49.
[9] Gilles William, « L’opposition parlementaire : étude de droit comparé » in Rdp, 2006, n°5, p. 1347-1386.
[10] Cette idée doit toutefois être relativisée. Le Congrès connait en effet depuis plusieurs années, un fort mouvement de polarisation partisane. Voir Maugin-Helgeson Murielle, « L’adoption de la loi relative à la réforme de la santé par le Congrès américain. Décryptage d’une bataille politique et procédurale » in RFDC n°91, 2012/3, p. 641-662.
[11] The West Wing réunissait entre 10 et 20 millions de téléspectateurs et a reçu un nombre impressionnant d’Emmy Awards et de Golden globe. Borgen, quant à elle, réunit plus d‘un million de téléspectateurs par semaine dans un pays qui compte 5,5 millions d’habitants et a déjà reçu de nombreuses distinctions.
[12] Le titre officiel est « Statsminister » ou Ministre d’Etat du Danemark.
[13] Martin Fitzwalter, attaché de presse du Président Reagan, et Dee Dee Myers, porte-parole de l’Administration Clinton furent consultants pour The West Wing. Cette dernière a d’ailleurs inspiré le personnage de C.J. Cregg.
[14] TWW / S2E3 : Le Candidat idéal (The Midterms).
[15] TWW / S2E6 : Le Congrès des sortants (The Lame Duck Congress). Cet épisode rappelle d’ailleurs une lame duck session de 2003 au cours de laquelle les démocrates, prenant acte de leur défaite promettaient de coopérer avec la majorité républicaine avant même le renouvellement officiel du Congrès. Voir Lauvaux Phillipe, Les grandes démocraties contemporaines, Paris, Puf, coll. Droit fondamental, 3ème édition, 2004, p. 357.
[16] TWW / S1E4 : Cinq voix de moins (Five votes down).
[17] Borgen (B) / S1E2 : Minimum 90 (Tæl til 90).
[18] Le Gouvernement n’a pas à être investi et n’a pas à s’appuyer sur une majorité explicite à l’Assemblée. Il peut se maintenir à condition de ne pas faire l’objet d’un vote de défiance. Voir : Waele Jean-Michel (de), Magnette Paul, Les démocraties européennes : Approche comparée des systèmes politiques nationaux, Paris, Armand Colin, 2008, p. 103 et s. Voir également, pour les différentes acceptions que peut recouvrir la notion de « parlementarisme négatif » : Le Divellec Armel, « Le parlementarisme négatif à la française » in Jus politicum n°6, 2011, p. 20. L’auteur considère d’ailleurs que le système danois ne s’identifie que partiellement au parlementarisme négatif.
[19] B / S2E5 : Plante un arbre (Plant et træ).
[20] Sur la question spécifique de la parole politique dans The West Wing, voir : Girard Charles, « « The World can move or not by changing some words » : La parole politique en fiction dans The WestWing » in Revue de recherches en civilisation américaine [en ligne], La culture populaire américaine, n°2, 2010, mis en ligne le 03 mai 2010, Disponible sur : http://rrca.revues.org/index310.html [consulté le 19 mars 2013].
[21] TWW / S4E6 : Les jeux sont faits ! (Game on).
[22] TWW / S1E20 : Minimum obligatoire (Mandatory minimum).
[23] TWW / S5E3 : Jefferson est vivant (Jefferson lives). Cette pratique rappelle le patronage par lequel le Président « s’engage à nommer à des postes vacants les candidats recommandés par certains membres du Congrès ». Lauvaux Philipe, Les grandes démocraties contemporaines, op. cit. ; p. 374.
[24] TWW / S2E4 : Une républicaine chez les démocrates (in this White House) et TWW / S6E16 : Sécheresse (Drought conditions).
[25] TWW / S4E23 : Le 25ème amendement (Twenty-five).
[26] D’ailleurs, le site internet officiel du Danemark considère que son système institutionnel se caractérise par « la recherche d’un consensus par-delà toutes les divergences politiques » et insiste sur la « culture du consensus ».Disponible sur : http://denmark.dk/fr/societe/gouvernement-systeme-politique [Consulté le 19 mars 2013].
[27] B / S1E10 : Premier mardi d’octobre (Første tirsdag i oktober). Le Premier Mardi d’octobre est le jour d’ouverture de la session parlementaire et débute traditionnellement par un discours du Premier ministre sur la situation générale du Danemark et les plans du Gouvernement pour l’année à venir.
[28] B / S2E3 : Le dernier prolétaire (Den sidste arbejder).
[29] B / S1E10 : Premier mardi d’octobre (Første tirsdag i oktober).
[30] B / S2E1 : 89 000 enfants (89.000 børn).
[31] TWW / S3E4 : Influences (Ways and means).
[32] TWW / S3E22 : Assassinat politique (Posse Comitatus).
[33] Voir : Lauvaux Philipe, Les grandes démocraties…, op. cit., p. 372-373 : « On dit du lobby présidentiel qu’il est le plus puissant de ceux qui existent à Washington ».
[34] TWW / S5E12 : Un jour sans (Slow News Day).
[35] TWW / S5E5 : Le poids lourd du Président (Constituency of one).
[36] TWW / S3E5 : L’immunité (On the day before).
[37] Voir : Meny Yves, Politique comparée, Montchrestien, coll. Domat politique, 8ème éd., 2009, p. 239-241. L’auteur indique que le Congressman efficace est celui qui « brings home the bacon » et agit pour sa propre circonscription.
[38] B / S1E1 : La dignité du centre (Dyden i midten).
[39] B / S2E1 : 89 000 enfants (89.000 børn).
[40] B / S2E4 : En ordre de bataille (Op til kamp).
[41] TWW / S1E7 : Un diner officiel (The state dinner).
[42] TWW / S6E17 : Une bonne journée (A good day).
[43] « Blair’s whips fooled by West Wing plot », Daily Telegraph, [en ligne], 2 février 2006, Disponible sur :
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1509435/Blairs-whips-fooled-by-West-Wing-plot.html. On ignore en revanche si cet épisode a inspiré « le coup du rideau » des députés socialistes français lors du vote de la loi sur Hadopi.
[44] TWW / S3E5 : L’immunité (On the day before).
[45] TWW / S2E17 : Obstruction parlementaire (The Stackhouse filibuster). Lauvaux Philipe, Les grandes démocraties contemporaines, Paris, Puf, coll. Droit fondamental, 3ème édition, 2004, p. 298 : « La technique dite du filibustering permet d’empécher la mise aux voix d’un projet de loi ou le vote de crédits aussi longtemps qu’un sénateur exerce son droit à la parole. Cette pratique, lorsqu’elle est organisée par une équipe de sénateurs, peut retarder un vote très longtemps et permet ainsi d’obtenir le retrait d’un projet ».
[46] B / S2E6 : Eux et nous (Dem & Os). Les propositions de résolutions émanent le plus souvent de l’opposition et visent à forcer le Gouvernement à prendre en considération une question et à prendre des mesures pour la traiter. Elles ne font l’objet que de deux lectures au Folketing au lieu de trois pour les propositions de loi.
[47] B / S2E10 : Une communication de nature particulière (En bemærkning af særlig karakter).
Nota Bene : le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso. Vous pouvez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).