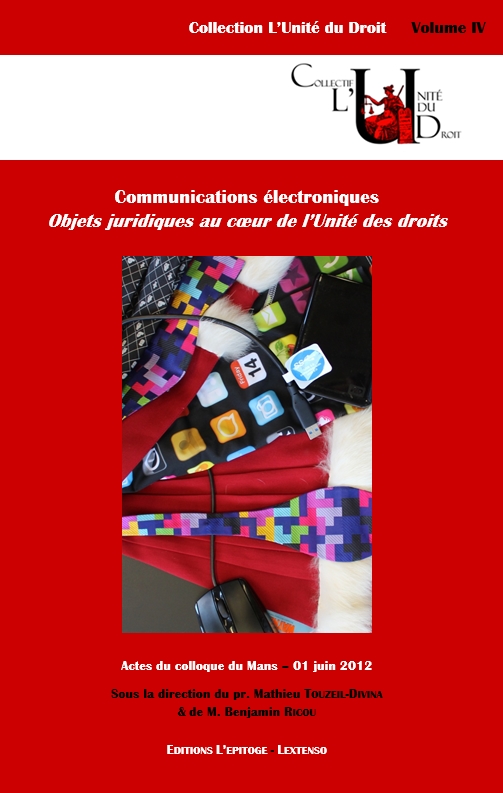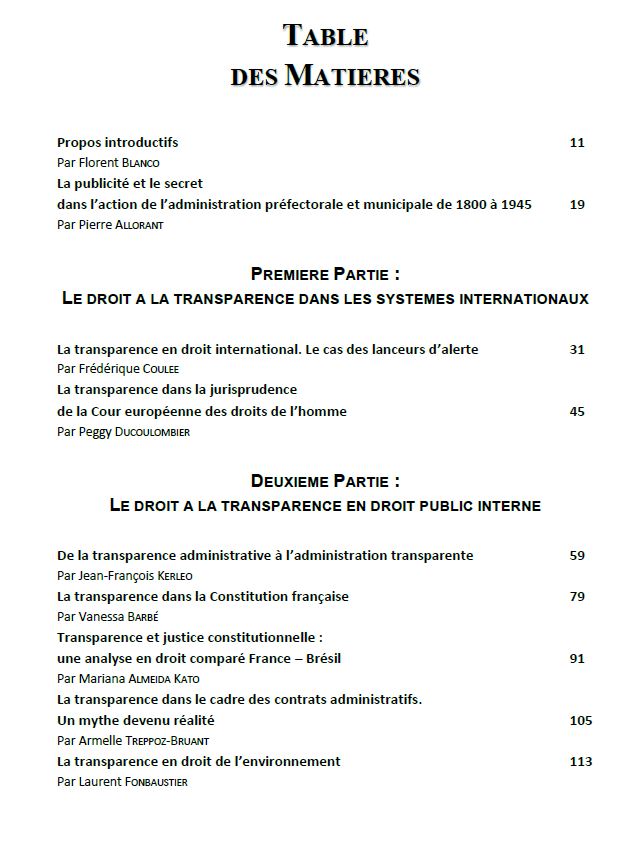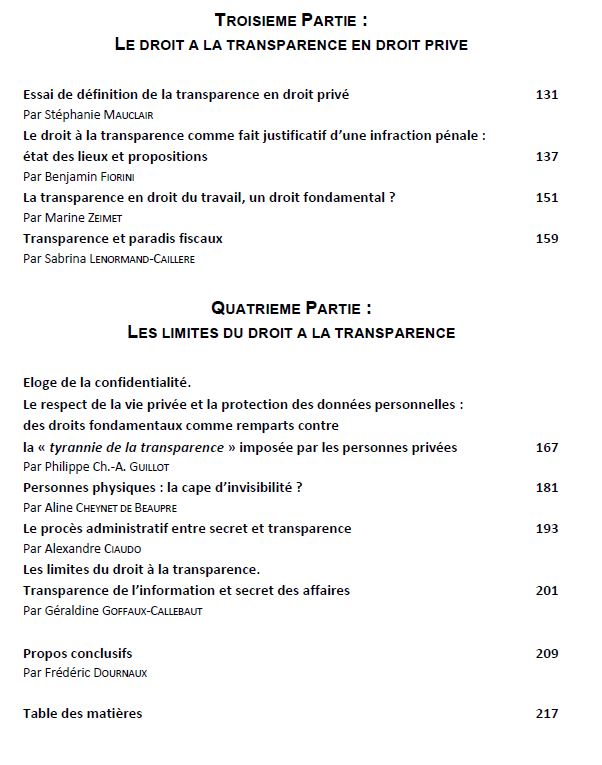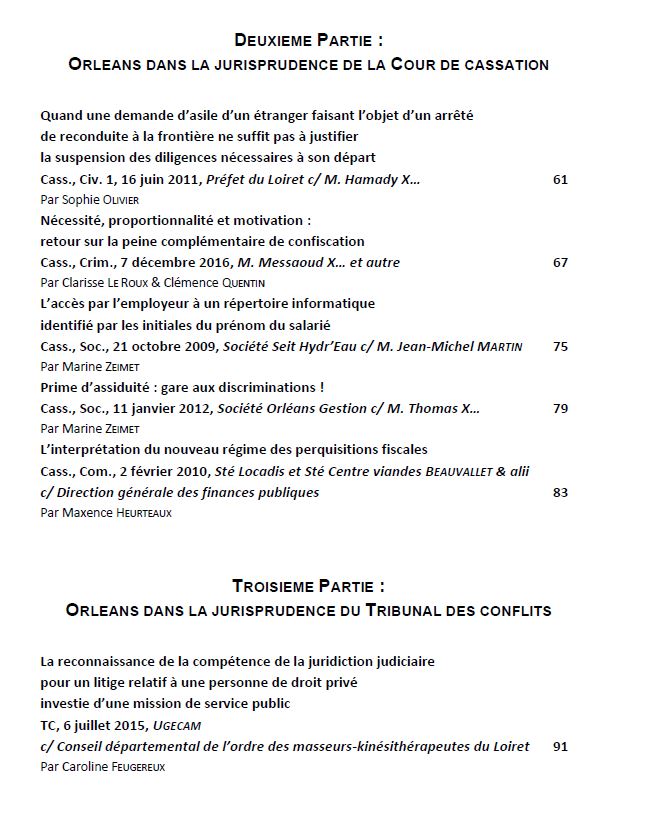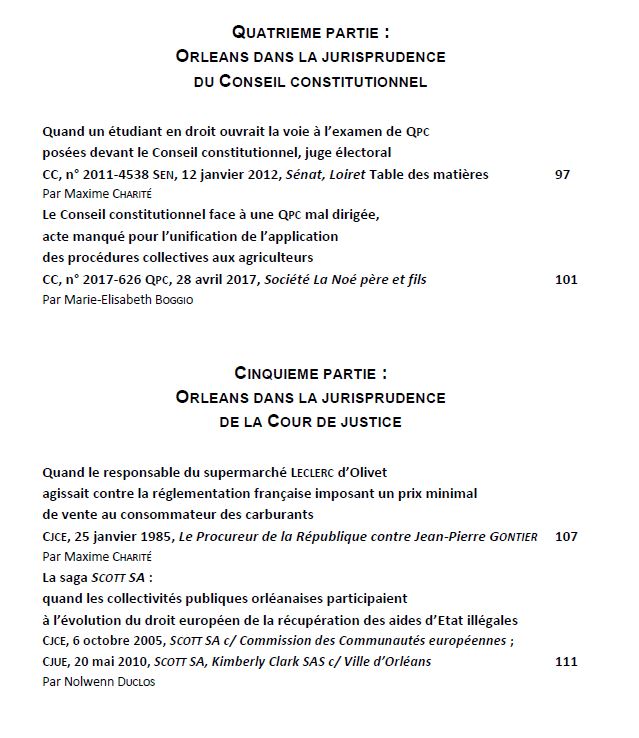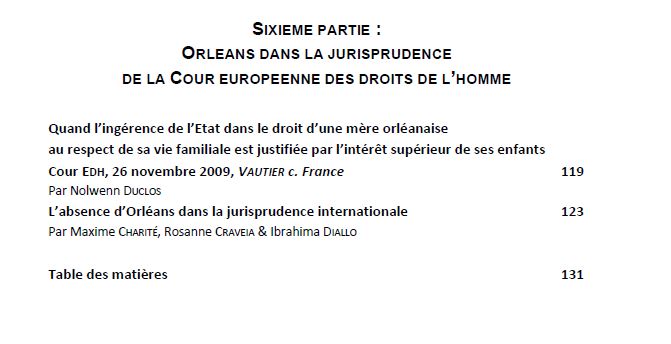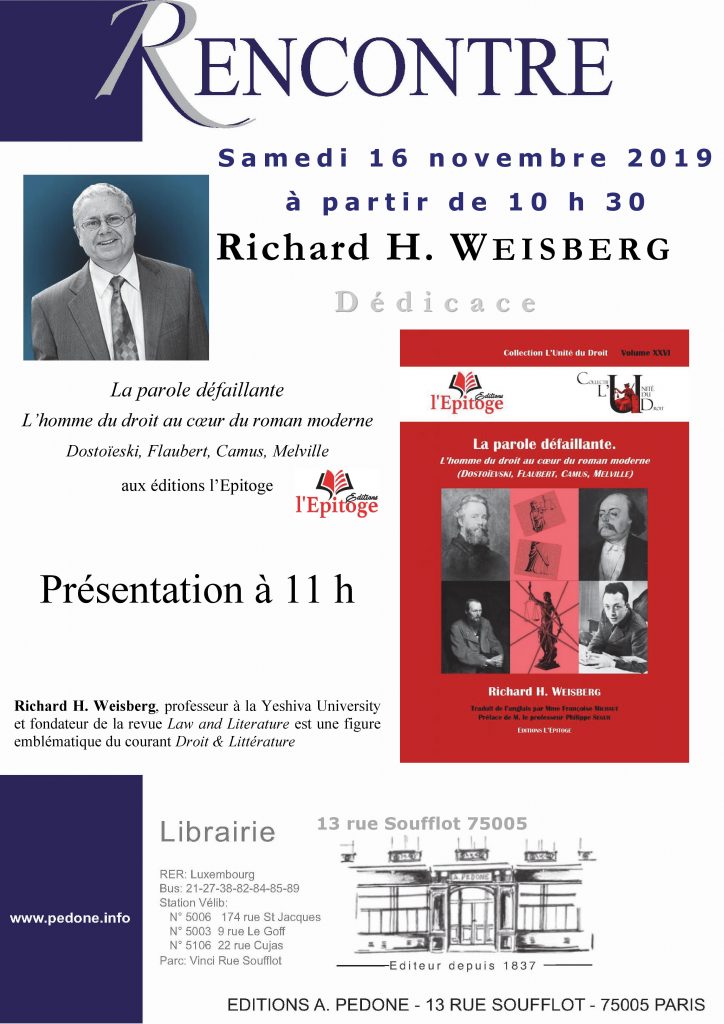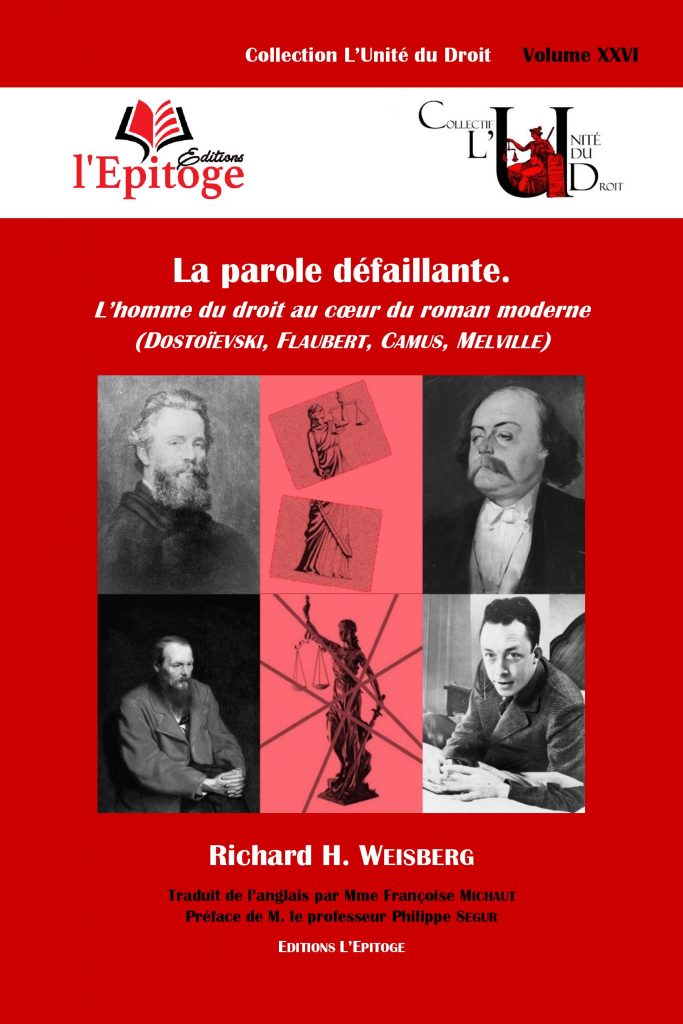Voici la 53e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 27e livre de nos Editions dans la collection L’Unité du Droit, publiée depuis 2012.
L’extrait choisi est celui de l’article de Mme Marie KOEHL à propos de résistance collective dans la websérie La Casa de Papel. L’article est issu de l’ouvrage Lectures juridiques de fictions.

Cet ouvrage forme le vingt-septième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».
En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :
Volume XXVII :
Lectures juridiques de fictions.
De la Littérature à la Pop-culture !
Ouvrage collectif sous la direction de
Mathieu Touzeil-Divina & Stéphanie Douteaud
– Nombre de pages : 190
– Sortie : mars 2020
– Prix : 29 €
– ISBN / EAN : 979-10-92684-38-4
/ 9791092684384
– ISSN : 2259-8812

De la résistance collective
dans la Casa de Papel
Marie Koehl
Docteure en droit privé, Université Paris Nanterre,
Membre du Collectif L’Unité du Droit
« La lutte contre les inégalités sociales est le grand dessein collectif qu’une nation devrait se donner[1] ». Cette citation d’un académicien français du XXe siècle constitue l’essence de la série Casa de Papel. La notion de « collectif », du latin collectivius, signifie « ce qui groupe, ce qui rassemble », « qui concerne un ensemble de personnes unies par une communauté d’intérêts ou impliquées par une action commune[2] ». Le jeu collectif n’est pas réservé aux seuls sportifs : en atteste l’objectif principal du Collectif L’Unité du Droit (Clud[3]) de relier les juristes entre eux[4]. Le collectif « relie » en effet les individus et c’est sur une communauté d’intérêts que repose ce lien[5].
Casa de Papel peut être perçue comme une allégorie sur la résistance et sur la nécessité d’inventer ensemble une autre organisation sociale. Au-delà de l’intrigue, de l’action et de l’esthétique de cette fiction, c’est un acte politique qui est donné à voir au spectateur. On peut y déceler un message sur l’importance de penser par soi-même, d’abandonner la passivité et de s’indigner contre l’oppression. L’indignation n’est-ce pas « le motif de base de la Résistance[6] » ? Dans notre monde actuel, les raisons de s’indigner sont nombreuses et diverses. La crise des migrants, les écarts grandissants entre les plus pauvres et les plus riches[7], l’état de la planète, la financiarisation, etc. Il nous appartient donc de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers, dans laquelle les inégalités sociales demeurent fermement combattues[8]. Chacun a ses motifs d’indignation fondant son engagement politique. Ceux des braqueurs de la série résident essentiellement dans l’arbitraire étatique et la faillibilité du système ultracapitaliste. L’histoire repose, en effet, sur la préparation et le déroulement d’un spectaculaire braquage au sein de la Banque d’Espagne[9] par un groupe de braqueurs répondant aux ordres d’un seul homme : le Professeur. Portant tous des combinaisons rouges et un masque de Dali, et affublés du nom d’une capitale, ils forment un tout indissociable, un véritable « collectif » poursuivant un but politique commun.
Si l’action collective est saisie par le droit qu’il appréhende pour protéger des intérêts variés (syndicats, associations, collectivité des salariés, action de groupe, etc.), elle est aussi parfois un projet commun de ses membres réalisé en dehors du cadre légal. Tel est le cas de l’action menée par l’équipe du Professeur. Le sujet se révèle d’une actualité brûlante. Les actions collectives se font nombreuses pour pallier la carence de l’Etat dans certains domaines : le mouvement des Indignés[10] et de Nuit debout[11], l’« affaire du siècle » en matière d’écologie[12], les Collectifs anti-mafia[13] en sont des exemples topiques. Aujourd’hui, ce sont les Gilets jaunes qui essaiment leurs revendications sociales, aussi bien dans les campagnes que dans les villes. Cette contestation collective citoyenne, née il y a tout juste un an, nous servira d’ailleurs de fil conducteur pour la lecture de la troisième partie de cette série éminemment engagée. En effet, il illustre la force du collectif de se soulever en faveur de l’égalité. Pour ce faire, il conviendra, d’abord, d’appréhender les raisons de la rébellion des braqueurs (I), tout en nous interrogeant sur nos propres préoccupations actuelles. Nous verrons, ensuite, les moyens de la révolte du groupe, fondée sur la non-violence (II). Pour, enfin, tenter de comprendre ce que cette lutte collective révèle, notamment en restaurant le lien social (III).
I. Les raisons : mettre au jour les abus de pouvoir
La révélation des dérives du pouvoir étatique. Les deux premières parties[14] de la série ont pour but de mettre en lumière la révolte contre la pensée productiviste et la course à la compétitivité et à l’argent. La troisième partie repose davantage sur l’opacité de l’Etat et la mise au jour des « scandales » du pouvoir. A différents égards, la série nous conduit à réfléchir sur le propre fonctionnement de notre Etat. En ce sens, le cri de colère des braqueurs est à rapprocher de celui du mouvement populaire des Gilets jaunes en France. La liste est longue pour illustrer les dysfonctionnements du système étatique et l’absence de confiance dans le système institutionnel et électoral français. Nombreuses sont les affaires qui révèlent une « voyoucratie » patente dans les dernières décennies : mises en examen d’un ancien président de la République pour financement illégal de campagne et recel de fonds publics, condamnations d’un ancien ministre de l’Economie et des finances et d’un maire levalloisien pour fraude fiscale, emplois fictifs, la « Françafrique », écoutes illégales d’opposants par la cellule de l’Elysée mitterrandienne, etc. Ces affaires d’Etat montrent « un mélange des genres entre réseau étatique et intérêts privés[15] ».
Dans la partie III de Casa de Papel, c’est ce même sentiment d’impunité des représentants de l’Etat qui est mis en avant. L’équipe des braqueurs a une arme fortement dissuasive à l’encontre des autorités : ils détiennent 24 mallettes rouges contenant les plus importants secrets d’Etat, aussi bien nationaux qu’internationaux, pouvant ainsi mettre à mal la réputation de nombreux gouvernements. L’un des éléments qui intrigue le spectateur réside d’ailleurs dans le contenu de ces mallettes, resté inconnu. Ce que l’on voit, en revanche, ce sont les abus à l’encontre des détenus. En effet, toujours dans un but d’une transparence et d’exemplarité accrue de l’Etat, l’un des principaux combats menés par le groupe est celui de la dénonciation de la torture des détenus par la police. L’équipe du Professeur révèle l’affaire Cortés dans laquelle il est question de traitements inhumains et dégradants sur le détenu Cortés, dit Rio, membre du groupe des braqueurs lors du premier braquage[16]. Afin qu’il livre à la police des informations sur Le Professeur, Rio a été détenu dans une cellule sans lumière de la taille d’un cercueil, en étant privé de sommeil et drogué. Résultant de « traitements inhumains délibérés provoquant de fortes graves et cruelles souffrances », la torture est fermement sanctionnée dans la réalité[17]. Sur un autre plan, ce message véhiculé par la série n’est pas sans rappeler certaines « dérives » qui touchent l’institution policière en France. Elles ne s’assimilent pas aux actes de « torture » vus dans la série car elles concernent des faits de violence instantanés sans extorsion d’aveux[18]. Mais ces affaires constituent une autre forme de dérive étatique manifestant une inégalité criante. D’autres abus de pouvoir, touchant les questions fiscale, sociale et démocratique, sont également mis au jour dans cette troisième partie.
Les questions fiscale, sociale et démocratique. Né d’une contestation contre la hausse du carburant, le mouvement des Gilets jaunes entend défendre l’égalité sociale et lutter contre l’injustice fiscale et l’arbitraire étatique. La question fiscale a, en effet, été le révélateur du mouvement avec notamment la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (Isf), remplacé par un impôt sur la fortune immobilière (Ifi), les cadeaux fiscaux faits aux actionnaires du Cac 40 et aux grandes entreprises, et « dans le même temps » l’augmentation de la Csg, frappant les pensions de retraite. L’incompréhension est d’autant plus importante que parallèlement à ces mesures, l’Etat réduit les services publics[19]. Le mouvement révèle le sentiment d’injustice et la volonté de protection des intérêts économiques d’une minorité. La révolte populaire a pris peu à peu de l’ampleur avec, ensuite, en toile de fond la question sociale et démocratique.
Le mouvement a conduit à mettre en exergue les déconstructions du monde du travail et à réfléchir aux solutions qui s’imposent. Le marché du travail est en tension : il évolue en opposant encore plus nettement, comme aux Etats-Unis, des lovely jobs, bien payés et protégés, d’un côté, et des emplois peu qualifiés, mal rémunérés, les bullshit jobs, de l’autre côté. Ces travailleurs d’un genre nouveau sont placés dans une situation de précarité qui résulte de l’exclusion de la qualité de salarié ou d’un fractionnement des périodes d’emploi par le recours au travail intérimaire, à durée déterminée et à temps partiel[20]. Le constat est aussi celui de la promotion des travailleurs indépendants mal protégés, ne pouvant compter sur la propriété (d’un fonds de commerce par exemple) et au service de leur unique donneur d’ordre, galvanisés par les potentialités qu’offrent les plateformes numériques[21]. La revendication des Gilets jaunes n’est donc pas tournée vers l’employeur mais vers l’Etat, ce ne sont plus alors les patrons qui ont été visés mais davantage les riches et les élites.
C’est ce sentiment d’injustice sociale, cette incertitude du lendemain, de ces nouveaux travailleurs et de ceux qui opèrent hors du modèle de l’emploi[22], qu’il convient d’apaiser. Certains en appellent ainsi de leurs vœux d’une volonté politique forte car « le marché du travail évolue sans intervention de l’homme, alors que les institutions qui l’organisent nécessitent, elles, cette intervention pour s’adapter. Cet aggiornamento imposerait assurément une reprise en main étatique, le déploiement de services publics qui ne sont d’ailleurs en rien contraires à un libre espace offert au marché, pour peu que l’on souhaite un marché juste et non juste le marché[23] ». Cependant, il ne semble pas que le Gouvernement ait pris cette voie : dès la fin du grand débat national, c’est davantage celle de la remise en cause des « 35 heures » pour « remettre les Français au travail[24] » ainsi que la réforme des retraites qui ont été prises.
Enfin, derrière le soulèvement des Gilets jaunes se niche immanquablement la question démocratique. Malgré l’hétérogénéité du groupe, les manifestants ont en commun, notamment, un désaveu des citoyens envers la classe politique. Pour y pallier, des propositions sont faites dans des « Cahiers de doléances » et un referendum d’initiative citoyenne est souhaité. Plus globalement, ils s’emparent de la question institutionnelle en remettant en cause le pouvoir présidentiel[25].
Dans la partie 3 de Casa de Papel, ces questions sociale et démocratique sont moins mises en relief que dans les parties précédentes mais elles sont tout au long des épisodes suggérées. Le lieu du braquage, la Banque d’Espagne, n’est d’ailleurs pas anodin. Plus encore, le réalisateur, Alex Pina, s’est fortement inspiré du mouvement des Indignés, rassemblant, en 2011 à la Puerta Del Sol à Madrid, des manifestants pacifistes contre l’austérité et le chômage. Comme le masque de certains d’entre eux, les Anonymous, le réalisateur a choisi pour ses braqueurs le masque de Dali, peintre excentrique du XXe siècle que l’on surnommait « Avida Dollars » en raison de son rapport particulier à l’argent. Ce symbole évoque donc l’acte politique derrière le braquage, à savoir l’idée de la nécessité de réinventer une autre organisation sociale et de démontrer la faillibilité du système capitaliste. Pour révéler les limites du pouvoir étatique et de la recherche incessante du profit, et afin d’être compris par le plus grand nombre, l’équipe du Professeur a choisi la voie pacifique.
II. Les moyens : appeler à une insurrection pacifique
Une insurrection organisée. A la différence de la série où le groupe est organisé et sous les ordres du Professeur, il y a une absence de structuration du mouvement des Gilets jaunes. On y observe, en effet, un désordre dans l’ordonnancement des idées et dans l’organisation générale. Il souffre de l’absence d’une ligne directrice claire et de représentants officiels, malgré l’émergence de quelques figures médiatiques. Il s’oppose en ce sens au mouvement des « coordinations » (Sncf, infirmières, etc.) des années 1980, lequel a prospéré en dehors des syndicats, mais où existait de véritables leaders.
Dans Casa de Papel, les braqueurs agissent de concert, de façon précise et méthodique, dans un but politique commun. Ils acceptent les règles du jeu dictées par le Professeur en associant leurs forces. Ils sont ainsi unis par-delà l’hétérogénéité du groupe où chacun poursuit un intérêt qui lui est propre. Le Professeur réalise, lui, le plan de son père, mort dans un braquage, quand Tokyo souhaite libérer celui qu’elle aime. Mais au fond, tous résistent ensemble au pouvoir, devenant les acteurs et maîtres des destins individuels et collectifs des « Autres ». Cette idée du « collectif » défendue par le réalisateur conduit ainsi le spectateur à s’insurger contre la politique de l’entre-soi.
Cette « désobéissance civile[26] » organisée se propage au-delà des murs de la Banque d’Espagne puisque des manifestations spontanées apparaissent rapidement en soutien à l’équipe.
Le droit de manifester porté à l’écran. Les scènes où l’on voit de nombreux manifestants, habillés comme les braqueurs et brandissant l’image du visage de Dali, en appui à leur action, sont certes courtes et rapides mais elles sont distillées tout au long de la série et dans quasiment chaque épisode, ne manquant pas, encore, de faire écho à l’actualité. Le mouvement des Gilets jaunes offre en effet un terrain nouveau d’analyse au droit de manifester[27]. L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ». La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protège également ce droit dans son article 9 : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le Code pénal ainsi que le Code de la sécurité intérieure[28] conditionnent le recours à la force aux principes d’absolue nécessité, de proportionnalité et de réversibilité. Par exemple, le Code pénal en son article 431-1 punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende « le fait d’entraver d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation ». L’alinéa 3 de l’article précise qu’est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende l’entrave exercée « d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code ». En outre, en France, les citoyens doivent déclarer préalablement les manifestations sur la voie publique. Cette déclaration s’exerce en mairie ou en préfecture entre trois jours francs (48h à Paris) et quinze jours francs avant la date prévue. Depuis l’origine, le mouvement des Gilets jaunes est spontané et un certain nombre de manifestations n’a pas été déclaré, au risque pour les manifestants de se voir condamnés à une amende[29].
Malgré cet encadrement textuel, le mouvement a mis en lumière la multiplication des tensions et des incidents entre les forces de l’ordre et les participants aux manifestations. L’état des lieux d’une année de mobilisations spontanées peut effrayer : plusieurs centaines de blessés côté manifestants et côté forces de l’ordre, deux morts « indirects », des milliers d’interpellations, des gardes à vue, des procédures judiciaires, des biens détruits, des black blocs[30] présents régulièrement en marge des cortèges[31]. Un arsenal répressif lourd a, de ce fait, été mis en place rapidement afin de maintenir l’ordre lors des manifestations. De nombreuses Ong, dont Attac et Amnesty International[32], ont dénoncé le gazage et l’encerclement des manifestants pacifiques. De même, la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe invitait, en février dernier, les autorités françaises à « ne pas apporter de restrictions excessives à la liberté de réunion pacifique » et à « suspendre l’usage du lanceur de balle de défense », responsable de blessures et mutilations graves. La Haut-commissaire aux droits de l’homme de l’Onu a également enjoint la France à mener une enquête approfondie sur tous les cas d’usage excessif de la force survenus pendant les manifestations des Gilets jaunes.
Ce clivage entre forces de l’ordre et manifestants est notamment décrit dans le rapport remis à l’Assemblée nationale en janvier 2018 sur le maintien de l’ordre, par le Défenseur des droits. Il y reconnaît une « perte de confiance de la population à l’égard des forces de l’ordre », tout en pointant un véritable « malaise policier[33] ». D’un côté, la population s’insurge contre les dérives policières et la rupture d’égalité entre les manifestants et les forces de l’ordre face à la justice. Sur ce dernier point, la mise en cause individuelle de policiers s’avère complexe et peu de condamnations sont prononcées à leur encontre. Certains avocats préconisent donc à leurs clients des actions collectives, au tribunal administratif notamment, contre l’Etat, du fait de ses ordres dans le cadre du maintien de l’ordre[34].
De l’autre côté, les forces de l’ordre s’estiment « faire l’objet d’une violence croissante et inédite », et ne se sentent pas « soutenues par leur hiérarchie » ni « reconnues par la population, dans un contexte de fortes sollicitations professionnelles[35] ». Le rapport préconise alors diverses mesures comme le renforcement des exigences de formation et de contrôle en matière de maintien de l’ordre, d’information des manifestants afin de rendre l’action des forces de l’ordre plus compréhensible et l’accomplissement de missions de prévention. Ces préconisations faites dans une approche d’apaisement et de protection sont à privilégier, tout comme des soulèvements non-violents.
Le mouvement des Gilets jaunes évoque donc à bien des égards les grandes émeutes populaires. De la Révolution française à mai 1968, en passant par la période insurrectionnelle de la Commune de Paris de 1871 et les grèves de 1936, les droits ont souvent été conquis par des révoltes agitées. D’ailleurs, la violence du peuple ne naît-elle pas de la violence institutionnelle, celle qui entretient les dominations, de façon silencieuse ? On peut y voir d’une certaine manière, la violence étatique contre la violence sociale. En effet, « il faut comprendre la violence comme une regrettable conclusion de situations inacceptables pour ceux qui les subissent[36] ». Si la violence est compréhensible, elle n’est pas acceptable. Surtout, elle ne permet pas d’obtenir les résultats espérés.
Une insurrection non-violente. Dans la série, les différentes saisons offrent nombre de scènes violentes dans lesquelles les braqueurs utilisent la force pour faire respecter l’ordre parmi les otages. Ils n’hésitent pas à pointer leurs armes pour dissuader les otages de se révolter. Certaines scènes mettent parfois le spectateur dans une situation paradoxale : il est gêné, même embarrassé, de lire la peur dans le regard des otages et, dans le même temps, il se place du côté des braqueurs, espérant qu’aucun incident ne perturbe le déroulement de leur plan. Parfois, donc, l’équipe est dépassée par des événements inattendus et fait montre d’autorité. Toutefois, la série se veut pacifiste. C’est là même le cœur du scénario. Les braqueurs font preuve d’un sens moral : même s’ils enfreignent le droit en retenant des femmes et des hommes en otage, ils accomplissent leur plan pacifiquement. Une scène de cette troisième partie résume bien leur dessein. Il s’agit d’une vidéo envoyée par l’équipe du Professeur aux inspecteurs dans laquelle on voit des policiers pris en otage et attachés torse-nu délivrant un message pour le monde extérieur. De prime abord, la séquence parait violente et choquante en raison de l’humiliation qu’ils subissent. Néanmoins, les braqueurs font passer un message de non-violence en leur demandant de confirmer qu’ils ne subissent aucun sévices et en leur faisant chanter Bella Ciao, chant des résistants omniprésent dans les deux premières parties. Cette chanson populaire venue d’Italie est un marqueur fort de la série car elle est un hymne partisan de résistance au fascisme, devenue par la suite une déclaration de refus de toute forme d’oppression. Dans Casa de Papel, elle représente la révolte face à l’autorité financière et à l’opacité du pouvoir étatique. En cela, elle est un véritable message d’espoir. Sartre disait en ce sens qu’« il faut essayer d’expliquer pourquoi le monde de maintenant, qui est horrible, n’est qu’un moment dans le long développement historique, que l’espoir a toujours été une des forces dominantes des révolutions et des insurrections[37] ».
Cette insurrection pacifique et le message d’espoir qu’elle relaye permettent de dépasser les conflits par une compréhension mutuelle. Les représentants de l’Etat sont, dès lors, embarrassés par l’efficacité de cette voie de la non-violence prise par les braqueurs car elle suscite l’appui et la compréhension de ceux qui s’opposent à l’oppression[38]. En effet, Le Professeur rend sa démarche légitime en cherchant le soutien de l’opinion publique[39]. A cet effet, un jeu avec les médias se joue tout au long de la série.
Les médias et les réseaux sociaux, relais essentiels de l’information. En quête d’audiences, les médias cèdent parfois à la facilité des commentaires au détriment de la recherche de la vérité. Or, l’information est aussi « un champ de bataille où se joue l’exercice d’un droit fondamental : le droit de savoir[40] », lequel est « du faible au fort, l’arme pacifique de l’émancipation par la connaissance[41] ». Ainsi, durant le mouvement des Gilets jaunes, on peut aisément constater que certains médias ont « voulu vendre du papier » en pointant essentiellement les faits de violence pendant les manifestations. Dans une certaine mesure, cette stratégie a délégitimé les manifestations et décrédibilisé le mouvement. Dans la série, on observe également l’importance des médias, vrai relai de communication de l’équipe. Le Professeur a bien compris que pour être efficace, il faut agir en réseaux. Il se sert donc volontiers des médias et des nouvelles technologies de l’information pour faire passer son message. A l’instar des lanceurs d’alerte, il souhaite par le biais des chaînes d’information révéler les travers du pouvoir étatique. Sa méthode de communication se révèle être un succès puisque l’opinion publique lui est favorable au vu de la propagation de manifestations spontanées. Ce soutien se ressent jusque dans les zones reculées du pays puisque des agriculteurs, dans un coin semble-t-il isolé, viennent en aide au Professeur et à Lisbonne. La troisième partie rappelle donc au spectateur l’importance des médias et la puissance de l’immédiateté des réseaux sociaux, et sous-tend qu’une véritable démocratie nécessite incontestablement une presse indépendante.
Quoi qu’il en soit, le braquage aura au moins eu le mérite de porter aux yeux de tous le combat de ces braqueurs, auparavant délaissés par l’Etat.
III. Les résultats : rendre visibles « les oubliés »
La légitimité démocratique. L’embrasement populaire, à travers l’action des braqueurs et les manifestations devant la Banque d’Espagne, rappelle que le peuple est la source du pouvoir démocratique. Le « peuple » « ne s’appréhende plus comme une masse homogène, il s’éprouve plutôt comme une succession d’histoires singulières. […]. C’est pourquoi les sociétés contemporaines se comprennent de plus en plus à partir de la notion de minorité. La minorité n’est plus la « petite part » (devant s’incliner devant une « grande part ») : elle est devenue une des multiples expressions diffractées de la totalité sociale[42] ». Aujourd’hui, la seule légitimité démocratique par l’élection est remise en cause. L’élection a, en effet, une fonction plus réduite ne faisant que valider un mode de désignation des gouvernants et n’impliquant pas qu’un gouvernement soit au service de l’intérêt général. Partant, on assiste à l’apparition de nouvelles attentes citoyennes à voir s’instaurer un régime serviteur de l’intérêt général et, donc, à l’émergence de nouvelles figures démocratiques. Ces autres formes d’investissement politique se sont donc révélées, à la fois concurrentes et complémentaires à la figure du « peuple-électeur[43] ». Pour le dire autrement, il s’agit d’une réinvention de la démocratie qui ne saurait se limiter au droit de vote.
Les Gilets jaunes incarnent, eux-aussi, dans son sens pratique, l’idée de démocratie définie comme « l’action qui sans cesse arrache aux gouvernements oligarchiques le monopole de la vie publique et à la richesse la toute-puissance sur les vies[44] ». C’est, en somme, la victoire des « oubliés », devenus de véritables acteurs autonomes de leur propre histoire et non plus « sujets » d’une histoire politique[45]. Les actes de violence réalisés par des groupes irréductibles d’extrémistes ont souvent masqué le fait que la grande majorité des manifestants ont pourtant discuté pacifiquement des heures durant, souvent dans le froid et sous la pluie, de revendications variées. Oubliées également les scènes de fraternité observées sur les ronds-points ou dans les baraquements, rappelant que certains Gilets jaunes souhaitaient seulement sortir de l’isolement. L’on découvrait, notamment, à cette occasion l’isolement important des femmes : plus d’une femme majeure sur deux, vit seule en France[46]. De même, la rentabilité immédiate, les politiques ultra-libérales creusent les inégalités contre les solidarités collectives[47]. Et c’est parce que l’Etat a justement tourné le dos « au souci du commun[48] » que la révolte des oubliés[49] a tonné, créant un temps nouveau au dialogue.
L’arrêt du temps en faveur du dialogue. Le temps est un facteur primordial dans la série : les braqueurs doivent rester suffisamment longtemps dans la Banque pour fondre l’or, sans dépasser la limite fixée par le Professeur au risque d’une intervention des forces policières. Ce temps est surtout nécessaire au Professeur pour négocier avec les inspecteurs. En effet, le dialogue avec les autorités demeure encore le fil rouge de cette troisième partie. Les échanges se font vifs avec l’inspectrice, figure féminine puissante. A cet égard, bien que cela ne soit pas le message principal de la série, certaines scènes et certains personnages[50] conduisent le spectateur à réfléchir sur la société patriarcale. Les négociations se poursuivent également avec des représentants du gouvernement. Le Professeur parvient ainsi à changer la règle et la donne du jeu politique. Du reste, cet arrêt du temps diffère avec l’immédiateté de certaines décisions politiques. L’équipe de braqueurs laisse donc place à un autre temps : celui de la pensée et du dialogue.
C’est d’ailleurs le propre des soulèvements populaires que d’interrompre le temps. Le mouvement des Gilets jaunes en atteste une nouvelle fois avec le blocage du temps et de la circulation sur les ronds-points et aux péages occupés. Au-delà du temps gagné et du dialogue engagé, s’insurger permet aussi et surtout d’être libre à certains égards.
Révolte et liberté. Le soulèvement de ces minoritaires leur assure la liberté[51]. Pour Hannah Arendt, la liberté n’est pas d’abord un phénomène de la volonté intérieure, ce que l’on appelle le « libre-arbitre », mais est inhérente à l’action extérieure puisque « être libre et agir ne font qu’un[52] ». A cet égard, le politique est, selon elle, un espace pluriel de délibération, un espace de liberté[53]. Aussi, une comparaison avec la série peut une fois de plus être faite ici. Et ce notamment lorsque l’auteure rappelle que la polis grecque était autrefois une « forme de gouvernement » qui procurait aux hommes, une scène où ils pouvaient jouer, une sorte de théâtre où la liberté pouvait apparaître. Le groupe de braqueurs n’est autre que des femmes et des hommes vivant en communauté, à la fois avant le braquage pour le mettre en œuvre puis pendant. Les flashbacks, présents dans toutes les saisons et montrant la préparation du braquage, révèlent que rien n’est laissé au hasard. Regroupés tous ensemble dans une demeure isolée, les braqueurs sont comme des étudiants auxquels le Professeur donne les directives à suivre. Il les invite à réfléchir sur le sens de leurs actions et leurs conséquences. Quelle qu’en soit l’issue, l’enfermement collectif, durant des jours dans la vaste demeure puis au sein de la Banque d’Espagne, est finalement le prix à payer de leur liberté.
Mais toute révolution est-elle vraiment synonyme de liberté ? En d’autres termes, si toute révolte est menée au nom de la liberté, est-elle réellement toujours un processus menant à la liberté de ceux qui la poursuivent ? Si la question mérite d’être posée et débattue, une certitude demeure : cette révolte permet de rendre visible.
La visibilité des exclus. Dans un essai inédit[54], Hannah Arendt affirme qu’avant de conduire à un régime démocratique, la révolution a d’abord libéré tout un ensemble d’individus jusqu’ici invisibles. Ainsi, se manifeste dans l’acte même de la révolution le fait de rendre visible, de donner naissance à des individus jusqu’ici jamais réunis en un tout. L’auteure prend notamment acte du fait que la Révolution française a libéré les pauvres de l’invisibilité, en les faisant accéder à la vie publique : « un peuple frappé par la pauvreté et la corruption est soudain délivré non pas de la pauvreté mais de l’obscurité », et entend « pour la première fois que sa situation est discutée ouvertement et qu’il se trouve invité à participer à cette discussion[55] ». Cette pensée résonne donc parfaitement avec les colères actuelles et les ambitions du réalisateur de la série. En somme, la série invite à nous interroger sur la liberté que le peuple a de s’organiser par lui-même pour s’emparer de l’action politique.
C’est en filigrane, l’idée de l’importance de se soulever, pour n’importe qui, défendue par Michel Foucault[56]. Ce dernier résume-t-il : « a-t-on raison ou non de se révolter ? Laissons la question ouverte. On se soulève, c’est un fait ; et c’est par là que la subjectivité (pas celle des grands hommes, mais celle de n’importe qui) – quel qu’en soit le visage – s’introduit dans l’histoire et lui donne son souffle. Un délinquant met sa vie en balance contre des châtiments abusifs ; un fou n’en peut plus d’être enfermé et déchu ; un peuple refuse le régime qui l’opprime. Cela ne rend pas innocent le premier, ne guérit pas l’autre, et n’assure pas au troisième les lendemains promis ».
Mais cela le rend libre et visible. La série illustre bien l’idée que ce ne sont pas les « puissants » qui font le jeu démocratique mais bien les « n’importe qui[57] ». Les braqueurs dissimulent leur visage sous un masque de Dali, lequel devient un symbole jusqu’à être repris par une partie de la population qui soutient leur action. Leur combinaison rouge et leur masque marquent donc les esprits – entrant même dans notre propre réalité[58] – et les rendent visible aux yeux de tous. Il leur permet également de se fondre dans la masse des otages qui sont eux-aussi dotés dudit habit pour créer la confusion chez les forces d’intervention de la police.
Tous, otages et braqueurs confondus, forment une même et seule communauté et semble sur un pied d’égalité. L’important est que ces « n’importe qui » sont enfin visibles et entendus.
L’espoir d’un avenir nouveau. Bien que chaque épisode tienne le spectateur en haleine lui faisant espérer que le groupe réussisse à finir de transformer l’or tout en sortant de la Banque sans se faire arrêter, sur le fond le résultat du braquage importe peu. En creux, ce qui compte c’est le but commun poursuivi : inquiéter les « puissants » et montrer au peuple qu’une alternative au système existant est possible. Là réside l’intérêt de l’œuvre commune.
Derrière la défaite des Gilets jaunes se niche une victoire[59] car, malgré les scories que comporte ce mouvement, la couleur du gilet a permis de rendre visibles les invisibles[60] et surtout de croire[61] à un avenir nouveau[62]. Tout comme les braqueurs au visage de Dali.
Finalement,
la résistance collective permet la réunion des forces pour briser l’immobilité,
pour « inventer collectivement l’alternative » pour construire l’avenir[63].
Elle oblige à des remises en cause et ouvre des possibles.
[1] J. De Bourbon Busset.
[2] V° Collectif, G. Cornu, Vocabulaire juridique, Puf, Quadrige, 12e éd., 2018.
[3] La présentation de l’association est claire sur ce point : « Le Collectif L’Unité du Droit (Clud) a pour vocation de rassembler des universitaires convaincus du nécessaire rapprochement des droits et de leurs enseignements dans une unité et non dans leurs seules spécificités ». Ses membres sont « convaincus de (re) créer des liens entre spécialistes du Droit (dont privatistes et publicistes mais pas seulement) ainsi qu’entre praticiens et universitaires (et réciproquement) ».
[4] Si la réflexion sur l’Unité du Droit est le cœur de son action, le Clud permet un véritable soutien des Universitaires à l’égard des jeunes chercheurs comme en témoignent les Universités d’été et les nombreux ouvrages collectifs auxquels ces derniers peuvent participer.
[5] A. Sotiropoulou, « La collectivité », in Recueil de leçons de 24 heures, Agrégation de droit privé et de sciences criminelles de 2015, Lgdj, 2015, p. 321.
[6] S. Hessel, Indignez-vous !, Indigènes éditions, 2010.
[7] L’Ong Oxfam annonce dans son dernier rapport, le renforcement de l’écart entre les plus riches et les plus pauvres : en 2018, la fortune des milliardaires a augmenté de 12 % (augmentation de 900 milliards de dollars) tandis que la richesse des plus pauvres de la population mondiale (soit 3,8 milliards de personnes), baissait de 11 %. Par ailleurs, seulement 26 personnes possédaient en 2018 autant que la moitié la moins riche de la population mondiale : Rapport « Services publics ou fortunes privées ? », Oxfam International, janv. 2019, en ligne.
[8] S. Hessel, Indignez-vous !, Indigènes éditions, 2010, p. 9.
[9] Dans les deux premières parties de la série, le braquage se déroule dans l’Office de la Monnaie et du timbre.
[10] Mouvement de manifestations, non violent né sur la Puerta del Sol, en Espagne, à Madrid le 15 mai 2011, rassemblant des centaines de milliers de manifestants contre l’austérité.
[11] Ensemble de manifestations sur des places publiques, en France, ayant commencé le 31 mars 2016 sur la Place de la République à Paris, à la suite d’une manifestation contre la « loi Travail ».
[12] A la suite du « grand débat national » du printemps 2019, une vaste pétition écologique a circulé pour obliger l’Etat à prendre ses responsabilités face aux changements climatiques.
[13] Des Collectifs anti-mafia, dont le Collectif anti-mafia « Massimu Susini », ont vu le jour récemment en Corse à la suite de l’assassinat d’un jeune militant, Massimu Susini, en septembre 2019. Plus de 800 personnes étaient réunies, le 29 septembre, à l’Université de Corte pour débattre de l’emprise du grand banditisme sur l’île et dénoncer la défaillance de l’Etat à protéger les insulaires des assassinats, des menaces, des extorsions, des pressions diverses, des corruptions dont nombreux sont victimes.
[14] La série se divise en « Parties » sur Netflix.
[15] E. Plenel, La victoire des vaincus. A propos des gilets jaunes, La Découverte, 2019, p. 124.
[16] Braquage de la Fabrique nationale de la Monnaie et du Timbre : Partie 1 et 2 de la série.
[17] Code pénal, art. 222-1, al. 1er : « Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. ». Art. 222-2, al. 1er : « L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol. ». La Cour de cassation est venue modifier sa jurisprudence dans un sens plus sévère lorsqu’elle a condamné la France pour torture dans le cadre de la garde à vue d’un étranger soupçonné de trafic de stupéfiants : « la Cour estime que certains actes autrefois qualifiés de « traitements inhumains et dégradants », et non de « torture », pourraient recevoir une qualification différente à l’avenir » (Cedh, grande ch., 28 juill. 1999, aff. 25803/94, Selmouni c/ France).
[18] Pour les affaires les plus médiatiques ces dernières années : Affaire Zyed et Bouna : le 27 octobre 2005, Zyed Benna et Bouna Traoré sont morts électrocutés dans le transformateur Edf où ils s’étaient réfugiés pour échapper aux policiers qui les poursuivaient. Trois semaines de révolte s’en s’ensuivirent et dix années de procédure judiciaire. Malgré certaines failles dans l’enquête, le tribunal correctionnel de Rennes a relaxé les deux policiers jugés pour « non-assistance à personnes en danger » ; Affaire « Théo » est une affaire judiciaire relative à l’arrestation et au viol allégué d’un homme de 22 ans, Théodore Luhaka, le 2 février 2017 ; Affaire « Benalla », mettant en cause un chargé de mission, coordinateur de différents services lors des déplacements officiels et privés du président de la République, accusé d’avoir usurpé la fonction de policier, et violenté un couple de manifestants, le 1er mai 2018, à Paris.
[19] La crise des hôpitaux publics et la grève récente des pompiers sont des exemples parmi d’autres. V. not. Rapport de l’Académie nationale de médecine (Anm), Rapport 19-02. L’hôpital public en crise : origines et propositions, du 12 fév. 2019, en ligne.
[20] L. Gamet, « Les Gilets jaunes et la question sociale », Dr. social, 2019, p. 564.
[21] C. Larrazet, « Régime des plateformes numériques, du non-salariat au projet de charte sociale », Dr. social, 2019, n° 2, p. 167 ; F. Champeaux, « L’occasion de déplacer les frontières du salariat », SSL 07 oct. 2019, n° 1877, p. 3 ; P. Lokiec, « De la subordination au contrôle », SSL 17 déc. 2018, n° 1841, p. 10 ; T. Pasquier et A. Chaigneau, « Capital, travail et entreprise numérique », in A. Jeammaud, M. Le Friand, P. Lokiec, C. Wolmark (dir.), A droit ouvert, Mélanges en l’honneur d’A. Lyon-Caen, Dalloz, 2018, p. 187 ; T. Pasquier, « Le droit social confronté aux défis de l’ubérisation », Dalloz IP/IT, n° 7, 2017, p. 368 ; B. Gomes, Le droit du travail à l’épreuve des plateformes numériques, sous dir. A. Lyon-Caen, Thèse Paris Nanterre, 2018. V. not. Les décisions de justice rendues au sujet des travailleurs des plateformes numériques : Take eat easy : Soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079 ; Uber : CA Paris, pôle 6, ch. 2, 10 janv. 2019, M. X c/ Uber.
[22] L. Gamet, « UberPop (†) », Dr. social, 2015, p. 929.
[23] L. Gamet, « Les Gilets jaunes et la question sociale », Dr. social, 2019, p. 564.
[24] Ch. Radé, « Gilets jaunes et chiffon rouge », Dr. social, 2019, p. 369.
[25] E. Plenel, La victoire des vaincus. A propos des gilets jaunes, La Découverte, 2019, p. 51.
[26] Terme créé par l’américain Henry David Thoreau en 1849 après avoir passé une nuit en prison pour avoir refusé de payer l’impôt électoral au gouvernement d’un Etat fédéral des Etats-Unis qui reconnaissait l’esclavage. La désobéissance civile est le refus de se soumettre à une loi injuste et à chercher à changer cette loi par des moyens non-violents : H.-D. Thoreau, La désobéissance civile, Gallmeister , coll. Totem, réed. 2017. Le philosophe rappelle le caractère non-violent de la révolte : « Si un millier d’hommes devaient s’abstenir de payer leurs impôts cette année, ce ne serait pas une initiative aussi brutale et sanglante que celle qui consisterait à les régler, et à permettre ainsi à l’Etat de commettre des violences et de verser le sang innocent. Cela définit, en fait, une révolution pacifique, dans la mesure où pareille chose est possible », spéc. p. 9.
[27]A. Coignac, « Droit de manifester : toujours une liberté ? », Dalloz Actualité 04 oct. 2019.
[28] CSI, art. L. 211-1 à L. 211-4 (Manifestations sur la voie publique) ; art. L. 211-9 à L. 211-10 (Attroupements).
[29] Les articles 431-3 et suivants du Code pénal prévoient les peines et amendes dans les hypothèses de participation délictueuse à un attroupement. L’article 431-9 du Code pénal punit également de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ; d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ; d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée.
[30] Le black bloc est un groupe d’individus sans hiérarchie, habillés de noir, masqués, qui justifient la violence contre les représentations de l’Etat par la violence intrinsèque de celui-ci.
[31] A. Coignac, « Droit de manifester : toujours une liberté ? », Dalloz Actualité 04 oct. 2019 : « Samedi 21 septembre, l’acte 45 des Gilets jaunes, la Marche pour le climat et la manifestation contre les retraites dans Paris se sont soldées par 158 gardes à vue selon la Préfecture. Selon le parquet, 90 personnes se sont vues notifier un rappel à la loi, parfois assorti d’une interdiction de paraître à Paris pendant six mois, en application de la loi anticasseurs du 10 avril 2019. ». Des médias relayent encore d’autres chiffres : le journaliste David Dufresne a recensé les cas documentés (vidéos, photos, certificats) de victimes des forces de l’ordre, via un fil Twitter intitulé « Allô Place Beauvau ». Le 23 septembre 2019, le décompte s’élevait, tous mouvements sociaux confondus, à 860 signalements dont deux décès. Sur le site Mediapart, la page « Allô Place Beauvau ? C’est pour un bilan provisoire » fait état des derniers chiffres officiels du Ministère de l’Intérieur, au 29 août 2019 : soit 2 448 blessés, 561 signalements déposés à l’Igpn (Inspection générale de la police nationale), 313 enquêtes judiciaires de l’Igpn, 8 enquêtes administratives, 15 enquêtes judiciaires de l’Iggn (Inspection générale de la gendarmerie nationale), 180 enquêtes transmises au Parquet, 1 9071 tirs de Lbd, 1 428 tirs de grenades lacrymogènes instantanées, 5 420 tirs de grenades de désencerclement, 474 gendarmes blessés et 1 268 policiers blessés.
[32] Dans une tribune du 3 mai 2019, Amnesty International se positionna pour l’interdiction du Lbd40 et des grenades lacrymogènes instantanées Gli-Fa utilisés par les forces de l’ordre pendant les manifestations des Gilets jaunes.
[33] « Le maintien de l’ordre au regard des règles de déontologie », Rapport du défenseur des droits, Décembre 2017, p. 1, en ligne.
[34] A. Coignac, « Droit de manifester : toujours une liberté ? », Dalloz Actualité 04 oct. 2019. L’auteure enquête auprès de nombreux acteurs (représentants des forces de l’ordre, avocats, universitaires pénalistes, journalistes). Il est notamment relaté l’interview d’une avocate : Maître Claire Dujardin constate que « les textes sont assez flous sur l’usage de la force et le concept de légitime défense, cela favorise des décisions comme le non-lieu dans l’affaire Rémi Fraisse (militant écologiste, tué en 2014 lors d’une manifestation contre le barrage de Sivens) ». Elle ajoute : « Je ne peux pas emmener mes clients pour quatre ans en instruction avec un fort risque de non-lieu à la fin. Ça les laisse en plus dans un statut de victime qui devient compliqué à gérer dans la vie ».
[35] « Le maintien de l’ordre au regard des règles de déontologie », Rapport du défenseur des droits, Décembre 2017, p. 8, en ligne.
[36]S. Hessel, Indignez-vous !, Indigènes éditions, 2010, p. 18.
[37] J.-P. Sartre, « Maintenant l’espoir… (III) », Le Nouvel Observateur, 24 mars 1980.
[38] Sur l’efficacité de la non-violence : S. Hessel, Indignez-vous !, Indigènes éditions, 2010, p. 20.
[39] V. supra l’article collectif : « Une lecture juridique au prisme du droit à la désobéissance » : « C’est précisément sur ce point décisif que le Professeur échafaude la légitimité de sa démarche pour s’en incarner en héraut. Il le répète sans cesse… l’opinion publique est la seule véritable arme, sa caution. Son soutien traduit et porte la voix indicible du peuple concret. Son rejet, a contrario, pointerait un acte criminel ».
[40] E. Plenel, La victoire des vaincus. A propos des gilets jaunes, La Découverte, 2019, p. 181.
[41]Ibid., p. 184.
[42] P. Rosanvallon, La contre-démocratie. La politique de à l’âge de la défiance, Paris, Seuil, Points, 2006, p. 14.
[43] Ibid., p. 108. L’auteur y décrit l’émergence des figures du « peuple-surveillant », du « peuple-véto » et du « peuple-juge » en contrepoint de celle d’un « peuple-électeur ».
[44] J. Rancière, La haine de la démocratie, La Fabrique, Paris, 2005, p. 105.
[45] E. Plenel, La victoire des vaincus. A propos des gilets jaunes, La Découverte, 2019, p. 13.
[46] L. Gamet, « Les Gilets jaunes et la question sociale », Dr. social, 2019, p. 564.
[47] La solidarité doit être revue à l’aune des défis auxquels sont confrontées les sociétés actuelles modernes : V. l’ouvrage collectif sous dir. S. Paugam, Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales, Puf, 2007, réed. 2011.
[48] E. Plenel, op. cit., p. 159.
[49] V. Dossier Mediapart, « Gilets jaunes : La révolte des oubliés ».
[50] Dans la saison un, Nairobi crie : « place au Matriarcat ! ». De même, les violences conjugales sont dénoncées à travers la violence de l’ex-mari de l’inspectrice. V. sur le féminisme dans la série, supra, la communication de Mme Stéphanie Willman-Bordat.
[51] « Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l’obéissance il assure l’ordre ; par la résistance il assure la liberté » : Alain, Propos sur les pouvoirs, Paris, Gallimard, coll. Folio/essais, 2014, p. 162.
[52] H. Arendt, La Crise de la culture, « Qu’est-ce que la liberté ? », Folio, Gallimard, 2014 (1ère éd. 1989), p. 198.
[53] H. Arendt, La Crise de la culture, « Qu’est-ce que la liberté ? », Folio, Gallimard, 2014 (1ère éd. 1989), p. 190 : « la raison d’être de la politique est la liberté, et son champ d’expérience est l’action ».
[54] H. Arendt, La liberté d’être libre, Payot, 2019. Cet essai inédit a été retrouvé récemment dans le fonds Arendt de la Bibliothèque du Congrès à Washington. Ce texte a été probablement écrit à la fin des années 1960, au moment de la crise de Cuba, des révolutions en Amérique latine et de la décolonisation.
[55] H. Arendt, La liberté d’être libre, Payot, 2019.
[56] M. Foucault, « Inutile de se soulever ? », Le Monde, n° 10661, 11- 12 mai 1979, p. 1 et s., in Dits et Ecrits 1954-1988, t. III, Gallimard, Paris, texte 269, p. 790-794.
[57] V. aussi sur le « n’importe qui » : E. Plenel, La victoire des vaincus. A propos des gilets jaunes, La Découverte, 2019, p. 59.
[58] La diffusion de la série a engendré une commercialisation importante du costume rouge et du masque de Dali. Certaines images montrent même des Gilets jaunes portant le masque de Dali.
[59] D’où le titre évocateur de l’ouvrage d’Edwy Plenel sur le mouvement des Gilets jaunes : « La victoire des vaincus » : E. Plenel, La victoire des vaincus. A propos des gilets jaunes, La Découverte, 2019.
[60] E. Morin, « La couleur jaune d’un gilet a rendu visible les invisibles », Mediapart, 24 déc. 2018.
[61] « Si l’on ne croit à rien, si rien n’a de sens et si nous ne pouvons affirmer aucune valeur, alors tout est permis et rien n’a d’importance. Alors, il n’y a ni bien ni mal, et Hitler n’a eu tort, ni raison. […]. On a tous à créer en dehors des partis et des gouvernements des communautés de réflexions qui entameront le dialogue à travers les nations et qui affirmeront par leur vie et leurs discours que ce monde doit cesser d’être celui de policiers, de soldats et de l’argent pour devenir celui de l’homme et de la femme, du travail fécond et du loisir réfléchi » : A. Camus, « La crise de l’homme », conférence donnée à l’Université de Colombia (New York), 28 mars 1946, in A. Camus, Conférences et discours (1936-1958), Folio, 2017.
[62] Aujourd’hui le mouvement des Gilets jaunes fête ses un an mais s’est largement essoufflé. Toutefois, malgré l’absence de solution concrète aux attentes des manifestants et les frustrations qui vont de pair, le mouvement vit toujours et a permis à de nombreuses personnes de tisser des liens, de retrouver une fraternité longtemps oubliée. Plus encore, il leur a permis d’être entendus. Et l’engagement se poursuit pour certains autrement comme ce « Collectif citoyen Sélestat 2020 » crée en Alsace appelant les citoyens à rejoindre une liste citoyenne pour les municipales. V. l’article « Les gilets jaunes tentent d’entretenir la flamme », DNA 9 nov. 2019, p. 13.
[63] E. Plenel, La victoire des vaincus. A propos des gilets jaunes, La Découverte, 2019, p. 161.
Nota Bene : le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pourrez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).