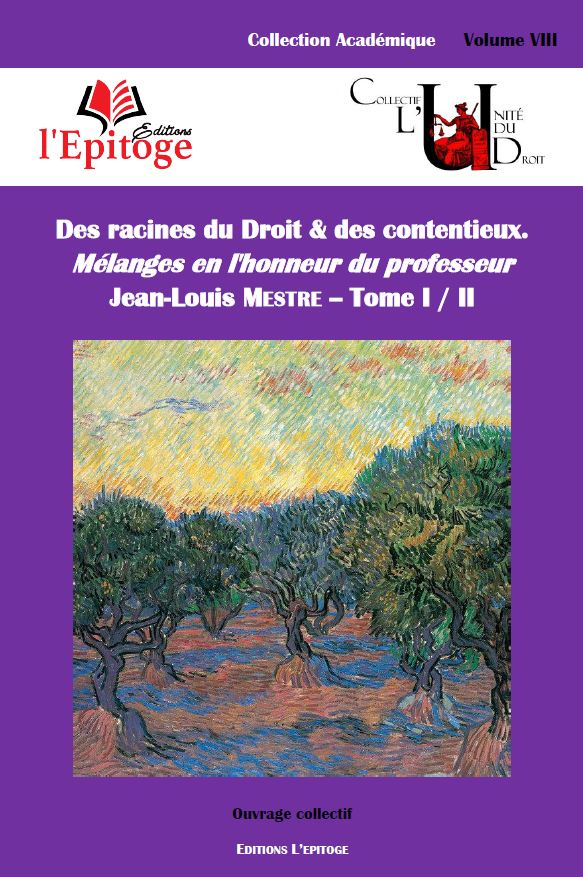Voici la 51e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du quatrième livre de nos Editions dans la collection Histoire(s) du Droit, publiée depuis 2013 et ayant commencé par la mise en avant d’un face à face doctrinal à travers deux maîtres du droit public : Léon Duguit & Maurice Hauriou.
L’extrait choisi est celui de l’article de Mmes Marietta Karamanli & Mélina Elshoud publié dans l’ouvrage Jean Jaurès & le(s) Droit(s).

Volume IV :
Jean Jaurès
& le(s) droit(s)
Ouvrage collectif sous la direction de
Mathieu Touzeil-Divina, Clothilde Combes
Delphine Espagno-Abadie & Julia Schmitz
– Nombre de pages : 232
– Sortie : mars 2020
– Prix : 33 €
– ISBN / EAN : 979-10-92684-44-5
/ 9791092684445
– ISSN : 2272-2963
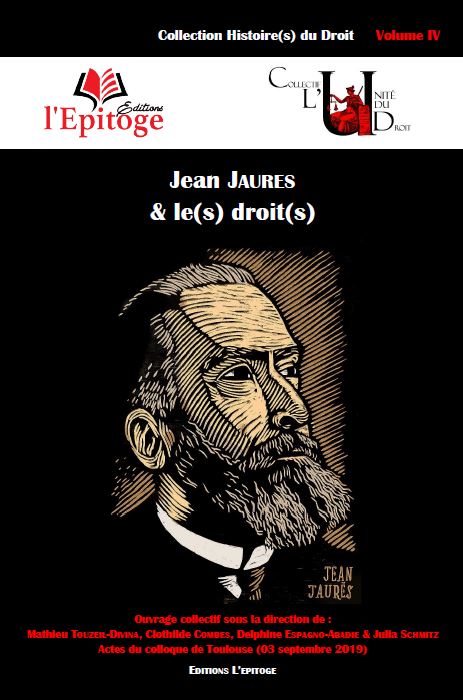
Jaurès en 2020 :
entre instrumentalisation(s)
& héritage(s)
Marietta Karamanli & Mélina Elshoud
Députée de la 2e circonscription de la Sarthe
& Conseillère départementale de la Sarthe
Mesdames, Messieurs les Professeurs, Mesdames, Messieurs,
Vos contributions l’ont toutes très bien démontré : Jean Jaurès est bel et bien un acteur politique de notre temps, en ce sens que, nombreuses sont toujours les références à son travail, à sa pensée, à son action publique.
Parmi ces références, il est intéressant de constater que les discours des responsables politiques français lui réservent une place particulière, mais surtout grandissante ; certains commentateurs[1] ayant évoqué une « Jaurèsophilie » ou une « Jaurèsmania ».
Il n’y a pas de récente campagne électorale nationale française, et notamment présidentielle, qui échappe à une volonté d’appropriation, ou du moins à des manœuvres que nous qualifierons librement « d’assimilation » de la pensée de Jean Jaurès par les principaux courants politiques de notre vie nationale. Gilles Candar, un des meilleurs spécialistes de l’homme et de son œuvre – que nous saluons – a lui-même publié un long papier sur la campagne présidentielle de 2007 et la revendication par des partis de droite du tribun socialiste, un phénomène qu’il qualifie de « nouveau[2]», non pas dans son principe, mais dans son ampleur depuis le début de la Ve République.
En 2007, la droite scande « Je me sens l’héritier de Jaurès[3] » et la gauche conteste une « captation d’héritage[4]». Cette bataille mémorielle avait inspiré à Philippe Bilger cette question simple, bien qu’il la trouve lui-même « infiniment vulgaire[5]» : « A qui appartient Jaurès ? ».
Dans le cadre de cette intervention, nous n’avons pas cherché à répondre à cette question – non pas qu’elle soit mal posée car au contraire elle résume bien le « procès en légitimité[6] » qui est fait aujourd’hui à celui qui décide de citer Jaurès – mais parce que la réponse nous semble indubitable et donc dénuée d’intérêt : Jean Jaurès n’appartient à personne, ou plutôt, il appartient à tout le monde, en ce qu’il est, comme l’écrit Gilles Candar, « le patrimoine commun de l’humanité[7] ».
Nous avons eu à cœur toutes deux de faire œuvre d’analyse en soumettant à une démarche libre et contradictoire notre examen de la filiation revendiquée d’un homme, à la fois, acteur et décideur politique, et universitaire.
Nous avons souhaité, d’une part, mettre en exergue les motivations qui conduisent, quel que soit le bord politique, des responsables élus à se référer à Jaurès.
Nous avons souhaité, d’autre part, voir si ces citations correspondaient bien à la philosophie de Jaurès, mais non pas en passant chacune des assertions de nos responsables politiques à la moulinette critique de leur pertinence au regard des principes et propositions de Jean Jaurès – ce qui aurait demandé une grande familiarité avec l’œuvre de Jaurès que nous ne prétendons pas avoir et ce qui risquerait d’encourir le reproche d’une interprétation du passé à la lumière d’enjeux en opportunité du présent – mais, nous avons essayé de tirer des enseignements de la façon dont Jaurès lui-même a pu utiliser des références à une œuvre ou à un propos de ses prédécesseurs pour éclairer l’actualité politique contemporaine.
Evidemment, notre propos est « situé » c’est-à-dire que nous parlons d’une place particulière, élu-e-s toutes deux, avec des engagements partisans, et nous avons l’expérience de celles et ceux qui citent Jaurès avec parfois du talent mais surtout le souhait de trouver ou gagner une légitimité que donnerait l’Histoire en disant que lui, Jaurès, l’aurait ou pas, fait ou pensé.
Sans prétendre à l’exhaustivité, nous souhaiterions vous rappeler quelques exemples caractéristiques de cette « assimilation » politique des propos de Jean Jaurès.
En avril 2007, lors d’un meeting dans la région, Nicolas Sarkozy alors candidat à la Présidence de la République cite une trentaine de fois Jean Jaurès[8] déclarant qu’il s’en sent « l’héritier ». « Laissez dormir Jaurès » demande-t-il à la gauche d’aujourd’hui qui, selon lui, « n’aime pas le travail » contrairement à celle d’hier, et à la droite qu’il incarne et qui veut permettre à ceux qui veulent travailler plus pour gagner davantage de pouvoir le faire. Un peu plus tard, à l’occasion d’un meeting à Paris pour les législatives, François Fillon s’offusque[9] « Est-ce la faute des citoyens, si le parti de Jaurès et de Blum est devenu l’un des plus rétrogrades d’Europe ? ».
En janvier 2011, à Tours, Marine Le Pen évoque, lors du congrès de son mouvement, la pensée jaurésienne et déclare que Jaurès aurait dit en son temps « A celui qui n’a plus rien, la patrie est son seul bien », confirmant, selon elle, qu’il a été « lui aussi trahi par la gauche du FMI ». Cette référence n’est pas nouvelle puisqu’en 2007 déjà, son père Jean-Marie Le Pen avait fait valoir une pseudo filiation au patriotisme de Jaurès, et en 2009, cette citation avait orné les affiches de la campagne européenne de Louis Aliot et notamment à Carmaux, suppléée par la phrase « Jaurès aurait voté Front national ».
En 2012, à Toulouse, François Bayrou alors candidat à l’élection présidentielle et contestant le Président sortant, Nicolas Sarkozy, cite Jaurès, en reprenant son propos selon lequel « On doit les mener [les Français] sur le seul chemin qui soit le chemin de la République, on doit les mener vers les hauteurs […]. C’est trahir la République que de la tirer vers le bas[10] » !
Le 23 avril 2014, François Hollande, Président de la République, vient expliquer ses réformes à Carmaux et rappelle à cette occasion que Jaurès « enseignait la patience de la réforme, la constance de l’action, la ténacité de l’effort[11] ». En juillet 2014, Jean-Christophe Cambadélis en visite à Carmaux compare François Hollande, alors en difficulté face à sa propre majorité parlementaire et à l’opinion, à Jean Jaurès. Selon lui, les deux hommes partagent un destin commun ; ils auraient été de grands incompris de leur époque. Il déclare « Il est intéressant de constater que [Jean Jaurès], en son temps décrié, honni, vilipendé – on l’a même assassiné – soit devenu par la suite une figure de notre nation[12] ».
La même année, en juin, Manuel Valls, Premier ministre en visite au Centre des monuments nationaux pour inaugurer une exposition sur le centenaire de la mort de Jaurès, affirme que ce dernier aurait voté le « pacte de responsabilité », une mesure chère à François Hollande qui vise à alléger les charges sociales des entreprises s’engageant à embaucher, car il aurait été, selon lui, « de ceux qui veulent gouverner et qui veulent que la gauche gouverne dans la durée[13] ». En face, dans une tribune intitulée « Jaurès revient ! Ils ont changé de camps ! », Jean-Luc Mélenchon lui reproche de « Faire parler les morts pour endormir les vivants[14] ». Paradoxalement, il se soumet lui-même dans le reste de sa lettre à cet exercice délicat consistant à expliquer ce qu’aurait fait Jaurès s’il était encore vivant[15].
En juillet 2017, le même Jean-Luc Mélenchon, élu de son mouvement La France insoumise, aurait demandé au Président de l’Assemblée nationale la place dans l’hémicycle autrefois occupée par Jaurès[16].
Enfin, en mai 2017, quelques semaines avant, Emmanuel Macron, candidat à l’élection présidentielle en meeting à Albi, déclare que Jean Jaurès « n’est pas celui qu’on veut nous faire croire. C’était un homme qui aimait la liberté beaucoup plus que ceux qui le citent à loisir aujourd’hui. C’était à ce titre un défenseur de l’entrepreneur ce qui surprend souvent […]. Il est en quelque sorte l’homme du « en même temps » que je porte aujourd’hui. Il n’était pas enfermé dans l’égalitarisme[17] ».
Autant d’égards et d’hommages peuvent surprendre[18].
Quatre motifs, qui peuvent se superposer et jouer ensemble, nous paraissent expliquer cet engouement au moins « facial » pour la place et la parole qu’incarne le philosophe et député que fut Jean Jaurès.
I.
La première raison est la conquête ou la reconquête en légitimité d’un électorat de gauche attaché à la tradition d’un socialisme français, indépendant, démocratique, exigeant quant aux finalités, et dépassant les appareils. Citer Jaurès c’est d’abord puiser dans l’imaginaire collectif de la gauche et renvoyer aux combats et aux idéaux de l’homme. De ce point de vue, on cite beaucoup Jaurès pour susciter de l’espoir et de l’effervescence. D’ailleurs, à gauche, chaque campagne nationale comprend son meeting à Toulouse, à Albi ou à Carmaux, lequel offre une occasion privilégiée de puiser dans l’œuvre de Jaurès : ce fut le cas pour François Hollande en 2012, pour Benoit Hamon et Jean-Luc Melenchon en 2017, ou encore pour Raphaël Glucksmann en 2019.
Toujours pour retrouver de la légitimité, on utilise aussi Jaurès comme « justification », comme pour dire qu’une mesure est « vraiment de gauche même si elle n’en a pas vraiment l’air ». Les propos précités de Jean-Christophe Cambadelis, de Manuel Valls ou de François Hollande, valorisant le pragmatisme de Jaurès et rappelant parfois l’impopularité de ses positions, peuvent facilement y trouver une raison d’être.
Enfin, et toujours dans cette volonté de légitimer ou justement de délégitimer, on cite Jaurès pour critiquer des politiques « pas assez de gauche ». Cette démarche a été beaucoup utilisée par La France insoumise ou le Front national pour fustiger les réformes prises sous le quinquennat de François Hollande, notamment dans l’objectif de s’adresser à un électorat ouvrier, qui constituait historiquement une base électorale du socialisme[19]. Les propos de Jaurès sur le protectionnisme, sur le travail, sur la patrie ont été beaucoup utilisés car ils servent des revendications sociales et donc une « une prolétarisation du discours[20] ».
II.
La deuxième raison est la volonté de rassemblement des candidats à l’élection présidentielle qui doivent dépasser leur camp et pour lequel la référence à Jaurès rend possible un ralliement au-delà du camp droite-gauche. Les propos tenus par les deux candidats qu’ont été successivement Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron dans leur registre spécifique peuvent y trouver leur origine.
III.
La troisième raison s’apparente à une vision nationale dans laquelle la figure de Jaurès est consensuelle, même si marquée à gauche, une figure qui a fait la France au même titre que d’autres figures historiques et dont la mort au service de la paix transcende les différences et les oppositions mêmes violentes d’avant ! On cite Jaurès comme on cite de Gaulle, Aristote, Briand, etc. C’est un « marqueur » intéressant pour des partis qui veulent nourrir ou « se racheter » en quelque sorte une image républicaine.
IV.
Enfin, la quatrième raison tient moins au fond qu’à la forme : Jaurès rassemble car tout le monde lui reconnaît des qualités « politiques » essentielles.
Il est d’abord très bon orateur, surnommé Saint-Jean Bouche d’Or. D’ailleurs, sa figure est souvent utilisée par des agences de communication, de management et de formation à la prise de parole en public et on le retrouve en librairie dans Convaincre comme Jaurès. Comment devenir un orateur d’exception[21].
Fondant son engagement sur des valeurs universelles – ses propos sur le courage, l’humanité ou l’optimisme sont ceux qui sont le plus cités par les élus de tous bords – il apparaît comme un homme de convictions tout autant que de consensus, un homme respectueux des traditions mais marquant par son originalité, et prouvant, s’il le faut, que ces qualités ne sont pas inconciliables.
Tout cela lui vaut d’être respecté et craint, admiré par ses soutiens et ses adversaires, faisant de lui un grand homme public. Citer Jaurès aujourd’hui pour un élu, c’est admettre de prendre en modèle un homme politique de son envergure.
Il s’agit là, nous semble-t-il d’une vision de Jaurès qualifiable de « patrimoniale » ; elle n’est, elle-même, pas exempte d’une vision partisane tendant à faire de Jaurès une référence évoquant davantage le passé de la France que son actualité. Cette vision peut être revendiquée à titre subsidiaire par les uns et les autres.
A l’évidence, certains responsables peuvent avoir un rapport personnel à l’auteur et acteur Jaurès pour l’avoir lu, avoir étudié son action et ses prises de positions sur le long terme, cela devient alors souvent plus intéressant.
A l’évidence aussi, certains responsables « font leur marché » dans une pensée qui reste vivante car elle pose des questions et tente de dessiner un chemin, mais les comparaisons s’arrêtent souvent sur un point, un sujet, une crise, et ils n’envisagent pas sa pensée comme un tout, un mouvement et c’est là que peuvent émerger des contre-sens majeurs.
La plupart de ces citations procèdent d’ailleurs, nous l’avons laissé percevoir, d’une logique de communication visant par une phrase à revendiquer une part de l’héritage sans même connaître les problématiques d’ensemble posées. On use de la légitimité de Jaurès pour en faire un « supporter » de renom.
Nombreuses sont, malheureusement, les références appartenant à cette dernière typologie de citations, utilisées non pas pour éclairer une vision et nourrir un débat, mais comme un argument d’autorité et un faire-valoir pour conforter une position que l’on veut indiscutable.
Ainsi, on constate avec désarroi que ceux qui mettent en avant l’intérêt porté au travail par Jaurès, le font au détriment de son souhait de mettre fin au salariat et de partager les moyens de production avec les travailleurs. Ceux qui mettent en avant le rôle et l’importance de la patrie pour Jaurès, oublient souvent sa conviction profonde que « le jour où un seul individu humain trouverait, hors de l’idée de patrie, des garanties supérieures pour son droit, pour sa liberté, pour son développement, ce jour-là l’idée de patrie serait morte[22] ».
Journalistes, universitaires, politiques ont souvent condamné les citations « tronquées » de Jaurès qui conduisent des responsables politiques à lui faire dire autre chose, comme François Fillon en 2007 dont l’article tronqué en faisait le défenseur du patronat[23], ou comme Marine Le Pen en 2011, citant une citation non référencée et en fait inexistante dans les écrits de Jaurès[24], ou qui conduisent à passer sous silence une partie de son propos, à l’image de Raphaël Glucksmann qui citait, à Toulouse, il y a quelques mois, Jaurès pour sa conviction dans le caractère réformateur du Parti socialiste, tout en taisant le fait que cette conviction tient à ce que le parti veut, à l’époque, nous citons, « abolir le salariat, résorber et supprimer tout le capitalisme[25] ».
Au cours de nos lectures, nous avons remis la main sur un texte de Jaurès, et plus précisément sur une conférence de philosophie qu’il donna à l’Université de Toulouse en 1893 sur « les idées politiques et sociales de Rousseau[26]», philosophe qu’il considère comme une de ses sources d’inspiration.
Nous l’avons trouvé intéressant car il donne une illustration de la façon dont Jaurès avait lui-même pu utiliser l’œuvre d’un de ses prédécesseurs au service d’une analyse de la politique contemporaine à laquelle il aimait se livrer, plus d’un siècle après.
Nous avons en effet tenté de voir si selon lui il était possible de juger les effets d’idées politiques énoncées pour changer un monde, alors même que ce monde a changé et peut encore être changé. Dans ce cours, Jaurès met en évidence quelques éléments significatifs de la pensée de Rousseau et établit une réelle continuité entre sa pensée socialiste et celle du philosophe des Lumières. Tout d’abord, il considère que Rousseau est au commencement de l’idée socialiste, je cite, « qui était en lui, par son désintéressement, son détachement personnel[27] ». Rousseau est un homme d’esprit « désintéressé », et c’est selon Jaurès, ce qui a donné de l’autorité à ses idées. Mais dans le même temps, c’est ce « désintéressement » qui l’a empêché, selon lui, d’être un « penseur d’action[28]» c’est à dire de « croire à la possibilité d’obtenir les transformations profondes exigées par le droit[29] ».
Le deuxième élément, c’est qu’il est un penseur de l’idéal de la liberté politique et de l’égalité sociale. Il pense les institutions comme régulant la société mais aussi comme pouvant enchaîner les individus. S’il se félicite des progrès, il connaît l’effet néfaste des passions qui se déchaînent. C’est ce qui nourrit chez lui la force de l’idée du Droit, notamment pour encadrer la question de la propriété individuelle, car il a ce mot fort : « la faiblesse humaine est disproportionnée au progrès humain[30] ».
Dans son cours, Jaurès met en évidence la cohérence et la cohésion d’une pensée complète habitée par le souci de l’égalité et des solutions concrètes à y apporter, et dont le défaut majeur est pour Rousseau de ne pas avoir suffisamment « cru », nous citons Jaurès, « à sa chimère[31]! ».
Car Jaurès constate que Rousseau, qui a agi si puissamment sur la Révolution, ne croyait pas au succès possible de cette Révolution et, il confesse même qu’il n’est « pas sûr que pour cet homme concentré, fermé à certaines légèretés d’enthousiasme, la Révolution française n’eût pas été une nouvelle cause de désespoir[32]». Et, pourtant la liberté y a été acquise et persiste un siècle plus tard. Il constate aussi que si les clauses de son contrat social n’ont jamais été exposées, partout elles ont été facilement adoptées et reconnues. S’il n’y trouve pas de solution précise pour décliner son action politique, Jaurès puise dans Rousseau l’inspiration de la Justice, l’attachement au Droit, et il y puise aussi par expérience d’une Révolution que Rousseau n’a pas connue, l’optimisme et la conviction qu’un jour « la grandeur des événements répond à la grandeur de la pensée[33] ».
Ainsi si on veut établir une continuité, si ce n’est parfaite, du moins logique entre Jaurès et la politique d’aujourd’hui, on devrait rétablir un lien entre sa vision politique d’ensemble et son comportement et les enjeux du moment.
Comme l’a très justement écrit Gilles Candar, « la politique n’a de sens pour lui que rattachée à une conception générale de la vie et de l’humanité[34] ».
Ceux qui se revendiquent de Jaurès n’ont pas toujours eu la chance ou tout simplement le souhait de connaître « le socialisme des origines, qui avait une dimension internationale et portait un modèle de société[35] » comme le disait le socialiste et ancien Premier ministre Michel Rocard. Ce dernier insistait sur cette dimension essentielle : « Il y avait la conscience de porter une histoire collective, elle était notre ciment[36]».
A l’évidence, cet intérêt et ce désir n’existent pas toujours chez ceux qui le célèbrent ou lui empruntent un morceau d’intelligence ou de gloire. Ils n’existent pas chez ceux que Jaurès appelait les « hommes pratiques[37]» qui « emploient quelques mots humanitaires pour amorcer les suffrages du peuple, et qui, sous ces mots, ne mettent aucun sentiment ardent, aucune idée précise qui puisse inquiéter les privilégiés[38] ». Par ailleurs, la crise du socialisme démocratique actuelle dépasse largement la question des citations et de ceux qui les utilisent.
Il faut néanmoins rappeler cette part manquante : citer Jaurès c’est peut-être en partie « du » Jaurès, mais c’est seulement en partie[39], sans le socialisme et la préoccupation de porter un regard sur un fait essentiel tel qu’il résumait la pensée de Rousseau : « Tout homme entrant dans l’ordre social doit y trouver l’égalité, en échange de la liberté dont il fait abandon[40] ».
Pour conclure, il nous semble que la pensée de Jaurès reste « dynamique » parce que ses propos peuvent faire écho à des évènements et questionnements contemporains variés posés par la mondialisation, par la recherche de la paix, par la paupérisation et la peur du déclassement qu’elle nourrit, par la montée des individualismes et des nationalismes, par le dérèglement climatique et la question de la décroissance, par le fonctionnement de nos institutions ou encore par la réglementation du droit du travail.
Nous ne prendrons qu’un exemple ; au moment où se discute la place et le rôle de la nature dans notre société et où l’avenir des territoires ruraux est interrogé, il est éclairant de relire une dernière fois Jaurès, que nous citons : « Demain, si comme l’espèrent tous les socialistes, un nouveau système social et le perfectionnement de tous les moyens de communication permettent aux hommes de se disséminer dans les campagnes au lieu de s’entasser dans des villes démesurées, l’humanité pourra revenir à un stade antérieur ; et ce sera pourtant un progrès immense, car pouvoir vibrer à la fois, par un double contact, de l’immense vie remuante des hommes et de l’immense vie paisible des choses, quelle plénitude et quelle joie[41] ! ».
Nous aimons à croire qu’il n’aurait pas vu d’un mauvais œil que ses idées soient reprises, citées, commentées, car il aimait nourrir le débat, enseigner pour cultiver, et partager ses sources d’inspiration et de questionnement. Il voulait nourrir des esprits libres, c’est ce qui justifiait aussi son amour et sa confiance dans la République.
Si le terme « instrumentalisation » renvoie à une connotation
négative, elle ne désigne que le fait d’utiliser quelque chose ou quelqu’un
comme un instrument, mais elle ne dit pas au service de quoi. Et il nous semble
qu’utiliser Jaurès pour faire progresser
les idées du socialisme, pour nourrir la réflexion politique et juridique comme
aujourd’hui, pour « aller à l’idéal
et comprendre le réel[42]», pour expliquer la complexité du
monde tout en le rendant plus facile à vivre pour tous, pour exiger autre chose
de nos modèles sociaux et économiques, pour faire vivre et démocratiser sa
pensée, cet héritage ; pour toutes ces raisons au moins, utiliser Jaurès reste une belle façon de lui
rendre hommage.
[1] Guguen Guillaume, « Ces politiques qui ne jurent plus que par Jean Jaurès » in Site du journal France 24 ; 2014 ; (https://www.france24.com/fr/20140730-centenaire-jaures-jean-assassinat-politique-france-ps-fn-sarkozy-valls-hollande-pen-melenchon) (consulté le 11/08/2019).
[2] Candar Gilles, « Jaurès en campagne » in Site de la société d’études jaurésiennes ; 2007 ; p. 1 ; [http://www.jaures.info/bibliotheque/File/etudes/Candar-Jaures-Sarkozy.pdf?PHPSESSID=e9cd28ba18abff6477acf79b38189479] (consulté le 08/08/2019).
[3] Propos tenus par Nicolas Sarkozy en 2007 lors d’un meeting à Toulouse, et contestés par le Premier secrétaire du Parti socialiste de l’époque, François Hollande. V. « Cent ans après la mort de Jaurès, les politiques se disputent son héritage » in Site du Journal Le Parisien ; 2014 ;
[http://www.leparisien.fr/politique/videos-cent-ans-apres-la-mort-de-jaures-les-politiques-se-disputent-son-heritage-28-07-2014-4033231.php] (consulté le 08/08/2019).
[4] Ibid.
[5] Philippe Bilger, « A qui appartient Jaurès ? » in Blog de Philippe Bilger ; 2007 ;
[https://www.philippebilger.com/blog/2007/01/index.html] (consulté le 22/08/2019).
[6] A propos d’une autre querelle autour de la figure de Jaurès lors des élections régionales de 2015, V. « A Carmaux, Louis Aliot et Carole Delga s’opposent autour de la figure de Jaurès » in Site du Journal France 3 ; 2015 ; [https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn/carmaux-louis-aliot-et-carole-delga-s-opposent-autour-de-la-figure-de-jaures-832303.html] (consulté le 12/08/2019).
[7] Candar Gilles, « Jaurès en campagne » in Site de la société d’études jaurésiennes ; 2007 ; p. 5 ; (http://www.jaures.info/bibliotheque/File/etudes/Candar-Jaures-Sarkozy.pdf?PHPSESSID=e9cd28ba18abff6477acf79b38189479) (consulté le 08/08/2019).
[8] « 2007 : « je me sens l`héritier de Jaurès » (Sarkozy) » in Site du journal Challenges ; 2007 ; [https://www.challenges.fr/entreprise/2007-je-me-sens-l-heritier-de-jaures-sarkozy_387775] (consulté le 08/08/2019).
[9] Micoine Didier, « Fillon se fait le chantre de l’ouverture » in Site du journal Le Parisien ; 2007 ; [http://www.leparisien.fr/politique/fillon-se-fait-le-chantre-de-l-ouverture-15-06-2007-2008125323.php] (consulté le 08/08/2019).
[10] Guguen Guillaume, « Ces politiques qui ne jurent plus que par Jean Jaurès » in Site du journal France 24 ; (https://www.france24.com/fr/20140730-centenaire-jaures-jean-assassinat-politique-france-ps-fn-sarkozy-valls-hollande-pen-melenchon) 2014 ; (consulté le 11/08/2019).
[11] « Dans son hommage à Jaurès, Hollande demande « de la patience » aux Français » in Site du journal Le Parisien ; 2014 ; (http://www.leparisien.fr/politique/dans-son-hommage-a-jaures-hollande-demande-de-la-patience-aux-francais-23-04-2014-3789203.php) (consulté le 22/09/2019).
[12] Boni Marc (de), « Cambadélis tente une comparaison entre Hollande et Jaurès » in Site du Journal Le Figaro ; 2014 ; [http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2014/07/30/25002-20140730ARTFIG00069-cambadelis-tente-une-comparaison-entre-hollande-et-jaures.php] (consulté le 13/08/2019).
[13] Chazot Sylvain, « D’après Manuel Valls, Jean Jaurès aurait voté le pacte de responsabilité » in Site du journal Le Lab Europe 1 ; 2014 ; (https://lelab.europe1.fr/D-apres-Manuel-Valls-Jean-Jaures-aurait-vote-le-pacte-de-responsabilite-15227) (consulté le 09/08/2019).
[14] Mélenchon Jean-Luc, « Jaurès reviens ! Ils ont changé de camp ! » in Site du Journal du dimanche ; 2014 ; [https://www.lejdd.fr/Politique/Melenchon-Jaures-reviens-Ils-ont-change-de-camp-677766] (consulté le 22/08/2019).
[15] « Quand Hollande abdique le pouvoir des Français dans les mains des androïdes de la Commission européenne, Jaurès lui tire l’oreille […] Quand Hollande soutient le gouvernement Netanyahou, il se fâche » in ibid.
[16] Tronche Sébastien, « Où l’on apprend que Jean-Luc Mélenchon voulait le siège de Jaurès à l’Assemblée nationale » in Site du journal Le Lab Europe 1 ; 2017 ; [https://lelab.europe1.fr/ou-lon-apprend-que-jean-luc-melenchon-voulait-le-siege-de-jaures-a-lassemblee-nationale-3380561] (consulté le 22/08/2019).
[17] « Interview exclusive d’Emmanuel Macron : « Je suis un patriote réformateur » » in Site du journal La Dépêche ; 2017 ; (https://www.ladepeche.fr/article/2017/05/03/2567441-interview-exclusive-d-emmanuel-macron-je-suis-un-patriote-reformateur.html) (consulté le 22/08/2019). V. aussi Apel-Muller Patrick, « Comment Emmanuel Macron a kidnappé Jaurès » in Site du journal l’Humanité ; 2017 ; (https://www.humanite.fr/comment-emmanuel-macron-kidnappe-jaures-635748) (consulté le 22/08/2019).
[18] Il a été noté qu’aucun responsable politique national de l’extrême gauche (il en va ainsi des partis ou organisations politiques se réclamant du trotskysme) n’a cité ou n’a dit être inspiré par Jean Jaurès en 2007, en 2012 ou en 2017, pourtant Trotsky avait considéré en 1915 que Jaurès était bien un idéaliste démocrate même si la lutte des classes façon léniniste ne l’avait pas suffisamment gagné.
[19] Selon Florian Gougou, historien, cité par Le Figaro « les évolutions du vote des ouvriers sont portées par le renouvellement des générations » et « le recul du vote de gauche des ouvriers [est alimenté] par l’arrivée de nouvelles cohortes dans le champ électoral, qui n’ont jamais eu des habitudes de vote à gauche […] Ces nouvelles cohortes votent de plus en plus pour le Front national. Ce ne sont pas les mêmes ouvriers qui hier votaient pour la gauche qui aujourd’hui votent pour le FN » in site du Figaro ; 2014 ; (https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/07/31/01016-20140731ARTFIG00091-quand-le-front-national-reprend-jaures.php) (consulté le 23/08/2019).
[20] Nitkowski Octave, « Quand le Front national cite Jaurès » in Blog d’Octave Nitkowski ; 2014 ; [https://www.huffingtonpost.fr/octave-nitkowski/quand-le-front-national-cite-jean-jaures_b_4670481.html] (consulté le 17/08/2019) : « Le Front national à la sauce Marine Le Pen reprend non seulement, comme chacun le sait, des idées de gauche mais s’approprie désormais – chose nouvelle – l’imaginaire collectif de gauche ».
[21] Chanoir Yohann & Harlaut Yann, Convaincre comme Jean Jaurès : Comment devenir un orateur d’exception ; Paris, Eyrolles ; 2014.
[22] Jaurès Jean, Le socialisme et la vie : Idéalisme et matérialisme ; Paris : Editions Payot & Rivages ; 2011 ; p. 83.
[23] Candar Gilles, « Jaurès en campagne » in Site de la société d’études jaurésiennes ; 2007 ; p. 3 ; (http://www.jaures.info/bibliotheque/File/etudes/Candar-Jaures-Sarkozy.pdf?PHPSESSID=e9cd28ba18abff6477acf79b38189479) (consulté le 08/08/2019).
[24] Chamayou Grégoire, « Marine Le Pen et la fausse citation de Jaurès » in Site du journal Libération ; 2011 ; (https://www.liberation.fr/france/2011/01/21/marine-le-pen-et-la-fausse-citation-de-jaures_708831) (consulté le 17/08/2019).
[25] Extrait du discours de Jean Jaurès prononcé au Congrès de la Sfio à Toulouse en 1908. V. « Raphaël Glucksmann falsifie Jean Jaurès pour son premier meeting » in Site du média agauche.org ; 2019 ; (https://agauche.org/2019/04/07/raphael-glucksmann-falsifie-jean-jaures-pour-son-premier-meeting/) (consulté le 23/08/2019).
[26] Jaurès Jean, « Les idées politiques et sociales de Jean-Jacques Rousseau » in Revue de Métaphysique et de Morale ; 1912 ; n°3, p. 371 et s.
[27] Jaurès Jean, « Les idées politiques et sociales de Jean-Jacques Rousseau » in Revue de Métaphysique et de Morale ; 1912 ; n°3, p. 371 et s., édition numérique réalisée par Bertrand Gibier, publiée sur le Site de l’Université de Québec à Chicoumi ;
[http://classiques.uqac.ca/classiques/jaures_jean/idees_politiques_Rousseau/idees_politiques_Rousseau.html] (consulté le 23/08/2019).
[28] Ibid.
[29] Ibid.
[30] Ibid.
[31] Ibid.
[32] Ibid.
[33] Ibid.
[34] Candar Gilles, « Jaurès en campagne » in Site de la société d’études jaurésiennes ; 2007 ; p. 3 ; (http://www.jaures.info/bibliotheque/File/etudes/Candar-Jaures-Sarkozy.pdf?PHPSESSID=e9cd28ba18abff6477acf79b38189479) (consulté le 08/08/2019).
[35] Monod Jean-Claude, « Il y a du Ricœur dans Macron, le socialisme en moins » in Site du journal Libération ; 2017 ; (https://www.liberation.fr/debats/2017/10/23/il-y-a-du-ricoeur-dans-macron-le-socialisme-en-moins_1605122) (consulté le 23/08/2019).
[36] Ibid.
[37] Jaurès Jean, « La politique » in La Dépêche ; 23 janvier 1980.
[38] Ibid.
[39] Monod Jean-Claude, « Il y a du Ricœur dans Macron, le socialisme en moins » in Site du journal Libération ; 2017 ; (https://www.liberation.fr/debats/2017/10/23/il-y-a-du-ricoeur-dans-macron-le-socialisme-en-moins_1605122) (consulté le 23/08/2019).
[40] Jaurès Jean, « Les idées politiques et sociales de Jean-Jacques Rousseau » in Revue de Métaphysique et de Morale ; 1912 ; n°3, p. 371 et s., édition numérique réalisée par Bertrand Gibier, publiée sur le Site de l’Université de Québec à Chicoumi ;
[http://classiques.uqac.ca/classiques/jaures_jean/idees_politiques_Rousseau/idees_politiques_Rousseau.html] (consulté le 23/08/2019).
[41] Jaurès Jean, Le socialisme et la vie : Idéalisme et matérialisme ; Paris : Editions Payot & Rivages ; 2011 ; p. 66.
[42] Jaurès Jean, Le socialisme et la vie : Idéalisme et matérialisme ; Paris : Editions Payot & Rivages ; 2011 ; p. 137.
Nota Bene : le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pourrez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).