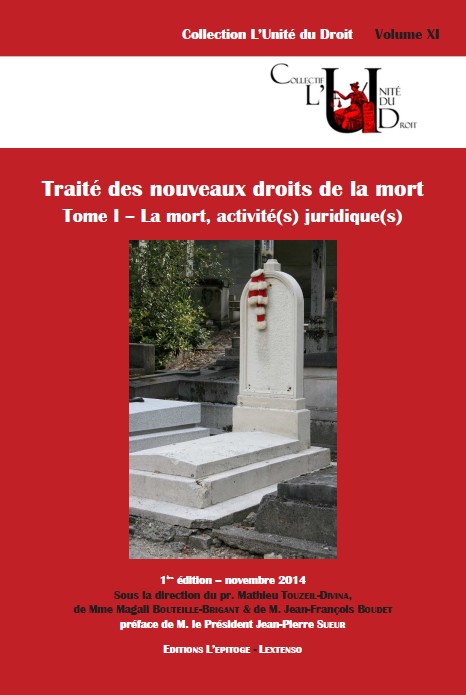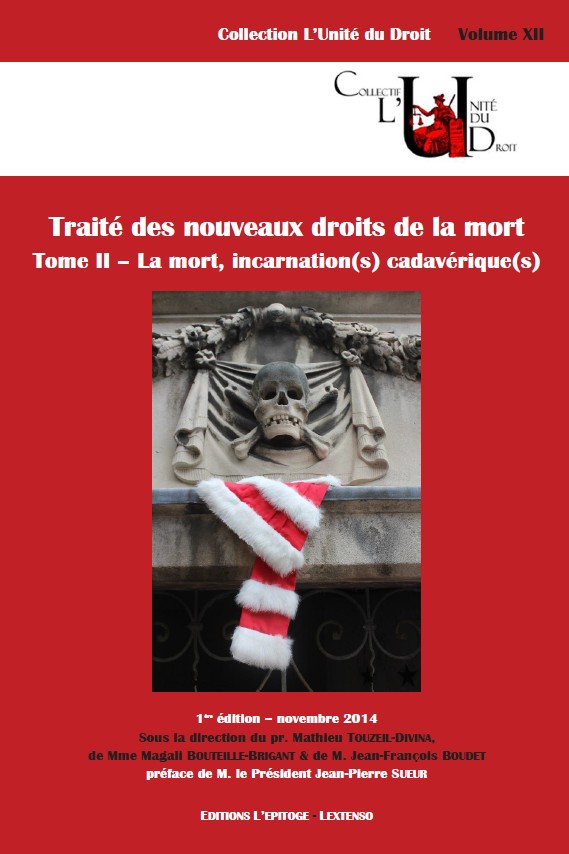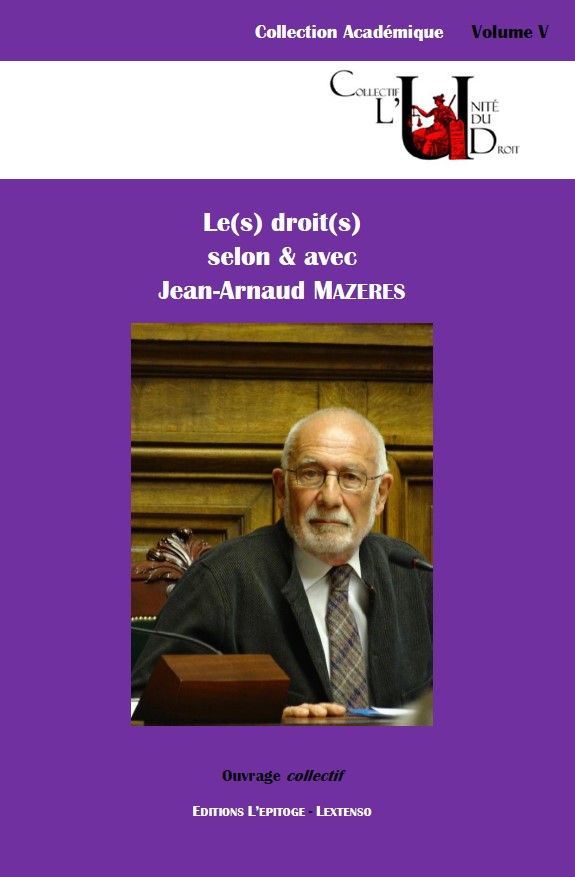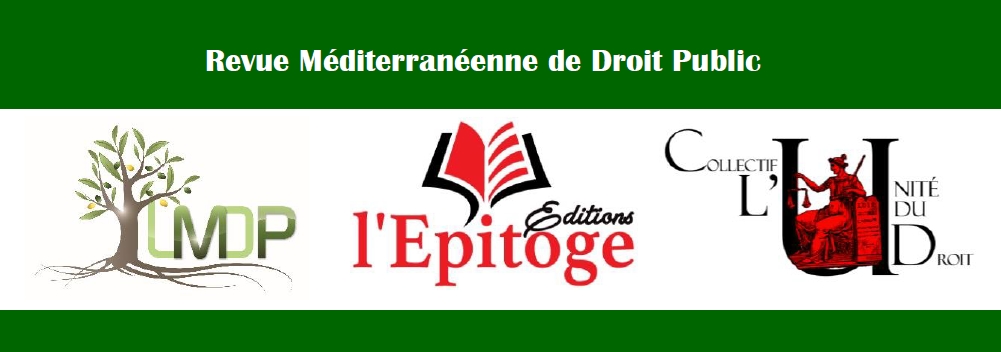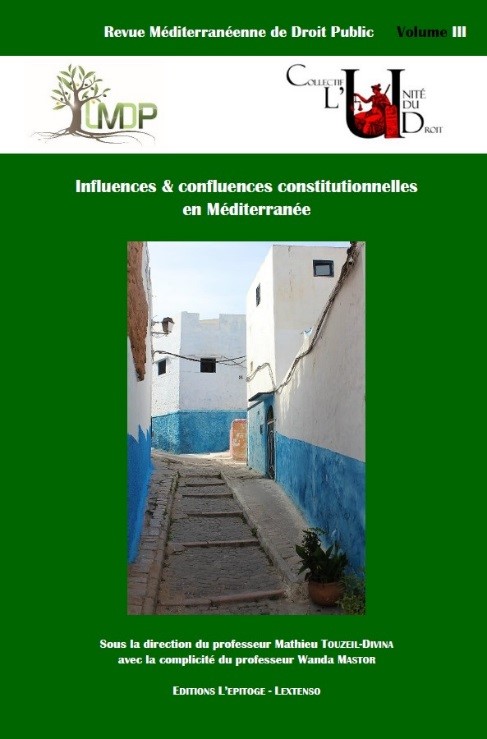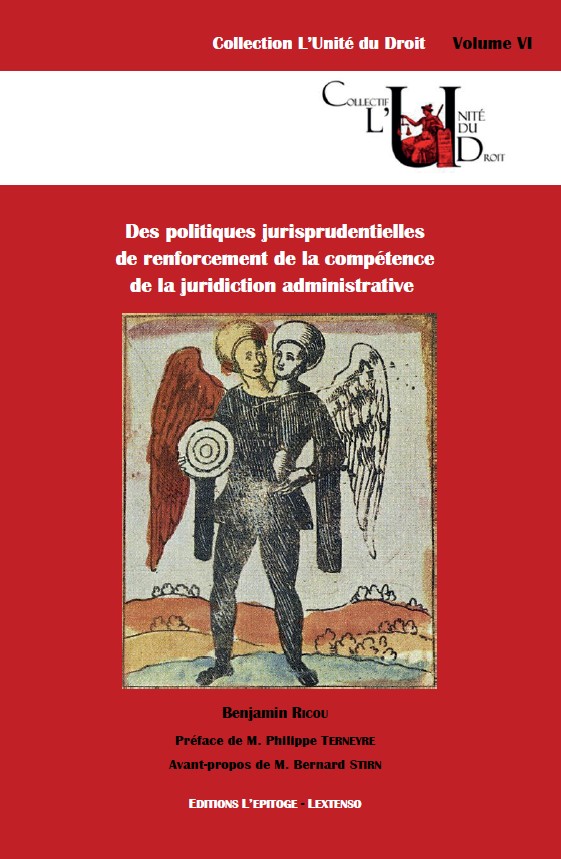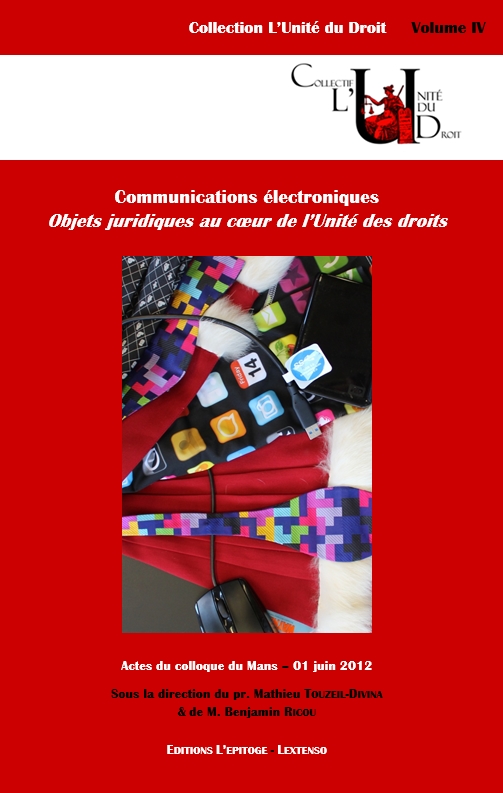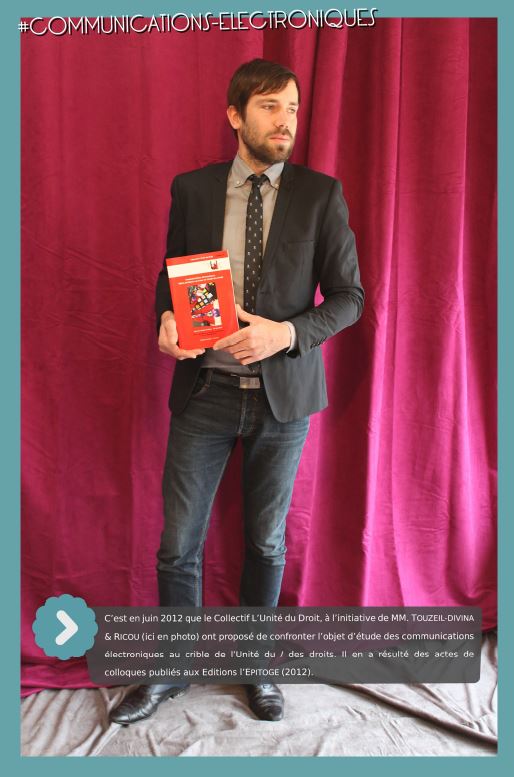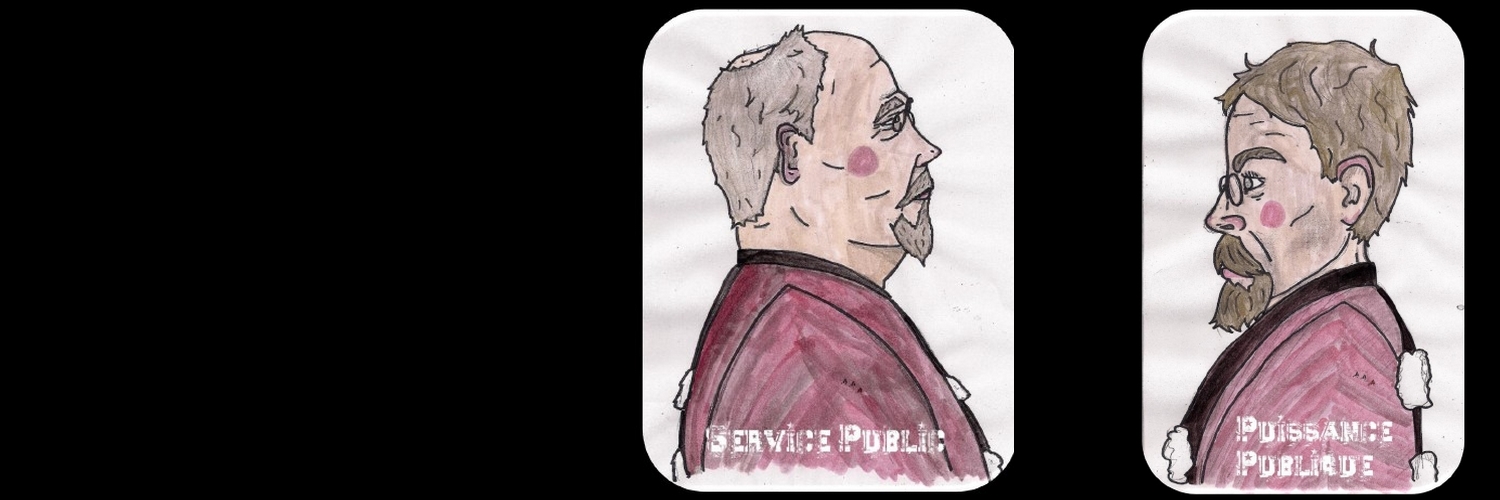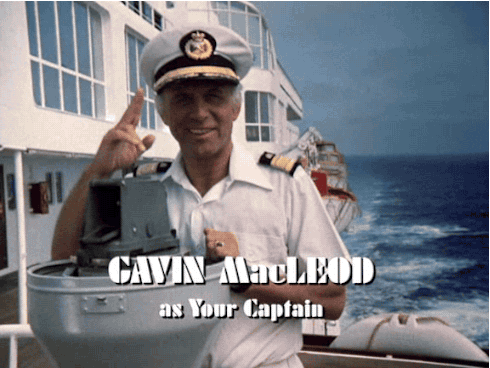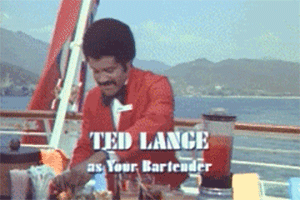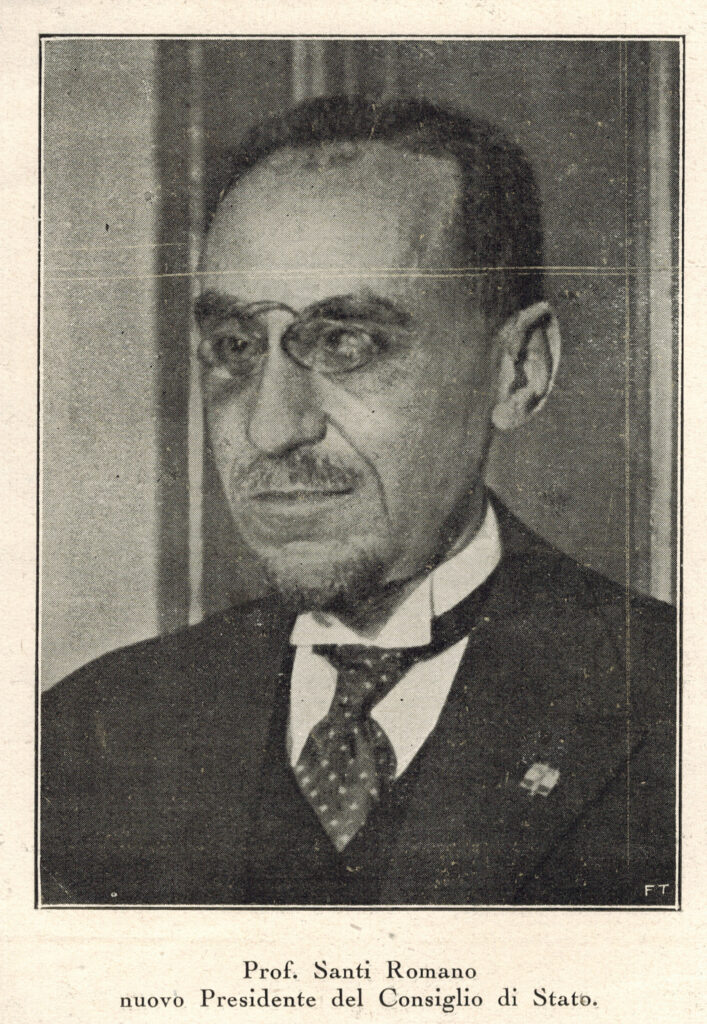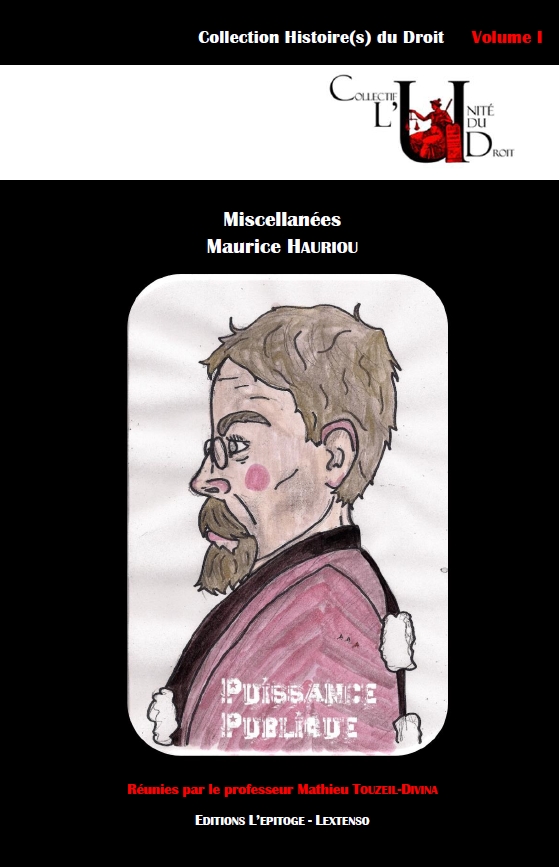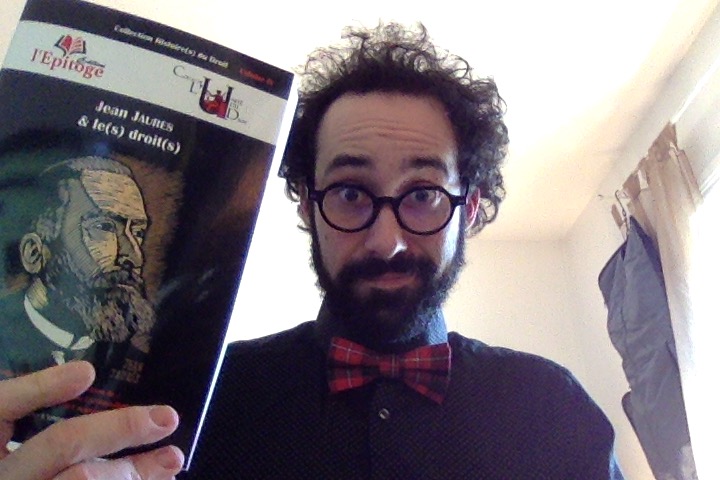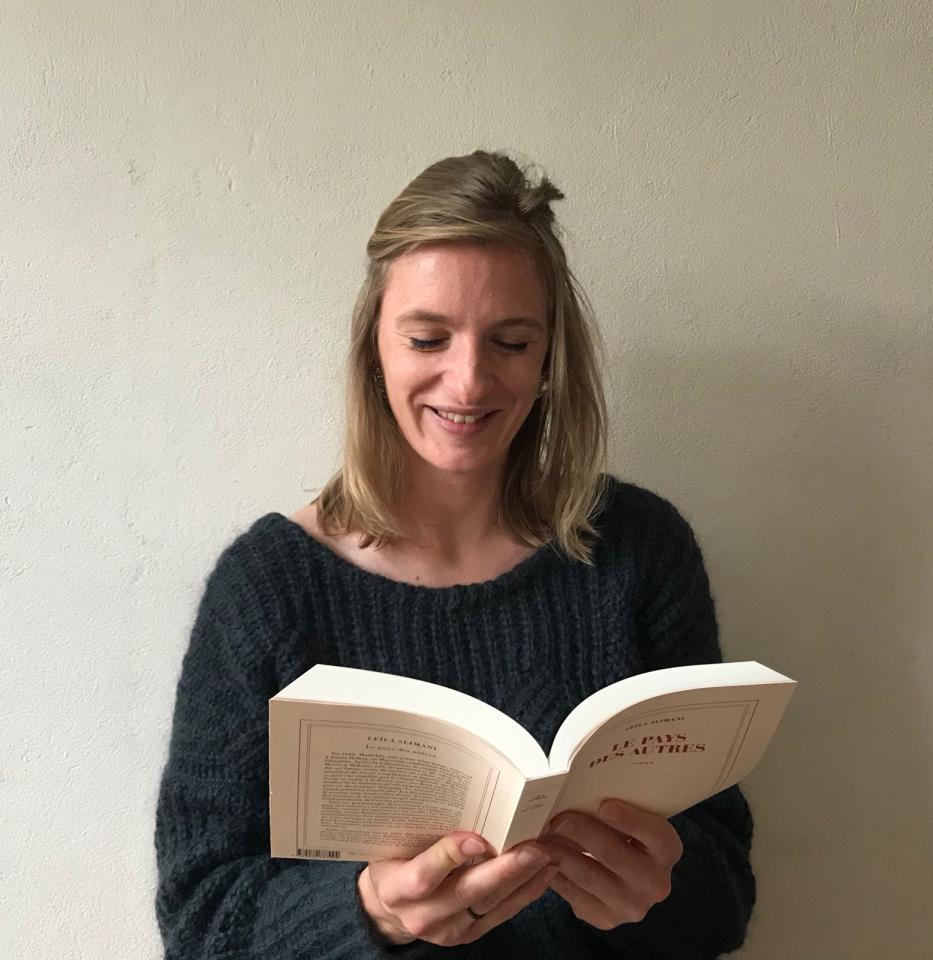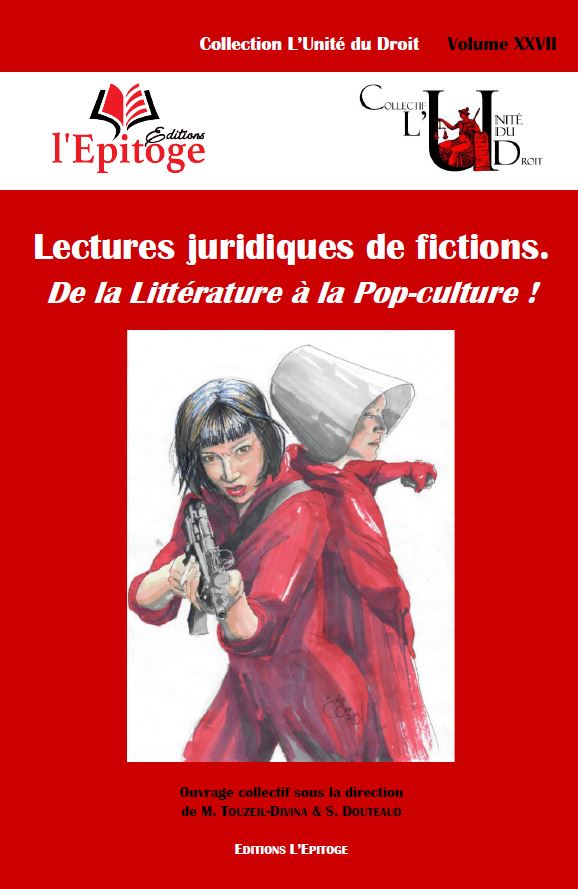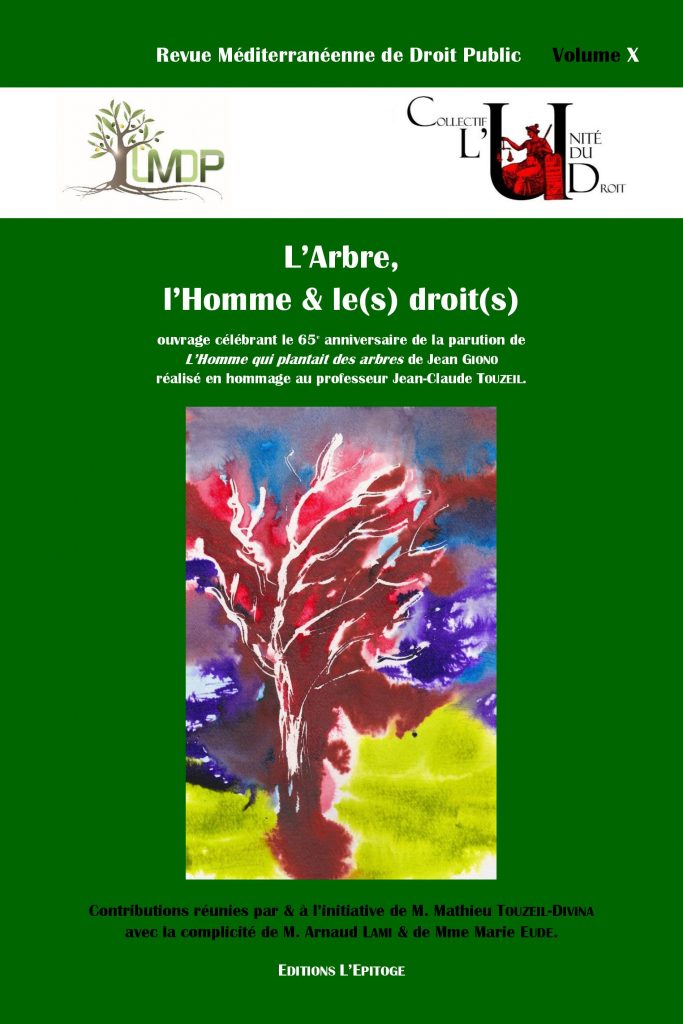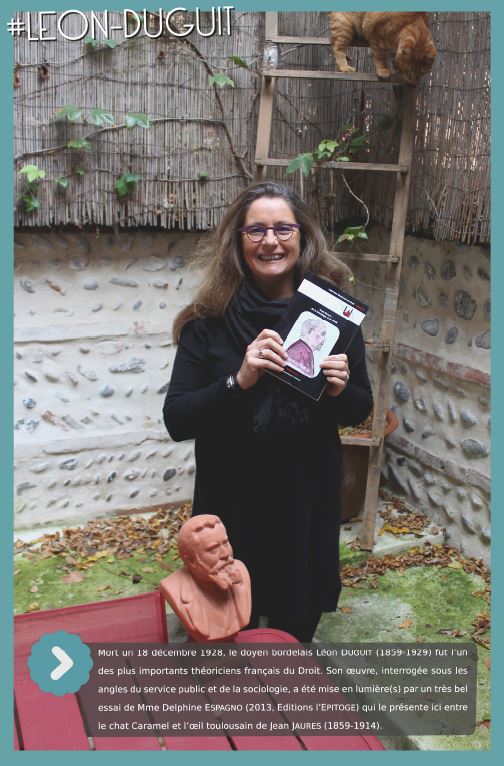Voici la 54e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 3e livre de nos Editions dans la collection dite verte de la Revue Méditerranéenne de Droit public publiée depuis 2013.
Cet ouvrage est le troisième issu de la collection
« Revue Méditerranéenne de Droit Public (RM-DP) ».
En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :
Volume III :
Influences & confluences
constitutionnelles en Méditerranée
Ouvrage collectif
(dir. Laboratoire Méditerranéen de Droit Public
Mathieu Touzeil-Divina & Wanda Mastor)
– Nombre de pages : 236
– Sortie : juillet 2015
– Prix : 39 €
ISBN / EAN : 979-10-92684-07-0 / 9791092684070
ISSN : 2268-9893
Présentation :
Le présent ouvrage doit sa réalisation et sa publication à un appel à contributions du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public (LM-DP). Une quinzaine de textes a ici été sélectionnée, à l’aveugle, par un comité scientifique. Les contributions proviennent des différents rivages de la méditerranée et vous sont présentées en langue française, langue de travail du LM-DP, mais aussi (en fin d’ouvrage) sous forme de résumés en langues anglaise, arabe (littéraire) et italienne. Le présent volume forme ainsi le troisième numéro de la Revue Méditerranéenne de Droit Public (RMDP). En effet, après un numéro pilote (RMDP I) consacré à des premiers éléments bibliographiques de droit public méditerranéen et un deuxième numéro (RMDP II), fruit des actes du colloque « Droits des femmes et révolutions arabes », notre Revue part cette fois à l’assaut des influences – mais aussi des confluences – constitutionnelles en Méditerranée et c’est un beau voyage que nous vous proposons ainsi de faire à nos côtés. Il ne vous reste qu’à embarquer en gardant toujours à l’esprit que le réseau LM-DP, porteur de ce projet, n’appartient à aucun pays et n’a embrassé aucun dogme. Il entend voguer où le vent le conduira et avec les voyageurs et les capitaines qui voudront bien s’y consacrer. Bienvenue à bord !
Qu’ont retenu l’Egypte, la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, la Libye, la Syrie pour ne citer qu’eux de leurs histoires passées ? En quoi ce printemps était-il un « réveil » pour emprunter un terme souvent utilisé ? En quoi certains régimes, certaines Constitutions étaient-ils « transitoires » ? Une religion érigée au statut d’ « officielle » est-elle un obstacle à la liberté de croyance ? Le régime parlementaire y a-t-il un sens ? Pendant longtemps, le droit constitutionnel comparé des pays francophones du sud se limitait à l’étude du mimétisme constitutionnel déjà évoqué. Les peuples ont pu se libérer du joug de certains dictateurs, mais on se libère difficilement du poids du passé. Pour cette raison, le bassin méditerranéen est un formidable laboratoire de droit comparé. Les vents semblent y souffler de toute part ; ceux des anciennes colonies ou protectorats, ceux des cultures locales, de l’Islam, des droits économiques et sociaux, du droit international. Les vents de l’importé, l’exporté, le voulu, le subi, le conscient, l’inconscient. Les influences et confluences. Autant de souffles qui font la richesse et la complexité de ces pays voisins. Nous ne savons s’il existe un droit méditerranéen, et nous ne sommes, de manière générale, pas favorable à la globalité, l’universalité des définitions. Nous sommes convaincus en revanche qu’il y a un noble objet de recherche, et que les contributions qui suivent en sont la preuve.
Les Constitutions Provisoires,
une catégorie normative atypique
au cœur des transitions constitutionnelles en Méditerranée
Nicoletta Perlo
Maître de conférences, Université Toulouse I Capitole
membre du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, les Pays du bassin méditerranéen, et notamment les rives européenne et africaine, ont connu des transitions constitutionnelles d’ampleur, passant de régimes politiques autoritaires à des régimes démocratiques. Ces Pays présentent ainsi un grand intérêt pour l’étude comparative des périodes instables des transitions constitutionnelles démocratiques.
L’analyse des processus complexes, conduisant à la disparition d’un régime politique autoritaire et à l’instauration d’un régime démocratique, impose au juriste d’étudier l’ensemble des normes, matériellement et formellement constitutionnelles, qui contribuent au changement axiologique de l’ordre juridique. La succession de deux ordres constitutionnels ne saurait pas se réduire, en effet, à l’abrogation formelle de l’ancien ordre et à l’entrée en vigueur du nouveau. Bien au contraire, la transition se caractérise par des phases, marquées par l’adoption d’une pluralité d’actes juridiques, qui mettent fin au régime précédent, instaurent un régime intermédiaire et provisoire et conduisent à l’adoption de la nouvelle Constitution. La consolidation des institutions démocratiques conclut le processus transitionnel[1].
La présente étude retient ainsi une définition bien précise de la « transition »[2], excluant toutes les transformations politico-constitutionnelles qui ne conduisent pas à un changement radical du régime politique[3], ainsi que tout processus conduisant à l’affirmation d’un ordre juridique autoritaire[4]. En outre, nous limitons notre analyse à une phase spécifique du processus transitionnel, celle se situant entre l’abrogation de l’ordre juridique déchu et l’adoption de la nouvelle Constitution démocratique.
Ce stade intermédiaire de la transition a longtemps été oublié par la doctrine, qui a considéré cet « interrègne constitutionnel »[5] comme relevant du pur fait et non pas du droit, étant donné que, dans cette phase, aucune norme fondamentale stabilisée ne semble fonder un ordre juridique globalement efficace et sanctionné[6]. A partir de 1945, toutefois, quelques auteurs[7] commencent à s’intéresser aux actes normatifs adoptés dans cette période.
Ce réveil d’intérêt est lié aux grandes transformations politico-juridiques qui marquent l’après guerre. La reconnaissance du suffrage universel et l’affirmation des grands partis politiques de masse changent sensiblement la fonction de la Constitution ainsi que les procédures de son adoption. Désormais, le texte constitutionnel est un instrument d’intégration de sociétés plurielles et la phase pré-constituante se complexifie dans le but d’atteindre le consensus politique et social qui, seul, est capable de fonder une communauté civile et politique. Par conséquent, le stade intermédiaire de la transition dure plus longtemps et très souvent se caractérise par l’adoption de textes matériellement constitutionnels.
Les « interrègnes » des transitions démocratiques des Etats riverains de la Méditerranée suivent bien cette tendance. En particulier, l’Italie, la France, le Portugal, l’Espagne, l’Albanie, la Tunisie, l’Egypte et la Libye ont adopté, dans cette phase de la transition, des textes juridiques atypiques, que nous appelons « Constitutions provisoires »[8]. Ces actes, fondateurs d’un ordre constitutionnel provisoire, encadrent les gouvernements provisoires[9] et organisent l’adoption de la Constitution définitive. Ils donnent ainsi une réponse immédiate à l’exigence de rétablir l’ordre et la paix, ils attribuent une légitimité démocratique à l’autorité de fait et représentent des laboratoires précieux pour la conception de nouvelles solutions d’ingénierie constitutionnelle, respectueuses de l’Etat de droit. Par conséquent, l’étude des Constitutions provisoires contribue à la réflexion sur la nature et les fondements juridiques des transitions démocratiques ainsi qu’à l’approfondissement des procédures constituantes.
L’analyse comparative des Constitutions provisoires méditerranéennes permet, tout d’abord, d’identifier cette catégorie normative atypique, dont la validité est limitée dans le temps et le contenu, matériellement constitutionnel, est caractérisé par la présence de dispositions bien spécifiques (I). La comparaison nous conduit ensuite à étudier la raison d’être de tels actes. Au-delà de la fonction de pacification politique et sociale, celle de légitimation occupe une place centrale dans l’élaboration de ces textes. Par les Constitutions provisoires, des gouvernants auto-proclamés légitiment leur pouvoir et contribuent à la légitimation de la Constitution définitive, assurant ainsi l’effectivité du nouvel ordre constitutionnel et la réussite de la transition (II).
I. L’identification des Constitutions provisoires
Les Constitutions provisoires contredisent, sous deux profils, la catégorie normative traditionnelle de « Constitution ». Elles ne sont pas adoptées pour durer dans le temps, ayant, bien au contraire, une validité limitée (A). En outre, elles n’ont pas la forme constitutionnelle, étant donné que, le plus souvent, elles sont adoptées par des actes infra-constitutionnels. Toutefois, leur contenu est matériellement constitutionnel et présente des caractéristiques uniques, qui font des Constitutions provisoires une catégorie normative atypique du droit constitutionnel (B).
A. Une validité limitée dans le temps
La notion de « Constitution provisoire » semble former en soi un oxymore. Selon l’idéologie constitutionnaliste, la Constitution est en effet un texte normatif fondé sur un pacte collectif et volontaire qui doit s’inscrire dans la durée afin de construire un ordre stable de l’Etat. Toutefois, l’expérience nous oblige à constater que la vocation à la perpétuité des Constitutions modernes n’est qu’illusoire, les équilibres institutionnels et sociaux évoluant sans cesse et pouvant produire des ruptures et des renouveaux constitutionnels répétés. Or, si la Constitution éternelle n’est pas une donnée réelle, pourrait-on considérer que toutes les Constitutions sont, au fond, provisoires, puisque destinées, à termes, à être remplacées par un autre texte constitutionnel ? Dans ce cas, la distinction entre une Constitution « provisoire » et une Constitution « définitive » serait dépourvue de tout fondement.
Cependant, ce qui relève ici pour l’identification de la Constitution provisoire, n’est pas la durée effective de la validité du texte, mais l’intention originaire du constituant. Une Constitution « provisoire » est un texte qui est expressément conçu pour prévoir des règles à validité temporaire. En ce sens, elle contient les dispositions qui, de façon expresse ou parfois implicite, prévoient et organisent sa disparition. En quelque sorte, il s’agit d’un texte créé pour s’autodétruire, une fois sa mission remplie[10].
La fin de la validité du texte constitutionnel intérimaire correspond, en général, au moment de l’adoption de la Constitution définitive. Toutefois, chaque transition, selon ses exigences propres, peut renvoyer à des événements politico-juridiques différents.
En particulier, les Etats qui adoptent une Constitution provisoire lorsque les conflits sont encore en cours, ont tendance à lier l’échéance du texte non seulement à un acte juridico-constitutionnel précis, mais aussi à un fait historico-politique déterminé, comme la défaite de l’adversaire ou bien la libération du territoire national. Ainsi, en Italie, le décret-loi luogotenenziale du 25 juin 1944, n°151[11], adopté dans un pays encore en guerre, réglemente l’exercice du pouvoir législatif « jusqu’à l’élection du nouveau Parlement »[12], c’est-à-dire, une fois le territoire national libéré, le choix sur la forme républicaine ou monarchique de l’Etat opéré et la nouvelle Constitution adoptée par une Assemblée constituante élue à suffrage universel direct[13]. De même, la Déclaration constitutionnelle libyenne du 3 août 2011[14] organise la disparition des institutions et du texte constitutionnel provisoires « après la déclaration de libération »[15], c’est-à-dire une fois la chute du régime de Kadhafi déclarée.
En revanche, les autres pays méditerranéens se sont dotés de Constitutions provisoires une fois la guerre ou les conflits civils terminés. La validité du texte intérimaire se prolonge alors jusqu’à l’adoption de la Constitution définitive. Parfois, cette référence est explicite, comme dans le cas de la loi portugaise n°3 du 14 mai 1974[16] ou bien de la « Law on Major Constitutional Provisions » du 29 avril 1991[17], qui a régi la période intérimaire de la transition démocratique albanaise. D’autres fois, l’intention du constituant est implicite, mais elle peut être déduite de l’ensemble des dispositions constitutionnelles. C’est notamment le cas, en France, de la loi du 2 novembre 1945[18], qui prévoit que les pouvoirs attribués à l’Assemblée constituante expireront « le jour de la mise en application de la nouvelle Constitution […] ». Puisque l’Assemblée exerce des fonctions à la fois constituantes et législatives, il est évident qu’une fois la Constitution définitive adoptée, la réglementation provisoire perd sa validité. La Ley para la Reforma politica espagnole du 15 décembre 1976[19], approuvée par les Cortes organicas franquistes, n’explicite pas non plus la fin de sa validité. Le contenu de la Ley, toutefois, ne ment pas : elle rompt de façon nette avec le régime autoritaire en affirmant les principes d’un Etat démocratique, en prévoyant l’institution d’un Parlement bicaméral et en réglementant les aspects essentiels du processus législatif[20]. La Ley pose alors les bases pour la future organisation des élections générales et l’adoption d’une nouvelle Constitution. De même, la Déclaration constitutionnelle égyptienne du 30 mars 2011[21] révèle implicitement la nature provisoire de son pouvoir constituant. L’article 60 prévoit en effet l’élection d’une Assemblée constituante qui « préparera un nouveau projet de Constitution pour le pays […] » et l’article 61 établit un terme aux prérogatives exceptionnelles exercées par le Conseil suprême des forces armées pendant la période intermédiaire.
La transition tunisienne présente, enfin, la particularité d’avoir conduit à l’adoption de deux constitutions provisoires, fondatrices de deux ordres constitutionnels provisoires distincts au sein de la même période intermédiaire. Par conséquent, les deux textes lient leurs disparitions respectives à des événements différents. Le décret-loi du 23 mars 2011[22], adopté par le Président de la République par intérim, prévoit que sa validité se termine suite à l’élection de l’Assemblée nationale constituante[23]. En revanche, la Loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011[24], adoptée par une commission ad hoc de l’Assemblée constituante nouvellement élue, lie sa disparition à l’adoption de la nouvelle Constitution[25].
B. Un contenu matériellement constitutionnel
Le deuxième aspect qui permet d’identifier une Constitution provisoire est le contenu de ce texte. La forme de la norme, en effet, n’est pas un critère fiable, étant donné que, très souvent, il s’agit d’actes pour lesquels n’ont pas été prévues des procédures d’adoption et/ou de révision renforcées[26]. Fréquemment, ils sont issus d’un acte unilatéral émis par la nouvelle autorité de fait, qui, en dehors de toute légitimation démocratique[27], s’auto-attribue le pouvoir constituant provisoire. Même si les constituants consacrent presque toujours les textes en tant que « lois constitutionnelles »[28], cette prévision ne saurait pas suffire en l’absence de conditions renforcées pour la révision de leurs dispositions. Dans l’espace méditerranéen, seuls deux Etats ont adopté une Constitution provisoire formellement constitutionnelle. Il s’agit de l’Albanie[29] et de la Lybie[30].
La raison pour laquelle les Constitutions provisoires sont si rarement dotées d’une forme constitutionnelle est à rechercher dans leur nature de textes « relais » [31], adoptés provisoirement pour accompagner et régir le passage d’un ordre juridique à un autre. Après une révolution, un coup d’Etat, une guerre civile, les Constitutions provisoires représentent la toute première formalisation de l’équilibre précaire atteint entre les acteurs civils, politiques et militaires de la transition. Ces textes sont issus d’un pacte politique, formel[32] ou informel, négocié entre les parties, qui fixe les règles de la trêve institutionnelle et sociétale provisoirement atteinte. En cela, les Constitutions provisoires sont une illustration éclairante des théories institutionnalistes[33]. Si l’adoption de la Constitution définitive, strictement encadrée par des règles et des procédures démocratiques, peut faire oublier que ce texte existe en vertu d’un ordre concret qui le précède et qui l’exprime, la Constitution provisoire, adoptée dans l’urgence par des pouvoirs dépourvus souvent de toute légitimité démocratique, nous dévoile les procédures institutionnelles de la vie de l’Etat, qui se tissent inlassablement entre chaque discontinuité constitutionnelle[34]. La Constitution provisoire, en tant qu’acte juridique volontaire, fixe, formalise l’ensemble normatif matériel, issu de la composition des tensions en présence[35]. De par ses règles, ce texte marque un tournant décisif de la transition : il fonde un ordre constitutionnel provisoire, en déterminant une césure nette avec le régime juridique précédent, en organisant les institutions provisoires et en encadrant la procédure constituante pour l’adoption d’une Constitution définitive. Les dispositions des textes provisoires ont alors une dimension temporelle très particulière : elles règlent le passé, organisent le présent et préparent le futur. En cela, les Constitutions provisoires présentent un contenu typique, matériellement constitutionnel, qui permet de les identifier en tant que telles.
L’étude des Constitutions provisoires méditerranéennes semble conforter cette analyse. En premier lieu, les textes provisoires, dans la plupart des cas, se positionnent explicitement par rapport aux ordres juridiques précédents[36]. Les constituants provisoires prévoient : ou bien le maintien en vigueur des normes constitutionnelles du régime précédent, dans le respect des nouvelles dispositions provisoires[37] ; ou bien la suspension de la validité de la norme fondamentale de l’ordre autoritaire[38] ; ou encore l’abrogation définitive[39].
Tous les textes méditerranéens organisent ensuite un système constitutionnel provisoire. En ce sens, les Constitutions provisoires sont des véritables laboratoires, offrant la possibilité aux gouvernants d’expérimenter des nouveaux mécanismes constitutionnels démocratiques. La forme de gouvernement parlementaire est souvent privilégiée, puisqu’elle est considérée comme la plus à même de marquer la rupture avec le régime dictatorial[40]. Cependant, dans de nombreux cas, l’institution immédiate d’un ordre entièrement démocratique se révèle impossible. Dans des contextes encore troublés, l’exigence de maintien de l’ordre rend parfois nécessaire l’établissement d’un exécutif très fort ou la concentration des pouvoirs dans les mains d’un seul organe, au détriment des principes de l’Etat de droit[41]. Les dispositions régissant une procédure constituante démocratique sont alors la promesse du passage à une phase ultérieure, stabilisée, dans laquelle un régime démocratique pourra être réalisé.
Les Constitutions méditerranéennes plus récentes, et notamment, celles albanaise, libyenne et égyptienne, présentent un autre trait caractéristique. Ces textes contiennent des catalogues de droits et de libertés fondamentaux très fournis, même en l’absence d’institutions qui puissent garantir leur application effective. Les constituants provisoires manifestent ainsi leur volonté de rompre radicalement avec le passé autoritaire et semblent préconiser les fondements du pacte constitutionnel à venir. Cela revêt une fonction de légitimation démocratique des institutions provisoires très importante, à la fois, à l’intérieur et à l’extérieur du pays. D’une part, les nouvelles forces dominantes rassurent les citoyens sur le changement radical qui s’annonce, malgré la persistance, très souvent, d’un régime provisoire foncièrement autoritaire. D’autre part, les pouvoirs provisoires se légitiment vis-à-vis de la communauté internationale, manifestant leur volonté de se rallier aux principes fondateurs du constitutionnalisme et à la doctrine des droits de l’homme.
Enfin, toutes les Constitutions provisoires méditerranéennes encadrent la procédure constituante qui conduira à l’adoption d’une nouvelle Constitution, achevant la transition démocratique. Les procédures instituées s’organisent toutes autour d’une élection à suffrage universel, qu’elle soit législative ou bien constituante, gage de la légitimité démocratique de la nouvelle norme suprême. Dans la plupart des cas, les textes prévoient l’élection directe d’une Assemblée constituante, à laquelle sont souvent attribués d’autres pouvoirs[42]. Dans d’autres cas, la Constitution provisoire prévoit que la Constitution définitive soit adoptée par une commission issue de l’assemblée législative[43].
L’étude de ces textes, nous conduit à constater que, souvent, la Constitution provisoire est formée par plusieurs actes juridiques, qui, adoptés tout au long de la période intermédiaire de la transition, contribuent à intégrer ou bien à amender le premier acte constitutionnel adopté. La phase d’interrègne peut en effet durer longtemps et, bien évidemment, les équilibres entre les forces en présence évoluent. Les révisions du pacte originaire sont alors souhaitables, étant donné que cette période est consacrée à rechercher un accord capable de fonder une communauté civile et politique stabilisée. Dans les cas où une pluralité d’actes contribue à régler le statut de l’ordre juridique précédent, à organiser le système constitutionnel provisoire et à encadrer la procédure constituante, nous considérons qu’il existe un « bloc de constitutionnalité provisoire »[44].
La transition démocratique portugaise, par exemple, s’est déroulée au travers d’une succession d’actes à valeur constitutionnelle qui, réunis, en vertu de leurs contenus, forment bien un bloc constitutionnel provisoire[45]. De même la transition albanaise, dont la phase intermédiaire a duré sept ans, se caractérise par un ensemble de textes successifs qui complètent et amendent la Law on Major Constitutional Provisions[46]. En Espagne, la Ley para la reforma politica est complétée par une série d’actes indispensables pour préparer le terrain à l’organisation d’élections libres et démocratiques[47]. En Italie, bien que la doctrine majoritaire considère que deux Constitutions provisoires ont régi la transition démocratique[48], nous estimons que le décret-loi n° 151/1944 et le décret législatif n° 98/1946 forment un bloc unique, un seul ordre constitutionnel provisoire ayant existé pendant cette période[49]. En France, enfin, nous considérons que la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945, communément définie par la doctrine comme la Constitution provisoire[50], fait en réalité partie d’un bloc constitutionnel, formé également par l’ordonnance du 9 août 1944, portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental. Les deux textes sont adoptés par le même organe, le Gouvernement provisoire de la République française, et, ensemble, contribuent, d’abord, en 1944, à régler le passé, en déclarant l’inexistence juridique du gouvernement Pétain, et ensuite, en 1945, une fois la guerre terminée, à organiser le présent et préparer l’avenir d’un nouvel ordre constitutionnel.
II. La fonction légitimante des Constitutions provisoires
Les Constitutions provisoires fournissent une réponse à deux enjeux primordiaux, communs à toutes les transitions : le rétablissement de l’ordre public et de la paix sociale et la légitimation du nouveau gouvernement et de ses actes juridiques. Les deux défis sont étroitement liés. La légitimité du pouvoir et des actes normatifs influence en effet l’effectivité du nouvel ordre juridique[51], avec des conséquences importantes sur le maintien de l’ordre. La légitimation des gouvernements provisoires et de leurs actes est donc la fonction la plus importante des Constitutions provisoires (A). L’analyse systématique des textes nous révèle ensuite les stratégies de légitimation adoptées par les forces en présence, afin de mener à bien la transition démocratique (B).
A. Une fonction multidirectionnelle
La fonction légitimante des Constitutions provisoires concerne, à la fois, le gouvernement provisoire (i) et la Constitution définitive (ii).
i. La légitimation du gouvernement provisoire
Si les citoyens croient en la légitimité des nouveaux gouvernants, ils adhéreront plus facilement au nouveau projet politique, en se soumettant aux règles édictées pour mener à bien la transition démocratique[52].
Mais comment un gouvernement issu d’une révolution ou d’un conflit interne peut induire la croyance des citoyens en sa légitimité, autrement dit en son bon droit d’exercer le pouvoir et d’adopter régulièrement des actes juridiques ? Avant l’adoption de toute Constitution provisoire, en effet, le nouveau gouvernement est un gouvernement de fait, c’est-à-dire qu’il s’installe en dehors de toute procédure encadrée[53] et n’est initialement soumis à aucune limitation juridique de ses prérogatives[54].
Suivant la réflexion de Max Weber, deux options de légitimation sont possibles dans ce cas[55]. La croyance en la légitimité du nouveau pouvoir et de ses actes peut s’établir en vertu du charisme extraordinaire du leader de la transition[56], ou elle peut se fonder sur « la légalité des règlements arrêtés et du droit de donner des directives qu’ont ceux qui sont appelés à exercer la domination »[57].
Sans doute, un leader charismatique peut jouer un rôle très important pour la réussite de la transition, en légitimant son gouvernement et l’ensemble du processus démocratique de par la force de son exemplarité et de son histoire politique et personnelle. Toutefois, dans les pays méditerranéens analysés, les transitions ont été menées plus par des forces collectives, représentées par des institutions comme l’armée, les partis démocratiques opposés aux régimes précédents et les monarques[58].
L’approche légale-rationnelle wébérienne semble ainsi permettre une analyse plus adaptée aux cas méditerranéens. Le respect par les pouvoirs en place de règles qu’ils ont eux-mêmes établies et auxquelles ils se sont volontairement soumis, contribue de façon déterminante au processus de légitimation des nouvelles institutions et des normes adoptées. Ainsi, l’entrée en vigueur de la Constitution provisoire permet, à la fois, de transformer un gouvernement de fait en gouvernement de droit et de légitimer ainsi les institutions de la période intermédiaire. Le texte crée en effet un ordre constitutionnel, bien que provisoire, qui limite les prérogatives des organes du pouvoir, en devenant le paramètre de la légalité des actions de ces derniers.
Toutefois, dans le cadre des transitions démocratiques, la légitimité d’un gouvernement ne saurait pas correspondre tout simplement à sa légalité, c’est-à-dire à son respect d’une norme supérieure, en faisant abstraction de son contenu et des valeurs véhiculées par celle-ci[59]. Si la légitimité est une relation de conformité entre l’idée que l’on se fait de ce que doivent êtreles normes et le pouvoir dont elles émanent et ce qu’ils sont réellement[60], la légitimité démocratique implique que les détenteurs du pouvoir et les lois adoptées soient conformes aux souhaits de la majorité, dans le respect des droits de l’homme. Certes, la légalité des normes ainsi que du pouvoir qui les adopte contribuent à renforcer leur légitimité et leur effectivité, mais une norme légale ou un pouvoir légal peuvent être illégitimes au vu des valeurs démocratiques[61].
La Constitution provisoire contribue alors à légitimer les nouveaux pouvoirs à la condition qu’elle soit fidèle à la philosophie de la révolution dont elle est issue. Elle doit suspendre ou abroger l’ordre juridique autoritaire pour instituer un nouvel ordre, inspiré des principes de l’Etat de droit. S’explique ainsi la tendance actuelle des constituants provisoires d’inscrire dans les Constitutions provisoires des véritables catalogues de droits et de libertés[62]. L’organisation des institutions provisoires doit également répondre aux exigences démocratiques en ce qui concerne leur mandat et leur fonctionnement. Sur ce point les expériences diffèrent, puisque l’instabilité de la période intermédiaire peut rendre nécessaire le recours à des compromis qui, tout en allant au détriment du caractère démocratique du système, sont essentiels pour la réussite de la transition. Deux éléments demeurent incontournables pour assurer la légitimité démocratique du gouvernement provisoire : la prévision d’élections libres et sincères, à suffrage universel direct, et l’organisation d’une procédure constituante impliquant la participation des citoyens.
Exception faite pour le texte albanais[63], la totalité des Constitutions provisoires méditerranéennes annonce et réglemente la tenue d’élections. Or, l’élection peut concerner les institutions provisoires, si la Constitution provisoire est adoptée par un pouvoir auto-proclamé[64], et/ou l’Assemblée constituante[65].
Quant à la procédure constituante, pour en assurer le caractère démocratique, dans l’espace méditerranéen, deux solutions sont adoptées : l’Assemblée constituante est élue par le peuple, par un scrutin capable de représenter l’ensemble des forces politiques de la Nation[66] ; ou bien le pouvoir législatif, directement élu, nomme une Commission chargée d’élaborer un projet de Constitution[67]. L’approbation de la Constitution peut inclure la participation directe du peuple, via un référendum[68], ou bien comporter un vote, à une large majorité, de l’organe élu[69], représentant des citoyens.
ii. La légitimation de la Constitution définitive
La fonction légitimante de la Constitution provisoire n’est pas limitée au gouvernement provisoire, mais elle s’étend également au pouvoir constituant et à la Constitution définitive. A ce titre, une précision s’impose. La relation entre la Constitution provisoire et la Constitution définitive doit être analysée à l’aune de la notion de « légitimité » et non pas de celle de « légalité ». Légale est une norme qui est conforme à la norme supérieure. Or, la Constitution provisoire ne fonde pas la validité-légalité de la Constitution définitive. La Constitution provisoire et la Constitution définitive fondent deux ordres juridiques, distincts et séparés. Certes, la Constitution provisoire pose des règles concernant la procédure constituante et parfois impose des contenus au texte constitutionnel définitif, mais cela ne lie pas le pouvoir constituant définitif, qui reste juridiquement libre dans son action. Les contraintes prescrites sont d’ordre politique et leurs conséquences juridiques doivent être appréciées en termes de légitimité.
Ainsi, la conformité procédurale et substantielle de la Constitution définitive aux règles établies par la Constitution provisoire est un facteur important de légitimité pour la norme constitutionnelle finale, puisque, suivant toujours l’approche wébérienne, elle peut induire les individus à croire à la légalité de la procédure suivie et à la légalité du texte adopté. Soyons clairs, la croyance en la légalité ne signifie pas que la norme est réellement légale[70], mais cela induit les destinataires de la norme à la considérer comme légitime et donc à s’y soumettre, garantissant l’effectivité du système. Dans les transitions que nous étudions, la légitimité est aussi fonction du caractère démocratique des procédures constituantes et des principes affirmés par la Constitution provisoire.
Certes, la Constitution provisoire est seulement l’un des facteurs de légitimation de la Constitution définitive. Pendant la procédure constituante, et tout au long de la période intermédiaire, les équilibres politiques et sociaux évoluent sans cesse, donnant vie à des nouveaux ordres informels, à des nouvelles « constitutions matérielles », selon l’expression de Mortati. L’intensité du rapport de légitimation entre la Constitution provisoire, d’une part, et le pouvoir constituant et la Constitution définitive, d’autre part, est alors étroitement liée à la capacité de la première de refléter l’ensemble des règles informelles exprimées par l’équilibre des forces politico-sociales en présence, tout au long de la période intermédiaire[71]. Cela explique la création diffuse de blocs constitutionnels provisoires. L’ordre provisoire adapte ses règles aux changements sociaux et politiques, induits souvent par l’organisation d’élections législatives ou constituantes.
La transition portugaise en est un exemple. Entre le premier texte du bloc constitutionnel provisoire, adopté le 14 mai 1974, et le dernier, la deuxième Plateforme constitutionnelle du 26 février 1976, les équilibres entre les acteurs de la transition ont fortement changé. Si dans une première phase le Mouvement des forces armées est le moteur de la Révolution, après les élections législatives, il en devient un simple garant, laissant la place aux forces politiques et civiles[72]. Les règles de la procédure constituante accompagnent donc l’évolution des rapports entre les forces politiques, jusqu’à ce que ces rapports soient traduits en droit par la Constitution définitive.
B. Une fonction inscrite dans la stratégie transitionnelle
La fonction de légitimation des Constitutions provisoires est étroitement liée à la stratégie adoptée par les forces dominantes afin de mener à bien la transition démocratique. L’analyse juridique permet en effet de constater que ces actes traduisent en droit le choix politique opéré entre deux typologies principales de transition : la transition « par compromis » et la transition « par élimination du régime précédent » [73]. Nous pouvons alors identifier deux typologies de Constitutions provisoires : les Constitutions provisoires « de la continuité » et les Constitutions provisoires « de la rupture ».
Statistiquement, la première typologie est plus fréquente que la deuxième. Les transitions démocratiques par compromis, en effet, ont plus de chances de réussite. Les accords atteints entre les tenants de l’ancien régime et les vainqueurs permettent de dégager un consensus pacifiant, qui peut jeter des bases solides pour une coexistence future et durable entre tous les membres de la société (i). En revanche, l’élimination des vaincus de toute forme d’exercice du pouvoir et de toute participation à la reconstruction de l’Etat peut, certes, fortifier, dans un premier temps, les vainqueurs, mais, sur le long terme, elle peut engendrer des déséquilibres importants. La société reste, en effet, divisée, puisque fondée sur le principe d’exclusion d’une partie à l’avantage des autres[74] (ii). Les transitions démocratiques en Méditerranée confirment cette tendance.
i. Les Constitutions provisoires « de la continuité »
La plupart des Constitutions provisoires étudiées sont l’instrument d’une stratégie légitimante consistant à faire apparaître qu’une partie de la procédure constituante est fondée sur les normes de l’ordre juridique précédent. Bien entendu, il ne s’agit que d’une fiction, puisque le nouvel ordre provisoire introduit, dans tous les cas, un régime politique et une forme d’Etat nouveaux, porteurs d’une conception différente de la relation entre les gouvernants et les gouvernés et de la finalité de l’action publique. Toutefois, dans le cadre de transitions où le régime précédent bénéficie encore d’une certaine légitimité et les forces opposées ne sont pas assez fortes pour s’imposer l’une à l’autre, la prétendue continuité entre les deux ordres sert les intérêts d’une transition négociée et pacifique. La dissimulation de la rupture de l’ordre juridique assure un effet de légitimation, bien que partiel : la Constitution provisoire apparaît légitime puisque le pouvoir qui l’a adoptée, en apparence, ne viole pas les règles de l’ordre constitutionnel déchu. Ainsi, la procédure constituante régie par ce texte acquière une légitimité qu’elle transmet par ricochet à la Constitution définitive. Le rattachement au passé ne saurait, toutefois, pas suffire à légitimer la transition démocratique. Pour cela, il faut que, en même temps, la volonté d’instaurer un régime démocratique soit clairement annoncée par la Constitution provisoire et que, en ce sens, soient enclenchées des procédures électorales législatives et constituantes.
Ainsi, en 2011, les tunisiens, dans la première phase de la transition, tentent de passer à un nouvel ordre constitutionnel dans le respect de la Constitution du régime précédent. L’intention des nouvelles forces dominantes est celle d’attribuer le pouvoir législatif au nouveau Président intérimaire. Puisque, toutefois, cela constitue une violation manifeste de la Constitution de 1959, des mesures « d’ingénierie constitutionnelle »[75] sont élaborées afin de garantir une légalité apparente, alors que, dans les faits, elles contournent les règles constitutionnelles. L’apparente continuité constitutionnelle est toutefois gage de légitimité pour le Président par intérim, qui, fort de cette assise, le 23 mars 2011, adopte un décret-loi[76], qui fonde le premier ordre constitutionnel provisoire. Cette première Constitution provisoire, en dépit de la fiction procédurale, formalise l’exigence d’un changement radical de la forme d’Etat et organise le passage vers un régime démocratique attribuant la souveraineté au peuple.
La transition démocratique espagnole a été aussi conduite en passant par un texte de rupture dissimulée. Après la mort du dictateur Franco, la faiblesse des parties opposées, la volonté de paix de la plupart des espagnols et l’engagement du roi en faveur du changement[77] conduisent le gouvernement Suarez à mettre en place une stratégie juridique capable d’assurer une transition intégrant, à la fois, l’opposition et les franquistes. La Ley para la Reforma politica est approuvée par les Cortes organicas franquistes dans le respect de la procédure de révision prévue par la Constitution de la dictature. Sous le voile de la légalité franquiste, cet acte constitutionnel, en cinq articles, rompt de façon nette avec le régime autoritaire affirmant la suprématie de la loi, la souveraineté populaire et l’inviolabilité des droits[78]. La voie vers l’approbation d’une Constitution démocratique définitive est ainsi ouverte.
De même, en Italie, le pouvoir constituant provisoire de 1944 s’appuie largement sur la légitimité de l’ordre monarchique pour fonder la légitimité du bloc constitutionnel provisoire, qui, de fait, change radicalement la forme de l’Etat italien[79]. Les decreti luogotenenziali imposent, en effet, l’organisation d’un référendum qui conduit à la proclamation de la République et contiennent des dispositions qui préconisent la nouvelle forme d’Etat démocratique et pluraliste.
Il est à noter que dans cet ensemble de cas, le pouvoir constituant provisoire est un organe de l’ordre précédent. Cela nourrit davantage la fiction et a une fonction de pacification indéniable. Toutefois, cet organe, au moment où la transition vers un nouvel ordre a été enclenchée, n’est plus investi par l’ordre juridique précédent. Désormais, il agit « comme un organe provisoire du nouvel ordre »[80].
ii. Les Constitutions provisoires « de la rupture »
La Constitution provisoire de la rupture entend manifester la disparition formelle et matérielle du régime précédent. Elle est alors adoptée par un organe totalement nouveau, délié du régime précédent.
L’étude des cas concrets nous dévoile, cependant, que la réalité est toujours plus ambiguë des modèles « purs » que les juristes peuvent élaborer pour essayer de comprendre, de façon synthétique, des phénomènes complexes. Si les Constitutions de la continuité cachent une césure constitutionnelle et institutionnelle profonde avec le régime précédent, les Constitutions de la rupture sont souvent issues et modelées par des compromis, conclus entre les nouveaux pouvoirs et les tenants de l’ancien régime[81]. Ce sont d’ailleurs ces compromis qui, souvent, assurent la réussite de la transition. La rupture, comme la continuité, n’est donc qu’apparente, un instrument au service d’une stratégie de légitimation dont la Constitution provisoire est le fidèle miroir.
Le passage du régime de Vichy à la IVe République française est l’exemple d’une transition conduite par des textes constitutionnels de très forte rupture. Une rupture qui passe tout d’abord par la négation de l’existence juridique du gouvernement de Vichy, réduit au simple rang d’autorité de fait par l’article 7 de l’ordonnance du 9 août 1944. La césure avec le passé n’est toutefois pas si radicale. Le gouvernement provisoire de 1944, autoproclamé à la veille du débarquement des Alliés en Normandie, et incarné par le Comité français de la Libération nationale, tente de renouer avec les lois constitutionnelles de 1875, qui juridiquement demeurent en vigueur[82]. La volonté, manifestée dans l’intitulé de l’ordonnance de 1944, de rétablir la légalité républicaine, montre le désir de fonder la légitimité d’un gouvernement nouveau et révolutionnaire sur la légalité de la IIIe République[83]. En réalité, le ralliement au passé n’est que symbolique, puisque la structure du gouvernement provisoire ne se conforme pas aux dispositions de 1875. Une fois le conflit terminé, l’organisation du référendum du 21 octobre 1945, marque la rupture définitive avec l’ordre constitutionnel de 1875. Les Français s’expriment en faveur de l’adoption d’une nouvelle Constitution et la loi du 2 novembre 1945 organise la procédure constituante et encadre les institutions provisoires selon des principes tout à fait nouveaux.
La Constitution provisoire portugaise est aussi un exemple éclairant de cette typologie de textes. Suite au coup d’Etat militaire soutenu par le peuple qui, en 1974, met fin au régime autoritaire de Salazar, un pouvoir nouveau, le Mouvement des Forces Armées, adopte l’ensemble des actes constitutionnels provisoires. La procédure constituante est organisée dès 1975, au travers de deux « Plateformes d’accord constitutionnel ». La première est conçue unilatéralement par les militaires et imposée par le MFA aux partis politiques. La deuxième intervient après l’élection de l’Assemblée constituante (25 avril 1975) et elle est issue d’un accord bilatéral entre le MFA et les partis politiques. Elle conduit à la formation d’une Assemblée constituante politiquement hétérogène, qui, sans aucune intervention politique des militaires, approuve la Constitution définitive du 2 avril 1976.
La transition constitutionnelle égyptienne n’est pas issue d’un coup d’Etat militaire, mais elle a également été régie par les forces armées en rupture manifeste avec le régime précédent. Sous la pression populaire, le président Moubarak cède le pouvoir au Conseil suprême des Forces armées, qui dans un premier temps agit dans la continuité du régime précédent, adoptant des amendements à la Constitution de 1971, approuvés par référendum le 19 mars 2011. Dix jours après, toutefois, le Conseil s’érige en pouvoir constituant provisoire édictant une Déclaration constitutionnelle qui rompt de façon nette avec l’ancien régime et introduit un nouvel ordre constitutionnel provisoire. De nombreuses institutions du régime précédent sont toutefois maintenues, notamment la magistrature et la Cour constitutionnelle. La rupture impose ainsi la coexistence entre les tenants de l’ancien régime et les fondateurs du nouvel ordre, ce qui oblige la recherche permanente de compromis pour pouvoir gouverner[84].
En Albanie, la rupture symbolique avec le régime précédent est évidente. La Constitution provisoire du 21 mai 1991 est adoptée par un Parlement pluraliste, issue des premières élections libres depuis soixante-six ans. Le texte supprime toute référence au « socialisme » et fonde un ordre constitutionnel provisoire inspiré des principes de l’Etat de droit et basé sur un régime parlementaire. Toutefois, l’analyse des dynamiques politiques qui ont régi la transition nous dévoile qu’en réalité les tenants de l’ancien régime n’ont pas été éliminés du système. Bien au contraire, l’ancien parti communiste unique de la République populaire socialiste d’Albanie gagne les premières élections législatives et le premier secrétaire du parti, Ramiz Alia, est élu Président de la République. Un gouvernement de coalition est alors formé et cela conduit à l’adoption de la Constitution provisoire, qui est donc issue d’un compromis entre les nouvelles forces politiques et les anciennes. La stabilisation des équilibres tardera à s’établir. Des périodes de « règlements des comptes » avec le passé viendront[85], mais la Constitution définitive, sept ans après, sera l’expression d’un consensus politique et social capable d’intégrer les forces du passé.
Le cas libyen constitue, en revanche, un exemple de rupture radicale et sans compromis avec le passé. Cela s’explique par le fait que la chute du régime de Mouammar Kadhafi laisse un véritable vide institutionnel et constitutionnel dans le pays. D’une part, les institutions politiques n’avaient d’autre légitimité que celle dérivant du pouvoir charismatique du Guide et aucun mouvement d’opposition politique structuré n’existait au moment de la révolution[86]. D’autre part, aucun texte constitutionnel n’était en vigueur en 2011[87]. Ainsi, après l’effondrement du régime, toute continuité institutionnelle et juridique était matériellement impossible et la création d’organes politiques, complètement nouveaux, s’est imposée. Dès février 2011, est constitué le Conseil national de transition, uneautorité politique qui devait conduire le combat contre le régime et régir la transition post-conflit. Préconisant la fin de Kadhafi, le 3 août 2011, le Conseil adopte une Déclaration constitutionnelle pour régir la phase de reconstruction post-conflictuelle. Toutefois, dès les élections législatives du 7 juillet 2012, les tensions dans le pays augmentent. L’absence d’une société civile dotée d’une culture politique et démocratique, la persistance d’une structure sociétale presque féodale, les revendications autonomistes dans l’Est du pays et l’expansion de l’intégrisme religieux sont parmi les facteurs ayant contribué à casser l’unité des acteurs qui avaient combattu Kadhafi et son régime. Une fois la libération déclarée, « les alliés d’hier deviennent les ennemis d’aujourd’hui »[88] et, quatre ans après la révolution, l’échec de la transition démocratique est incontestable[89].
[1] Pour Jean-Pierre Massias, le Droit constitutionnel de la transition démocratique recouvre « l’ensemble des processus constitutionnels ayant pour objet, d’une part, le remplacement des normes constitutionnelles totalitaires par des normes constitutionnelles démocratiques et, d’autre part, l’application effective de ces normes » (Id., Droit constitutionnel des Etats d’Europe de l’Est ; Paris, Puf ; 2008 ; p. 38).
[2] La notion de « transition » acquière de multiples significations non seulement au sein des différentes disciplines des sciences humaines et sociales, mais aussi au sein même de la discipline juridique. V. De Vergottini Giuseppe, Le transizioni costituzionali ; Bologne, Il Mulino ; 1998 ; p. 162-163.
[3] Le passage de la IVe à la Ve République française est donc exclu de notre champ d’étude.
[4] Nous associons, en effet, le constitutionnalisme à la notion de Constitution moderne, en considérant que, désormais, la notion de Constitution ne peut être appréciée qu’à l’aune de cette idéologie. En ce sens, V. Beaud Olivier, La puissance de l’Etat ; Paris, Puf ; 1994 ; p. 259 ; Rubio Llorente Francisco, « Constitucion (derecho constitucional) » in Enc. Juridica basica ; Civitas, Madrid ; vol. I ; 1995 ; p. 1525.
[5] Carré de Malberg Raymond, Contribution à la théorie générale de l’Etat ; Paris, Sirey ; 1922 (réimpression par Cnrs 1962) ; p. 497.
[6] Bobbio Norberto, Teoria della norma giuridica ; Turin, Giappichelli; 1958 ; p. 4.
[7] Mortati Costantino, La Costituente, Roma, 1945; Quoc Dinh Nguyen, « La loi du 2 novembre 1945 » in Rdp, 1946, p. 68 ; Prelot Marcel, Précis de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1949, p. 307 ; Onida Valerio, « Costituzione provvisoria » in Digesto Discipline pubblicistiche, vol. IV, Torino, 1990 ; Beaud Olivier, La puissance de l’Etat, op. cit., p. 267 ; Zimmer Willy, « La loi du 3 juin 1958 : contribution à l’étude des actes pré-constituants » in RDP, 1995, p. 385 ; Pfersmann Otto, in Favoreu Louis et al., Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2006, p. 101 ; Cartier Emmanuel, « Les petites Constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel transitoire » in RFDC, n°3, 2007, p. 513-534 ; Massias Jean-Pierre, Droit constitutionnel des Etats d’Europe de l’Est, op. cit., p. 17.
[8] Par le passé, la doctrine a utilisé d’autres appellations pour définir ces textes à valeur constitutionnelle, et notamment celles de « pré-constitutions » (Beaud Olivier, La puissance de l’Etat ; op. cit. ; p. 267), « constitutions transitoires » (Pech Laurent, « Les dispositions transitoires en droit constitutionnel » in Rrj, 1999, p. 1412) et « petites constitutions » (Pfersmann Otto, in Favoreu Louis et al., Droit constitutionnel, op. cit., p. 101; Cartier Emmanuel, « Les petites Constitutions », cit., p. 513-534).
[9] On distingue le Gouvernement, qui représente le pouvoir exécutif, du gouvernement, qui désigne l’ensemble des gouvernants de l’Etat qui possède le pouvoir politique.
[10] L’étymologie du mot « provisoire » rend compte du caractère particulier de cette typologie normative. Dans une étude consacrée à la notion de « provisoire », Paul Amselek explique que ce mot naît comme dérivé du terme juridique « provision », qui, au XVe siècle, renvoyait à une décision judiciaire provisoire, adoptée « avant que la décision à prendre soit arrêtée définitivement ». Le but de la provision était de « pourvoir à des besoins immédiats plus ou moins urgents pendant la période d’attente, mais aussi de préparer ou d’aider la prise de mesures définitives » (Id., « Enquête sur la notion de provisoire » in Rdp ; 2009 ; n°1, p. 7-11). Pour cette raison nous privilégions l’expression de « Constitution provisoire » à d’autres appellations. Elle permet, en effet, de mettre en exergue la temporalité spécifique de ces textes, ainsi que leur fonction de relais entre deux ordres normatifs.
[11] Une fois la guerre terminée, ce décret-loi est amendé et intégré par le décret législatif luogotenenziale n°98 du 16 marzo 1946 (G. U. n°69 du 23 mars 1946).
[12] Art. 4.
[13] Art. 1.
[14] Texte en française disponible sur : http://mjp.univ-perp.fr/constit/ly2011.htm.
[15] Art. 30.
[16] Préambule à la loi, in Diario do Governo, n°112, I Série, 14 mai 1974, pp. 620-622, https://dre.pt.
[17] L’art. 44, 1er al. Traduction en anglais du texte sur : http://eudo-citizenship.eu.
[18] Art. 6, loi cit., JORF du 3 novembre 1945 p. 7159.
[19] BOC, n°4, 5 janvier 1975.
[20] Kaminis Georges, La transition constitutionnelle en Grèce et en Espagne ; Paris, Lgdj ; 1993 ; p. 143-149.
[21] http://mjp.univ-perp.fr/constit/eg2011a.htm.
[22] JORT, n°20 du 25 mars 2011.
[23] Art. 1er.
[24] JORT, n°97 des 20 et 23 décembre 2011.
[25] Art. 1er.
[26] Selon la théorie de la hiérarchie des normes, en effet, « il y a forme constitutionnelle dès lors qu’il existe une procédure spécifique et renforcée de la production normative ». Favoreu Louis et al., Droit constitutionnel ; op. cit. ; p. 73.
[27] Trois cas font exception à cette absence de légitimation démocratique. La loi constitutionnelle française du 2 novembre 1945 est adoptée par l’Assemblée constituante élue le 21 octobre 1945, dans le respect d’un projet approuvé par un référendum populaire. La deuxième Constitution provisoire tunisienne (Loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011) est adoptée par l’Assemblée constituante démocratiquement élue le 23 octobre 2011. En Albanie, la Constitution provisoire du 29 avril 1991 est adoptée par le premier Parlement pluraliste issu des élections libres du 31 mars 1991.
[28] Deux cas font exception : le décret-loi n° 151/1944 italien (art. 6) et la première constitution provisoire tunisienne (art. 1er), qui ont la valeur de simples décrets-lois.
[29] Art. 43, Law on Major Constitutional Provisions.
[30] Art. 36, Déclaration constitutionnelle de 2011.
[31] Cartier Emmanuel, « Les petites Constitutions » ; op. cit. ; p. 523.
[32] Le décret-loi italien n° 151/1944 est issu du « Pacte de trêve institutionnelle » conclu entre l’ensemble des partis antifascistes et le chef du gouvernement Badoglio en avril 1944. Au Portugal, la loi n° 3/1974 traduit en droit le Programme du Mouvement des Forces Armées (Mfa), qui est d’ailleurs annexé à la loi.
[33] Romano Santi, L’ordre juridique, (trad. Pierre Gothot et Lucien François), Paris, Dalloz, 1975 (1er éd. 1918) ; Hauriou Maurice, Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1923 (1re éd.), 1929 (2e éd.) ; Mortati Costantino, La costituzione in senso materiale, Milano, Giuffrè, 1940.
[34] V. Hauriou Maurice, Précis de droit constitutionnel ; Paris, Sirey ; 1929 (2e éd.) ; p. 254-255.
[35] La notion de Constitution au sens matériel développée par Costantino Mortati est à cet égard très éclairante. Pour Mortati, toute Constitution formelle est précédée par un ensemble normatif informel – la Costituzione materiale – qui ordonne, compose les tensions, conformément aux équilibres socio-politiques qui se sont formés au sein d’une société donnée, à un moment historique déterminé (Id., La costituzione in senso materiale ; op. cit. Pour une analyse critique de la théorie de Mortati, V. Laffaille Franck, « La notion de constitution au sens matériel chez Costantino Mortati » in Jus Politicum ; n°7 ; http://www.juspoliticum.com/La-notion-de-constitution-au-sens.html).
[36] La Déclaration constitutionnelle égyptienne fait exception. Elle ne « règle pas le passé », étant donné que l’application de la Constitution du régime précédent avait déjà été suspendue par un communiqué du Conseil suprême des forces armées du 13 février 2011. De même, en Italie, le décret-loi n° 151/1944, intervenant après la révocation de Mussolini par le roi et l’abolition de toutes les institutions fascistes par le décret-loi n° 175 du 2 août 1943, n’abroge pas l’ordre précédent, considéré comme déjà déchu.
[37] Art. 1er de la loi portugaise n° 3/74 ; art. 3 Dispositions transitoires de la Ley para la reforma politica espagnole.
[38] Le décret-loi tunisien n° 2011-14 affirme que désormais, « la pleine application des dispositions de la Constitution est devenue impossible ». L’ordre constitutionnel précédent est donc suspendu, comme il sera confirmé par l’art. 27 de la deuxième Constitution provisoire tunisienne.
[39] Art. 45 de la Law on Major Constitutional Provisions albanaise ; art. 34 de la Déclaration constitutionnelle libyenne ; art. 27 de la Loi constituante tunisienne n° 2011-6. En France, l’ordonnance du 9 août 1944 non seulement déclare nuls tous les actes constitutionnels du régime (art. 2), mais elle affirme le principe de l’inexistence juridique du gouvernement Pétain (Morabito Marcel, Histoire constitutionnelle de la France ; Paris, Lgdj ; 2014 (13e éd.) ; n° 405).
[40] C’est bien le cas en France, en Espagne, en Albanie et en Lybie.
[41] Dans la plupart des cas, le pouvoir exécutif détient un pouvoir très important (c’est le cas en Tunisie), pouvant exercer parfois aussi le pouvoir législatif (c’est le cas en Italie). Quand la transition démocratique est conduite par l’armée, celle-ci se dote de pouvoirs exceptionnels (c’est le cas au Portugal et en Egypte).
[42] C’est le cas de la transition italienne (art. 3, décret législatif n° 98/1946), de la transition française (art. 4, Loi du 2 novembre 1945), portugaise (art. 3 et 4, loi n° 3/1974) et libyenne (art. 30, Déclaration de 2011).
[43] C’est le cas de la transition albanaise (art. 44, Law on Major Constitutional Provisions) et égyptienne (art. 60, Déclaration constitutionnelle de 2011).
[44] Nous faisons référence ici à la notion de « bloc de constitutionnalité » élaborée par la doctrine française : Favoreu Louis, « Le principe de constitutionnalité. Essai de définition d’après la jurisprudence du Conseil constitutionnel » in Mélanges Charles Eisenmann ; Paris, Cujas ; 1975 ; p. 33 et s.
[45] De Vergottini Giuseppe, Diritto costituzionale comparato ; Padoue, Cedam ; 2013 ; p. 267.
[46] Frachery Thomas, « Le droit constitutionnel albanais à l’épreuve de la pratique des institutions » in RIDC ; 2007 ; n° 2, p. 340.
[47] Blanco Valdés-Vicente Sanjurjo Rivo Roberto L., « Per comprendere la transizione politica spagnola » in Gambino Silvio (dir.), Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche ; Milan, Giuffré ; 2003 ;
p. 458.
[48] V. Saccomanno Albino, « La transizione italiana : le costituzioni provvisorie » in Gambino Silvio (dir.), Costituzionalismo europeo ; op. cit. ; p. 397-414.
[49] Le décret italien de 1946 émane en effet de la même institution et n’abroge pas le décret-loi de 1944, mais il l’intègre et le modifie.
[50] Parmi d’autres : Gicquel Jean et Gicquel Jean-Eric, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 2011, p. 475 ; Morabito Marcel, Histoire constitutionnelle de la France, op. cit., n° 409 ; Cartier Emmanuel, La transition constitutionnelle en France (1940-1945), Paris, Lgdj, p. 543.
[51] « Plus une norme est légitime, plus elle a des chances d’être effective. Et plus elle est effective, plus l’image de ce qui doit être sera marquée par cette pratique et donc plus la norme sera légitime » (Cohendet Marie-Anne, « Légitimité, effectivité et validité » in Mélanges Pierre Avril ; Paris, Montchrestien ; 2001 ;
p. 226).
[52] Comme le constate Max Weber, « Tout véritable rapport de domination comporte un minimum de volonté d’obéir, par conséquent, un intérêt, intérieur ou extérieur, à obéir » (p. 285) et « Toutes les dominations cherchent à éveiller et à entretenir la croyance en leur légitimité » (p. 286). Id., Economie et société ; Paris, Plon ; 1995 ; t. 1.
[53] En ce sens, Charles Eisenmann souligne que le « pouvoir né d’une façon qui n’est ni irrégulière, c’est-à-dire contraire à des règles en vigueur, ni régulière, c’est-à-dire conforme à de telles règles ». Id., « Sur la légitimité juridique des gouvernements » in Ecrits de théorie du droit, de droit constitutionnel et d’idées politiques ; Paris, Ed. Panthéon-Assas ; 2002 ; p. 320.
[54] Maurice Duverger établit la différence entre un gouvernement de droit et un gouvernement de fait sur la base de l’existence dans le premier cas, et de l’inexistence dans le second d’« un ensemble de dispositions constitutionnelles qui viennent limiter leurs [des gouvernements] prérogatives et préserver les droits des individus », Id., « Contribution à l’étude de la légitimité des gouvernements de fait » in Rdp ; 1945 ;n°61,
p. 75.
[55] La troisième modalité de légitimation décrite par Max Weber, c’est-à-dire « l’observance sacrée de la tradition », ne concerne pas nos cas d’étude. V. Id., Economie et société ; op. cit ; p. 72.
[56] Idem, p. 326-329.
[57] Idem, p. 289.
[58] La transition française fait exception, étant donné que le charisme du Général de Gaulle a joué un rôle déterminant pour la légitimation du gouvernement provisoire et des premiers actes juridiques adoptés. Cependant, les élections législatives d’octobre 1945 modifient les équilibres et, à côté de la « légitimité historique du général », se dresse la légitimité démocratique des partis issus du suffrage universel (Morabito Marcel, Histoire constitutionnelle de la France ; op. cit. ; n° 409).
[59] En ce sens, Kelsen Hans, Théorie pure du droit (trad. Eisenmann Charles) ; Paris, Dalloz ; 1962 ; p. 280. V. également la conception positiviste de légitimité élaborée par Charles Eisenmann (Id., « Sur la légitimité juridique des gouvernements », cit., p. 322-325).
[60] Cohendet Marie-Anne, « Légitimité, effectivité et validité » ; op. cit. ; p. 203.
[61] Pour une critique de la conception positiviste de légitimité V. Troper Michel, « Le monopole de la contrainte légitime » in La théorie du droit, le droit, l’Etat ; Paris, Puf ; 2001 ; p. 251-265 et Habermas Jürgen, Théorie de l’agir communicationnel ; Paris, Fayard ; 1987 ; vol. 1, p. 272-276.
[62] V. supra.
[63] En effet, la Constitution provisoire albanaise a été adoptée par des organes élus, et donc déjà légitimés par le vote démocratique.
[64] Les art. 2 et 1er des Dispositions transitoires de la Ley para la Réforma Politica espagnole prévoient l’élection d’un Parlement nouvellement constitué, auquel est confié aussi le pouvoir constituant. Dans le cas égyptien, la Déclaration de 2011 organise l’élection de l’Assemblée du peuple et du Conseil consultatif (art. 41) ainsi que du Président de la République (art. 27). L’Assemblée constituante est nommée par la suite par l’Assemblée législatif et le Conseil consultatif réuni (art. 60). En Lybie, l’art. 30 de la Déclaration organise également les élections législatives après la fin des conflits.
[65] L’art. 4 de la loi constitutionnelle portugaise n° 3/1974 réglemente l’élection de l’Assemblée constituante, alors que les organes du gouvernement provisoire demeurent non élus. En Tunisie, la première Constitution provisoire se limite à prévoir l’élection d’une Assemblée constituante. Cette Assemblée, une fois élue, adopte la deuxième constitution provisoire et s’auto-attribue le pouvoir législatif.
[66] C’est le cas de l’Italie, de la France et de la Tunisie.
[67] C’est le cas de l’Espagne, du Portugal, de l’Albanie, de l’Egypte et de la Lybie.
[68] C’est le cas de la France, de l’Espagne et de l’Egypte (pour ce qui concerne la Constitution de 2012).
[69] C’est le cas de l’Italie, du Portugal, de la Tunisie et de l’Albanie.
[70] Comme l’affirme Charles Eisenmann : « si le premier acte constituant d’un Etat est susceptible de fonder un système légitime, ce n’est pas, ce ne peut pas être en raison de la légitimité juridique de sa naissance ». Id., « Sur la légitimité juridique des gouvernements » ; op. cit. ; p. 320.
[71] V. Zagrebelsky Gustavo, Manuale di diritto costituzionale, Il sistema delle fonti del diritto ; Turin, Utet ; 1988 ; vol. I, p. 29-31.
[72] Schmitter Philippe C., « La démocratisation au Portugal en perspective » in Mélanges Guy Hermet ; Paris, Karthala ; 2002 ; p. 291-315.
[73] Cette classification s’appuie sur les catégories établies par les politistes dans leurs études sur la transitologie (V. O’Donnell Guillermo, Schmitter Philippe C. et Whitehead Laurence, Transitions from Authoritarian Rule ; Londres,Jhu ;1986).
[74] V. Philippe Xavier, « Tours et contours des transitions constitutionnelles » in Philippe Xavier & Danelciuc-Colodrovschi Natasa (dir.), Transitions constitutionnelles et Constitutions transitionnelles ; op. cit. ; p. 17-18 ; Hermet Guy, Le passage à la démocratie ; Paris, Presses de la Fondation nationale de sciences politiques ; 1996 ; p. 77.
[75] Ben Achour Sana, « Le cadre juridique de la transition : entre légalité constitutionnelle et légitimité révolutionnaire », Nachaz Dissonances, décembre 2011, http://www.nachaz.org/index.php/fr/textes-a-l-appui/politique/34-sana1.html.
[76] JORT, n° 20 du 25 mars 2011.
[77] Blanco Valdés-Vicente Sanjurjo Rivo Roberto L., « Per comprendere la transizione politica spagnola » ;op. cit. ; p. 448-453.
[78] Kaminis Georges, La transition constitutionnelle en Grèce et en Espagne ; op.cit. ; p. 143-149.
[79] Pace Alessandro, « L’instaurazione di una nuova Costituzione » in Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi ; Padova, Cedam ; 2002 ; p. 159.
[80] Mortati Costantino, « La Costituente » in Raccolta di scritti ; Milano, Giuffré ; 1972 ;vol.I, p. 121.
[81] L’idée que la transition est guidée par la lutte entre démocrates et autoritaires « pèche par simplification » (Hermet Guy, Le passage à la démocratie ; op. cit. ; p. 74). Le sociologue Michel Dobry explique qu’à l’approche de l’explosion de la crise, des « transactions collusives » tendent à s’opérer entre les modérés et les extrémistes des deux camps (Dobry Michel, Sociologie des crises politiques ; Paris, SciencesPo Presses ; 2009 ; p. 112-116 et p. 304-317).
[82] Duverger Maurice, « Contribution à l’étude de la légitimité des gouvernements de fait » ; cit. ; p. 89.
[83] Idem, p. 90.
[84] La transition démocratique égyptienne est loin d’être conclue. Après l’adoption de la Constitution du 26 décembre 2012 par le président élu Morsi, celui-ci est déposé le 3 juillet 2013 et la Constitution est suspendue. Une nouvelle phase intermédiaire s’ouvre, dans laquelle, toutefois, aucune Constitution provisoire n’est approuvée. Les 14 et 15 janvier 2014, est adoptée la Constitution actuellement en vigueur par référendum (De Cara Jean-Yves et Saint-Prot Charles, L’évolution constitutionnelle de l’Egypte ; Paris, Karthala ; 2014).
[85] Après l’organisation en mars 1992 de nouvelles élections anticipées, l’opposition s’empare de la majorité. Ramiz Alia démissionne. Quelques mois plus tard, Alia et plusieurs autres anciens dirigeants communistes sont arrêtés pour corruption.V. Carlson Scott N., « The Drafting Process for the 1998 Albanian Constitution » in Miller Laurel E. (dir.), Framing the State in Times of Transition ; Washington DC, US IPP ; 2010; p. 311-331.
[86] Lacher Wolfram, « Libye : révolution, guerre civile et montée en puissance des centres de pouvoir locaux » in Charillon Frédéric et Dieckhoff Alain (dir.), Afrique du Nord Moyen Orient. Printemps arabe ; Paris, La Doc. fr. ; 2012 ; p. 49.
[87] La Constitution de 1969 n’était plus en vigueur depuis 1977.
[88] Philippe Xavier, « Tours et contours des transitions constitutionnelles » ; cit. ; p. 18.
[89] A l’heure actuelle, deux gouvernements régissent le territoire libyen. L’un, reconnu par la communauté internationale, a son siège à Tobruk, à 1300 km de la capitale, et contrôle une partie infime du territoire. Tripoli, la capitale, depuis l’été 2014, est le siège d’un deuxième gouvernement philo-islamique, non reconnu. L’anarchie chronique du pays a représenté un terrain fertile pour l’implantation, tout récemment, d’une branche de l’Organisation de l’Etat islamique. Afp, « La Libye, un terrain fertile pour l’implantation de l’EI », France 24, http://www.france24.com/fr/20150216-libye-branche-ei-Etat-islamique-jihadistes-haftar-derna-egypte/.