Voici la 45e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 5e livre de nos Editions dans la collection « Académique » :

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :
Volume V :
Le(s) droit(s) selon & avec
Jean-Arnaud Mazères
Ouvrage collectif
(Direction Mathieu Touzeil-Divina
Delphine Espagno, Isabelle Poirot-Mazères
& Julia Schmitz)
– Nombre de pages : 220
– Sortie : novembre 2016
– Prix : 49 €
- ISBN / EAN : 979-10-92684-19-3 / 9791092684193
- ISSN : 2262-8630
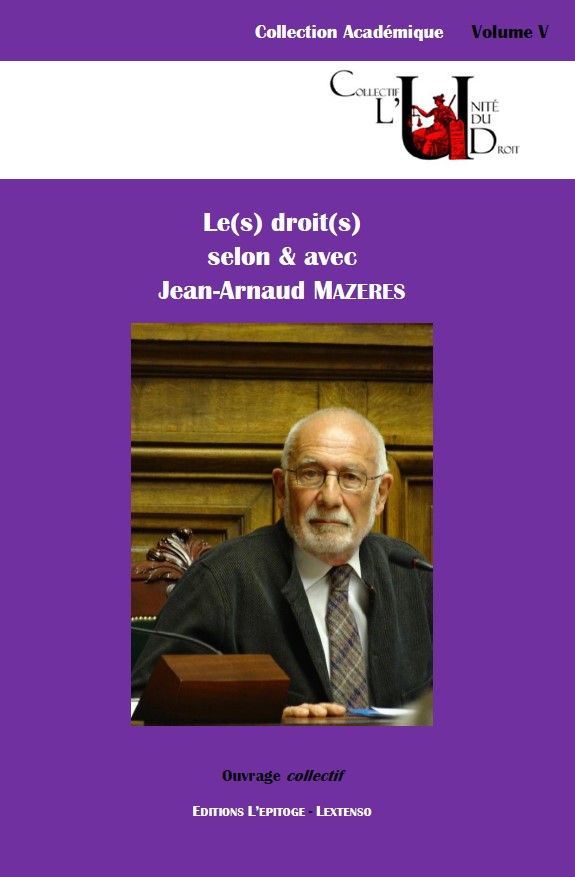
Présentation :
Un professeur, un maître, un père, un ami, un guide, un modèle, un inspirateur, un trouvère et, à toutes les pages, un regard. Tous ces qualificatifs pour un seul homme, un de ces êtres doués pour le langage, le partage, l’envie de transmettre, le goût de la recherche et de l’analyse, l’amour des livres et de la musique, l’attention aussi aux inquiets et aux fragiles. La générosité de Jean-Arnaud, l’homme aux mille facettes, est aujourd’hui célébrée, à travers le regard de ses amis. Tous ceux qui ont contribué à cet ouvrage ont quelque chose à dire, à écrire, à expliquer aussi, de ce moment où leur trajectoire a été plus claire, parfois s’est infléchie lors d’un cours ou d’un entretien, où leurs doutes ont rencontré non des réponses mais des chemins pour tenter d’y répondre. Chacun a suivi sa voie, chacun aujourd’hui a retrouvé les autres. Cet ouvrage est pour toi Jean-Arnaud ! Cela dit, si tu ne t’appelles pas Jean-Arnaud, toi – lecteur – qui nous tient entre tes mains, tu peux aussi t’intéresser non seulement au professeur Jean-Arnaud Mazères mais encore t’associer aux hommages et aux témoignages qui lui sont ici rendus. L’ouvrage, qui se distingue des Mélanges académiques, est une marque de respect et d’affection que nous souhaitons tous offrir à son dédicataire et ce, pour ses quatre-vingt ans. L’opus est alors bien un témoignage : celui de celles et de ceux qui ont eu la chance un jour de rencontrer le maestro, de partager les moments plus ou moins délicats du passage de l’innocence estudiantine à celui de la vie d’adulte, voire de faire une partie de ce chemin à ses côtés comme collègue et / ou comme ami. Des vies différentes pour chacun d’entre nous, des choix que le professeur Mazères a souvent directement inspirés, influencés, compris, soutenus mais pour nous tous ce bien commun partagé : celui d’avoir été, et d’être toujours, son élève, son ami, son contradicteur parfois. Par ce « cadeau-livre », nous souhaitons faire part de notre affection, du respect et de l’amitié que nous avons à son égard. Bel anniversaire, Monsieur le professeur Jean-Arnaud Mazères !
Ont participé à cet ouvrage (qui a reçu le soutien de Mme Carthe-Mazeres, des professeurs Barbieri, Chevallier, Douchez, Février, Lavialle & Mouton) : Christophe Alonso, Xavier Barella, Jean-Pierre Bel, Xavier Bioy, Delphine Costa, Abdoulaye Coulibaly, Mathieu Doat, Arnaud Duranthon, Delphine Espagno-Abadie, Caroline Foulquier-Expert, Jean-François Giacuzzo, Philippe Jean, Jiangyuan Jiang, Jean-Charles Jobart, Valérie Larrosa, Florian Linditch, Hussein Makki, Wanda Mastor, Eric Millard, Laure Ortiz, Isabelle Poirot-Mazères, Laurent Quessette, Julia Schmitz, Philippe Segur, Bernard Stirn, Sophie Theron & Mathieu Touzeil-Divina.
Ouvrage publié par le Collectif L’Unité du Droit avec le concours de l’Académie de Législation de Toulouse, du Centre de Recherches Administratives (ea 893) de l’Université d’Aix-Marseille et avec le soutien et la complicité de nombreux amis, anciens collègues, étudiants, disciples…
La mère de Maurice,
et celle des autres.
« Contribution au thème
de la mère de l’auteur »
Florian Linditch
Professeur à l’Université d’Aix-Marseille, Cra
I. Aux origines du sujet
La mère. Pourquoi pas le père ? Pas de réponse. Pas le temps. Nous laissons le sujet à quelqu’un d’autre. Quant à la mère, le sujet s’est imposé à la suite de deux évènements déjà anciens.
Un « taxi africain » pour commencer, on pardonnera à l’anecdote ce qu’elle a d’autobiographique. Deux décennies plus tôt, l’auteur de ces lignes reçu depuis quelques heures au concours d’agrégation emprunte un taxi à Paris. A cette époque, point de téléphone portable : impossible d’annoncer la bonne nouvelle à ses proches. Trop de joie. Le premier venu fera l’affaire. Un chauffeur de taxi. Celui-ci, bonhomme, accepte la confidence du succès. Mais au lieu des congratulations attendues, le voilà qui explique doctement qu’« en Afrique, chaque réussite est toujours celle de la mère : c’est elle qu’il faut féliciter en premier ». Etonnement du jeune agrégé, et même légère déception. Son succès ne serait-il donc pas le sien propre ?
Deuxième anecdote, non moins discutable scientifiquement, la découverte de Lanza del Vasto, illustration de l’humanisme (courant de pensée que notre maître, Jean-Arnaud, tenait à distance à une certaine époque : suspicion des catégories génériques, suspicion des droits de l’Homme avec un grand « H », abstraction générique qu’il ne coûte rien de mobiliser, certains s’en souviendront…). Une grande respiration philosophique pourtant, et sans doute velléité d’émancipation de l’ancien doctorant. Peut-être s’échappera-t-il ainsi de l’antre de Cyclope pour voguer à sa guise sur la pensée humaniste et l’idéalisme philosophique. Mais, nouvelle surprise : le Maître connaît tout. Il parle de l’œuvre, mais également de l’homme. Stupéfaction : le grand philosophe et poète fut jadis invité par sa mère lors de semaines spirituelles dans les piémonts pyrénéens. Plusieurs années de suite et plusieurs jours en suivant. Illumination, le maître avait donc également une mère. Et celle-ci lui avait fait rencontrer Lanza del Vasto. Voilà l’explication, le maître n’est maître que parce qu’il avait une maîtresse mère. Il n’en fallait pas moins pour s’interroger sur la place de la mère dans la construction intellectuelle d’un homme. Les bibliothèques d’ailleurs, débordent de livres sur les mères et ceux-ci forment « un genre difficile, aux références prestigieuses, d’emblée décourageantes[1] ».
II. La mère de Maurice H.
La mère de Maurice Hauriou se prénommait Marie. Marie, Eugénie, Trouiller. Elle était née à Ladiville (Vendée) le 25 février 1836. Elle appartenait sans doute à une famille de notables ruraux, eu égard à la profession du père attestée dans les actes notariés : « propriétaire [2] » et au fait qu’il fut maire de la même commune lorsqu’elle avait vingt ans.
Marie, Eugénie est décédée à l’âge de 43 ans, à Deviat, commune voisine, le 6 avril 1879. Maurice Hauriou avait à peine 23 ans. La même année, il est docteur en droit (Faculté de Bordeaux). Avant, après le décès, on ne sait. Sans doute simultanément, les deux thèses soutenues en 1879 auront-elles quelque peu rendu supportable cette épreuve, en accaparant le jeune étudiant.
Une autre femme encore qu’on ne peut laisser dans l’ombre, la sœur. Sa cadette de trois ans, Catherine, Louise, Edmée, également née à Ladiville le 17 janvier 1859. Huit ans plus tard après le décès de sa mère, elle épouse à 28 ans, en 1887 Jean Malet, professeur à l’Ecole vétérinaire de Toulouse. Simple coïncidence, ce rapprochement géographique du frère et de la sœur, ou mariage arrangé, influencé par Maurice ou pourquoi pas son épouse ? On ne sait, mais on voit difficilement comment de Vendée, elle aurait pu rencontrer un autre professeur toulousain.
Une dernière, l’épouse. Une autre Marie bien entendu, de son nom de jeune fille, Andrieux. Beaucoup plus jeune que Maurice : 16 ans, écart assez fréquent à l’époque. Née le 28 juin 1872, à Blanzac-Porcheresse (Charente). Sûrement pas une étudiante, en cette fin du XIXe siècle. Du reste, elle est bordelaise. Ils auront six enfants, dont André Hauriou, professeur de droit.
Nous n’en savons rien de plus. Comme du reste.
III. Avec Sainte-Beuve
Il faut relire le Contre Sainte-Beuve pour réaliser que le prétendu interdit posé par Marcel Proust du recours à la biographie pour comprendre l’œuvre n’est pas celui qu’on enseigne trop rapidement. Proust ne remet jamais en cause l’utilité de la biographie, il moque simplement (car l’ouvrage ne dépasse pas, le plus souvent, le niveau du pamphlet) la volonté du critique de mettre en fiche les données essentielles d’une vie, pour en extraire des déterminismes qui expliqueraient l’œuvre. Accablant le pauvre Sainte-Beuve, le jeune Marcel ne craint d’ailleurs pas de se contredire lui-même. A l’occasion, il convoque sa propre mère pour mieux démontrer l’insensibilité du critique : « sans doute n’avait-il pas vu l’émotion du débutant, qui a depuis longtemps un article dans un journal, qui ne le voyant jamais quand il ouvre un journal, finit par désespérer… Mais un matin, sa mère, en entrant dans sa chambre, a posé près de lui le journal d’un air plus distrait que de coutume… mais néanmoins, elle l’a posé tout près de lui, pour qu’il ne puisse manquer de le lire et s’est vite retirée et a repoussé vivement la vieille servante qui allait entrer dans la chambre. Et il a souri, parce qu’il a compris que sa mère bien aimée voulait qu’il ne se doutât de rien, qu’il eut toute la surprise de sa joie, qu’il fut le seul à la savourer et ne fût pas irrité des paroles des autres, pendant qu’il lisait et obligé, par fierté, de cacher sa joie à ceux qui auraient indiscrètement demandé à la partager avec lui[3] ». Quelles lectures, ou lesquels de nos actes et pensées, nos mères ont-elles préparés de cette façon ? Le fils lui-même le sait-il ? Ce qui importe au fond est de savoir que cela pu être ainsi, de laisser ouverte la fenêtre, d’y regarder de temps en temps. Ce frémissement, cette énergie vitale, cette trace d’humanité que l’on guette sur le silex ou le moindre tesson arraché à la terre, pourquoi ne pas la chercher ici ? Dans toutes les autres disciplines, y compris les sciences exactes (voir les innombrables biographies d’Einstein), les témoins se mirent, se comparent, s’y retrouvent, ils aperçoivent derrière la plume, la main, l’auteur et peut-être le secret du génie.
Revenons à la mère de Maurice. Il avait donc une mère. Pourrait-elle avoir joué un rôle dans son œuvre intellectuelle ? Perdue à l’âge de 23 ans on l’a dit, ce qui signifie que Maurice vivra encore 50 ans sans elle. Mais la présence des mères n’est pas présence physique. Elle ne se mesure même pas aux citations, surtout chez les professeurs de droit. Nous la croyons plus diffuse, mais non moins importante.
Entreprise périlleuse : où est-il démontré que les auteurs devraient quelque chose à leur mère ? Si l’on peut en douter pour les juristes, dont l’objet d’études est nécessairement extérieur, à la rigueur on veut bien l’admettre pour les poètes (Baudelaire, Rimbaud), les romanciers (Balzac, Flaubert, Maupassant). La littérature suppose un engendrement, quelque chose qui vient de l’intérieur, une sensibilité qui pourrait alors devoir quelque chose à la mère, et ce même lorsque le fils entre en réaction (Sartre, Jules Renard ; Hervé Bazin). Mais le juriste qui se doit à l’instar du scientifique à l’art du dépouillement, au renoncement à l’égo, dura lex, sed lex, comment sa mère pourrait-elle jouer un rôle dans ses idées ?
C’est en pleine conscience de ces limites méthodologiques que l’entreprise doit être tentée. Au pire on les récusera, au mieux certains éléments, relevant sans doute de la pure coïncidence, permettront-ils de créer un temps d’arrêt, une hésitation, vite balayée par la course à l’information qui gouverne aujourd’hui la discipline juridique.
IV. Amour, le faux objet
La classification la plus courante se plait à opposer, les Mères pathologiques, monstrueuses (Valles, Jules Renard ou Hervé Bazin, del Castillo), et les mères admirables, le plus souvent (Hugo, Colette, Romain Gary, Marcel Pagnol, Albert Cohen, et tant d’autres).
Si l’on en croit Guy de Maupassant « Il y a deux sortes d’écrivains : ceux qui étaient aimés de leur mère et ceux qui ne l’étaient pas ». Telle est souvent l’opinion commune qui considère que :
– la mère était aimante, ou du moins une relation pleine et de qualité s’est établie entre elle et son enfant, et l’on peut supposer que celui-ci en retirera sensibilité et talent, voire génie. Romain Gary en fournit l’exemple, après de brèves études de droit à Aix en Provence, le voilà aviateur, suivant la voie de la France Libre, puis de l’Ecriture, toujours plus libre. Son absolue fantaisie le guide de succès en succès, nimbé qu’il est de l’amour maternel et de la fameuse Promesse de l’Aube que constitue l’amour maternel ;
– à l’inverse la relation mère/fils était plus difficile, et dans ce cas, il faut s’attendre à la révolte, au ressentiment, peut-être à moins d’autosatisfaction, on pense à Baudelaire.
Vulgate psychologisante qui doit bien comporter une part de vérité, mais qui peut être discutée à l’infini, tant cette causalité paraît rudimentaire. Les relations ne sont jamais si simples, les bilans sont toujours constitués d’actifs et de passifs. Et puis, on ne peut exclure les paradoxes. Une mère peu aimante ne conduira-t-elle pas son enfant à rechercher ailleurs l’affection dont il a manqué ? Ne s’ouvrira-t-il pas à de nouvelles fraternités, avec les vivants, comme avec les morts. Ne recherchera-t-il pas toujours une humanité dont il s’est senti privé depuis l’origine. On pense à Dickens, pleuré par toute l’Angleterre et littéralement mort d’épuisement à la suite de lectures de son œuvre qu’il donnait à son public.
Bien entendu, si l’on définit l’amour maternel comme cette abnégation, ce don inconditionnel de soi à l’enfant, à son développement, nul doute qu’il ne doive tenir une place importante dans la fabrique de l’homme[4] et forcément de l’auteur.
Tant d’incertitudes conduisent à renoncer à identifier de puissants déterminismes. Mieux vaut considérer quelques situations clés (distance, abandon, accompagnement de tous les instants, etc.).
V. Présence – Absence
D’abord, il y a l’absence volontaire, l’abandon. La littérature en fournit de nombreuses illustrations. Il faudrait voir du côté de Miguel del Castillo pour la crainte de l’abandon maternel, et l’abandon lui-même. Abandon signifiant pour lui, monstrueux égoïsme de sa mère (abandon d’un enfant, en Allemagne durant la guerre, puis dans les camps pour républicains de l’Espagne franquiste). Celui également de la mère de Dickens qui oublie de récupérer le petit Charles, placé dans une fabrique humide du Londres misérable du début du XIXe siècle.
Mais le plus souvent, mieux vaut parler d’absence que de manque d’amour maternel. L’absence de la mère peut d’ailleurs n’être pas volontaire. Mouvements sociaux, guerres, maladie, mort peuvent l’expliquer…. La mère n’a pas vraiment choisi la séparation, mais peu importe, l’enfant lui, le vivra comme une déréliction. On est troublé de constater que la distance, l’abandon, la séparation engendrent un mieux, la fameuse « résilience » de Boris Cyrulnik[5]. Au point que si elle n’existe pas, l’enfant l’imaginera, lui donnera une importance que peut-être elle n’avait pas. L’enfant se construit dans cette séparation. Alors on imagine l’enfant en pensionnat ou simplement chez sa grand-mère. Il y a les lettres qu’on attend, les quais de gare, les valises trop lourdes qu’on porte pour faire homme. Il a également les lettres qu’il lui écrit car elle travaille ailleurs, les bulletins de notes, la perspective heureuse de se retrouver bientôt ou dans longtemps. La mère qu’on oublie peu à peu, puis la mère qui réapparaît, à laquelle on se réhabitue si aisément. Si désespérément, car on sait qu’elle n’est là que pour quelques jours, quelques heures. Apprivoiser le temps qui dure, et celui qui s’enfuit. Admettre le transitoire, lui donner toute la densité possible.
Tout un apprentissage de la séparation si nécessaire. Presque, une philosophie du temps et de la durée.
Puisque les mères s’en vont (jamais si loin qu’on le pense, mais on le pense), comment ne pas être seul ? Il faut rêver, créer, aimer. Rêve d’une idée qui s’incarnerait et durerait, d’un groupe d’hommes et de femmes qui la partageraient. Plus jamais seul….
VI. L’Accompagnatrice
Oui les leçons se révisent idéalement sous la lampe du salon et se récitent à la mère. Image exaspérante de banalité. Mais l’enfant pourrait aussi bien les apprendre ailleurs, de même que l’étudiant. Et toujours, la mère n’est pas loin. Même pour l’étudiant parti faire ses études ou sa carrière à Paris, Bordeaux ou Toulouse. Innombrables sont les romans qui mettent en scène l’aventure parisienne et le jugement de la mère qui doit tomber à un moment donné (v. les biographies de Balzac, Le petit Chose de Daudet, ou les lettres à sa mère, de Baudelaire). La mère est partout, même si elle est absente. Que cet accompagnement puisse prendre des formes extrêmes, celle de la mère possessive (Gary), ou de l’indifférence (Léautaud), les conséquences sur l’œuvre demeurent.
Il faudrait parler de la vigilance omnisciente des mères. Prévert se plaisait à opposer ses parents là-dessus : « mon père comme je l’amusais, le fâchais, le décevais et l’intriguais tout à la fois, il m’expliquait, il me disait comment j’étais dans le fond. Ma mère jamais : elle me savait[6] ». Mieux encore, ce petit dialogue de Julien Green et de sa mère qui laissera rêveur plus d’un lecteur :
« Que fais tu ? disait-elle
– Rien, répondait, Julien
– Ne le fais plus[7] ».
Parfois, cette surveillance prend des tours originaux. A l’occasion, la mère se fait auteur : elle écrit à son enfant. Elle ne craint pas d’user de stratagèmes. Tel celui que raconte Niki de Saint-Phalle: « je me rappelle avoir lu dans son journal intime (que je pouvais lire parce qu’elle le laissait sciemment à la portée de tous, qu’elle craignait que je finisse mal[8] ». Ou bien, les deux cent cinquante lettres écrites à l’avance par sa mère, à Romain Gary, et qu’il recevait encore à Londres alors qu’il la savait morte depuis trois ans[9]. Ou encore George Sand bourrant ses commodes de manuscrits à publier après sa mort afin de préserver ses enfants du besoin, et pour leur rester présente.
Pour certains, ces forces de l’esprit maternel demeurent après la mort, même sans stratagèmes. Plusieurs auteurs l’ont éprouvé. Jean-Marie Rouart : « ma mère en me quittant dans son apparence réelle s’est glissée en moi et je sens sa présence. Il n’est pas un instant que j’y pense ou non, que je ne ressente cette impression qu’elle est non seulement là, mais qu’elle s’est tissée dans les fibres de mon être[10] ». Hector Biancotti, encore plus explicite relève que même si l’enfant révolté décide de rompre le fameux cordon, « on ne quitte jamais tout à fait une mère, on s’en va, on s’en éloigne, on se sent délivré, affranchi, exempt. Et un beau jour, à cause d’un rien, vous découvrez que vous avez un fil à la patte qui vous relie à elle, à la mère. Quelle abomination la nature. On ne peut haïr définitivement une mère[11] ».
VII. Ambitions croisées
Ce que recouvre l’ambition des parents pour leur enfant, désir d’une situation, projection de leurs propres ambitions non réalisées, nombre de livres de psychologie en traitent abondamment. Mais, contrairement à ce qu’affirme l’opinion commune, ne serait-ce pas là, simplement l’éducation due à l’enfant ? De sorte que l’ambition deviendrait alors la norme : « tu seras un homme mon fils »…
Reste que les voies de l’ambition sont parfois imprévisibles, voire paradoxales, lorsqu’elles passent par la séparation :
Le sanatorium, « j’ai sept ans. Elle m’emmène à Dieulefit, pour me laisser dans une maison de repos. Quatre moi sans elle. C’est dur, beaucoup plus douloureux que cette maladie des bronches qui me poignarde de temps à autre – infiniment moins que l’absence, l’éloignement de ceux que j’aime[12] ».
L’internat à neuf ans, pour d’autres. Les livres sont pleins de récits d’internat, leur grande solitude, comment les mères peuvent-elles se résigner de la sorte ? Ce renoncement « pour le bien » de l’enfant, n’est-il pas preuve d’amour, volonté d’accepter la séparation si elle doit permettre à l’enfant d’acquérir plus vite les clés du monde ?
L’internat encore, et cette volonté que le petit Maurice soit inscrit avec deux ans d’avance sur son âge. Il aura le baccalauréat à seize ans.
Quel parent n’a pas d’ambition pour son enfant ? Mais elle en a plus que les autres. Différente en tout cas, les études sont sacrées, surtout si la mère est enseignante… Non pas sacrées, incontournables, naturelles : « Tu seras enseignant mon fils »…
Violence faite à l’enfant, oubli de son épanouissement personnel ? On ne saurait dire. L’enfant, lui, sait peut-être. Comme si la grande tradition des familles aristocrates et bourgeoises aux XVII et XVIIIe siècles n’avait jamais cessé. Elisabeth Badinter rappelle qu’à cette époque, l’éducation de l’enfant « suit a peu près toujours le même rituel, ponctué par trois phases différentes : la mise en nourrice, le retour à la maison, puis le départ au couvent ou en pension[13] ». Et encore sur les cinq ou six ans que l’enfant passait avec sa famille, il était livré à l’autorité des gouvernantes et percepteurs[14]. Ceci rejoint le grand débat sur la question de savoir s’il faut, ou pas, donner le sein à son enfant, plutôt que de le confier à une nourrice[15].
Poussons plus loin, l’ambition ne traduirait-elle pas une certaine dose d’insatisfaction par rapport à la vie ? La vie est ailleurs (Kundera). Même sans insatisfaction, effet de miroir idéalisé renvoyé par les deux protagonistes.
La mère de Maupassant, décidant que Flaubert ami de son frère décédé en deviendrait l’oncle, le parrain pour ne pas dire le père littéraire de son fils qui serait romancier (elle réussit sur les deux points). La mère de Romain Gary décidant que son fils sera ambassadeur, héros et grand écrivain (triple succès). Mères qui décidaient d’être mères de romancier, d’ambassadeur ou de professeur. Mères qui rêvaient d’une autre vie pour elles, pour leur fils, on ne sait au juste.
Le fils devient alors l’homme que la mère a rêvé. Mais quel homme au juste ? Ce grand provocateur qu’est Philippe Sollers dit quelque part que par le fils, la mère veut remplacer et effacer, non le père de l’enfant (laissons Œdipe tranquille, pour cette fois-ci), mais son propre père à elle. Piste intéressante qui demanderait à être vérifiée…
Mieux même à l’occasion, le fils libère, venge sa mère. Maints passages de Romain Gary en témoignent. Il faudrait relire Marcel Pagnol : tout le monde connaît le final du Château de ma mère, la grosse pierre brisant, trente ans plus tard, la porte du fond du parc du château de la Busine, la porte ouvrant sur le canal. Vengeance, en réalité le mot n’est pas bien choisi. On tâtonne, disons que c’est comme si l’enfant, devenu adulte, avait enfin réalisé son ambition première : protéger sa mère. Il faut réparer, arranger, compenser tout ce qu’on ne pouvait à l’époque. Réparer des maisons, réparer des affronts. Comme cette ultime lettre de Simenon, lettre post-mortem :« ce qui m’a fait le plus plaisir c’est de savoir qu’après ma visite à Liège… les autorités, du maire au gouverneur, non seulement t’ont invitée à toutes les cérémonies et diners officiels, mais qu’ils envoyaient des voitures pour te prendre[16] ».
VIII. Ecrire, écrire, peu importe le sujet, pour réunir…
Mystère, pudeur, égoïsme ? On ne connaît pas une œuvre qui sache exprimer ce qu’il entre dans l’amour de son fils pour sa mère. L’essentiel des œuvres crient la perte de la mère, le manque. Rares sont celles qui parviennent à dire qui était la mère. Certains auteurs le reconnaissent, tels Georges Simenon, pourtant qualifié pour camper un personnage : « nous sommes deux à nous regarder : tu m’as mis au monde, je suis sorti de ton ventre tu m’as donné mon premier lait et pourtant, je ne te connais pas plus que tu ne me connais … vois-tu ma mère, tu es un des êtres les plus complexes que j’aie rencontrés[17] ». Le fils ne sait pas qui était sa mère, et, difficulté supplémentaire, il paraît désarmé pour comprendre son propre sentiment : « l’amour du fils pour la mère ne sait comment se dire. Quels mots choisir pour exprimer l’infinie affection pour celle avec qui il aura fait le plus long chemin[18] ». Il y a là un point aveugle, un défi, des non dits, à dire et à écrire.
Ceci explique que pour certains auteurs, l’écriture elle-même, quel qu’en soit le sujet, ne serait au mieux que le prolongement de leur relation avec leur mère. Non seulement, l’écriture qui la prend pour sujet (Cohen, Pagnol, Gary), mais en réalité n’importe quelle écriture : « avec des mots, peut-on remplir les vides que l’on a laissé derrière soi, les blancs de la mélancolie, les étonnants remords auxquels on ne peut rien… Il y a dans sa vie un grand matin de silence et d’absence[19] ». Même si les pages d’écritures ne sont pas consacrées à la mère, elles en portent encore la marque, parfois difficilement discernable, même par le fils : « écrire un peu pour elle, puisque j’écris par elle[20] ».
Toujours la même ambiguïté, retrouvée plusieurs fois énoncée sous des formes différentes chez Georges Perec : « j’écris parce qu’ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l’écriture ». Comme si l’écriture constituait alors tout à la fois prolongement de la mère (ou d’autres êtres aimés désormais disparus), mais son remplacement, car « leur souvenir est mort à l’écriture ; l’écriture est le souvenir de sa mort et l’affirmation de ma vie[21] ». Maurice Hauriou l’a-t-il pensé, l’année de ses vingt-trois ans, et les cinquante années qui suivirent ? Avait-il même besoin de le penser, savait-il d’où lui venait cette énergie qui lui ferait écrire des milliers de pages. Telle pourrait être la théorie des littérateurs, gens fort heureusement trop peu sérieux, pour que les juristes s’en préoccupent.
Un pas de plus, dans ce qui pourra paraître relever d’un délire littéraire : si l’acte d’écrire lui-même reproduisait à l’infini les paroles dites, ou non, à sa mère, se pourrait-il que conçues pour elle, les pensées de l’intellectuel soient en réalité inspirées par elle ? Pour certains écrivains, il n’y a pas de doute : « je pense que ce cercle enfermant le fils avec sa mère à jamais est bien réel, et que chacun de nous, aussi loin qu’il s’en aille, demeure sur ce territoire, ne dépasse pas sa frontière. Le cercle s’élargit, s’élargit, et des rênes invisibles nous retiennent, qu’elles soient tressées ou d’amour et de haine, et même si les mains les ont lâchées. L’amour que la mère porte à sa créature n’a nul besoin d’être aimé en retour ; il nous attend interminablement, et je pense qu’il peut nous être une prison, une torture ; mais quand la mère disparaît, toutes les murailles de Chine s’effondrent[22] ».
Poussons plus loin encore : il est des auteurs qui vont jusqu’à prétendre que l’intellectuel comporterait naturellement une part de féminité, cette part maternelle qui continue à vivre, sous d’autres formes. Pour Christian Bobin, l’auteur serait un merveilleux homme raté qui se rapprocherait de la femme par la même quête de l’invisible : « les jeunes mères ont affaire à l’invisible (l’auteur vient d’expliquer que personne ne voit les trésors d’attention prodigués à l’enfant)… L’homme ignore ce qui se passe. C’est même sa fonction, à l’homme de ne rien voir de l’invisible. Ceux parmi les hommes qui voient quand même, ils en deviennent un peu étranges. Mystiques, poètes ou bien rien ? Déchus de leur condition. Ils deviennent comme des femmes : voués à l’amour infini[23] ».
Alors Maurice, cette spiritualité, cette poésie, cette quête de l’invisible, de l’idée, cet amour infini, si on le trouvait dans tes œuvres, ne révèleraient-ils pas cette part de féminité ? Comme un prolongement d’une sensibilité enfantine venue d’on ne sait où ? Quand tu regardes ainsi, par-dessus ton épaule (le fameux regard oblique), n’espères-tu jamais, une fois encore, obtenir son approbation ?
Bien entendu, tu ne le reconnaîtras jamais. Romain Gary lui y était parvenu, rentré couvert d’honneurs à Paris, il écrivait ceci : « mes amis prétendent que j’ai parfois l’étrange habitude de m’arrêter dans la rue, de lever les yeux à la lumière et de rester ainsi un bon moment en prenant un air avantageux, comme si je cherchais à plaire à quelqu’un[24] ».
Tiens pour te consoler, te dire que tu n’es pas tout seul, un petit cadeau de l’ami Perec : écrire c’est une « alternative sans fin entre la sincérité d’une parole à trouver et l’artifice d’une écriture exclusivement préoccupée de dresser ses remparts[25] ».
Toute une épistémologie, la tienne, la sienne, la nôtre…
[1] Delerm Marthe et Philippe, Le miroir de ma mère, Ed. du Rocher, 1998, p. 9
[2] Selon le site : http://siprojuris.symogih.org/siprojuris/enseignant/56873.
On y trouvera également les informations suivantes sur « Hauriou, Maurice, Jean, Claude, Eugène 1856 – 1929, profession du père : notaire, installé à Deviat en 1856. Père : Laurent, Jules Hauriou, né à Cressac (Charente) le 19 avril 1827, fils de Pierre Hauriou, propriétaire (tant au moment de la naissance qu’au moment du mariage de son fils). Mère : Marie, Eugénie, Trouiller, née à Ladiville le 25 février 1836, décédée à Deviat le 6 avril 1879, fille de Jean, Benjamin Trouiller, maire de Ladiville en 1856, propriétaire. Mariage des parents à Ladiville le 16 avril 1855. Une soeur Catherine, Louise, Edmée, née à Ladiville le 17 janvier 1859, elle épouse en 1887 Jean Malet, professeur à l’Ecole vétérinaire de Toulouse. Identité du conjoint : Andrieux, Marie – Date et lieu de naissance : 28 juin 1872 (Blanzac-Porcheresse (Charente)). Six enfants, dont André Hauriou, professeur de droit ».
[3] Proust Marcel, Contre Sainte-Beuve, Gallimard, Coll. Idées, 1954, p. 169.
[4] Voir la grande thèse de « l’amour en plus » d’Elisabeth Badinter ou plus largement le travail de Françoise Dolto.
[5] Cyrulnik B., Un merveilleux malheur, Odile Jacob, 1999.
[6] Prévert Jacques, « Choses et autres » in Toi ma mère, Albin Michel, 2006, p. 291.
[7] Cité par Franz-Olivier Giesbert, Dieu, ma mère et moi, Ed. France Loisirs, 2012, p. 19.
[8] Niki de Saint-Phalle in Toi ma mère, op. cit., p. 268.
[9] Gary Romain, La promesse de l’aube, Gallimard, Folio, p. 368.
[10] Rouart Jean-Marie, « Une jeunesse à l’ombre de la lumière », cité in Toi ma mère, op. cit., p. 227.
[11] Bianciotti Hector, Toi ma mère, op. cit., p. 173.
[12] Delerm Marthe et Philippe, Le miroir de ma mère, Ed. du Rocher, 1998, p. 88.
[13] Badinter Elisabeth, L’amour en plus, Le livre de poche, 1982, p. 150.
[14] Idem, p. 161
[15] Idem, p. 233 et s.
[16] Simenon Georges in Toi ma mère, op. cit. p. 239.
[17] Simenon Georges in Toi ma mère, op. cit., p. 245.
[18] Simon Yves in Toi ma mère, op. cit., p. 251.
[19] Delerm Marthe et Philippe, op. cit., p. 9
[20] Ibid.
[21] Perec Georges in Toi ma mère, op. cit., p. 271.
[22] Bianciotti Hector, « Seules les larmes seront comptées » in Toi ma mère, op. cit., p. 174.
[23] Bobin Christian, « La part manquante » in Toi ma mère, op. cit., p. 138.
[24] Gary Romain, La promesse de l’aube, Gallimard, Folio, p. 391.
[25] Perec Georges, op. cit., p. 277.
À propos de l’auteur