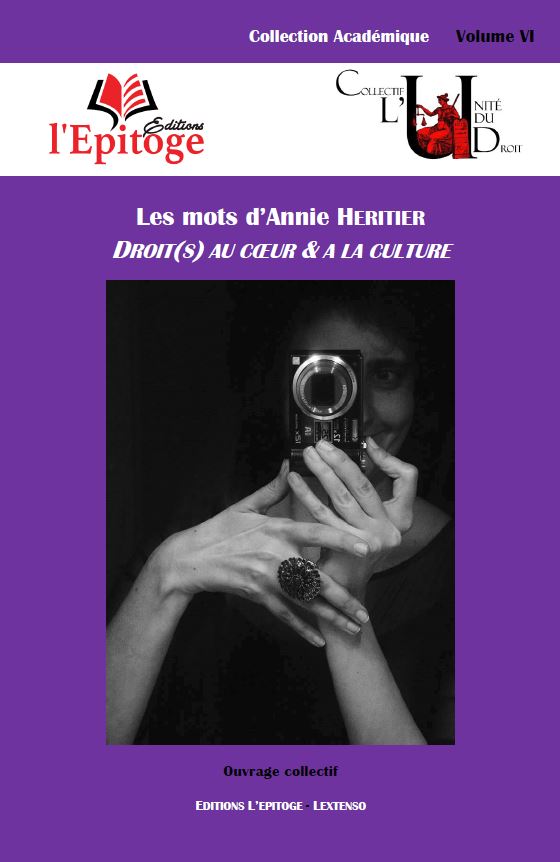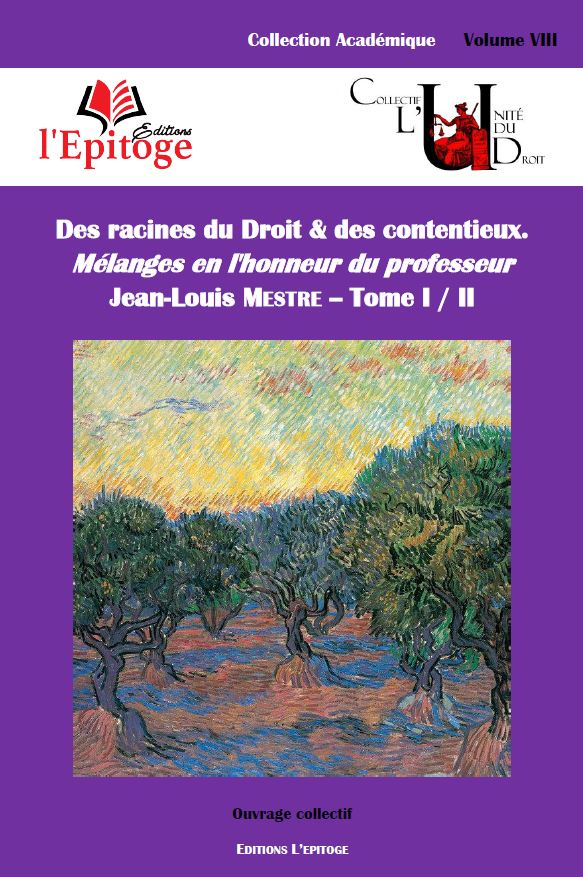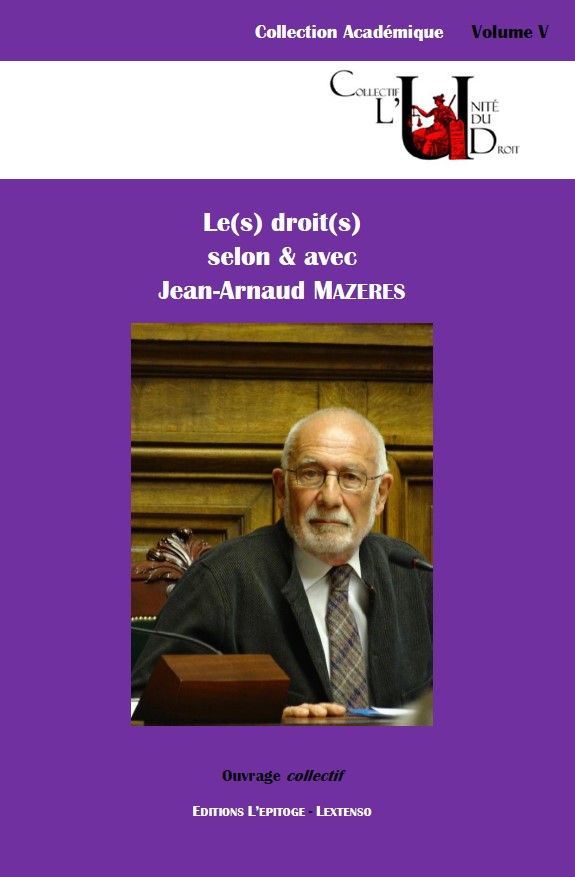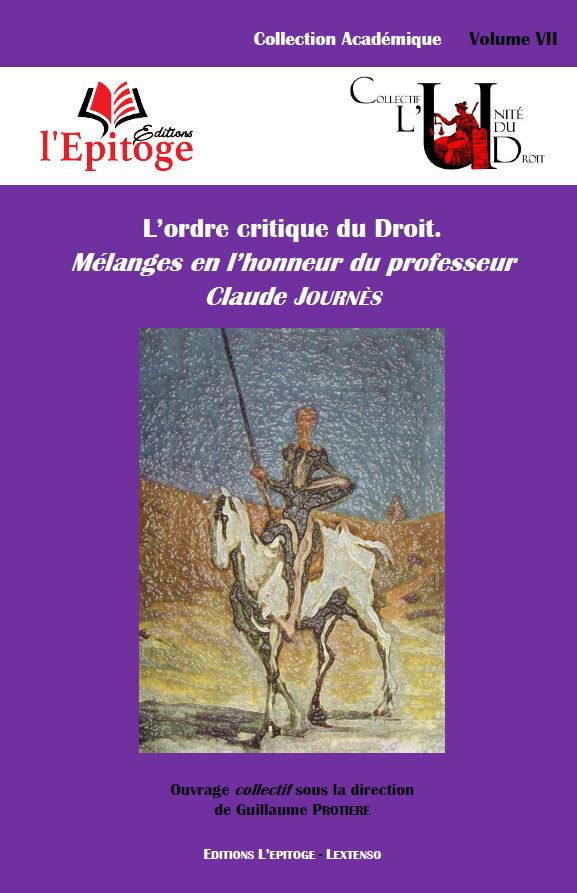Voici la 44e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait des 8e & 9e livres de nos Editions dans la collection « Académique » :
les Mélanges en l’honneur
du professeur Jean-Louis Mestre.
Mélanges qui lui ont été remis
le 02 mars 2020
à Aix-en-Provence.
Vous trouverez ci-dessous une présentation desdits Mélanges.
Ces Mélanges forment les huitième & neuvième
numéros issus de la collection « Académique ».
En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :
Volumes VIII & IX :
Des racines du Droit
& des contentieux.
Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Louis Mestre
Ouvrage collectif
– Nombre de pages : 442 & 516
– Sortie : mars 2020
– Prix : 129 € les deux volumes.
ISBN / EAN unique : 979-10-92684-28-5 / 9791092684285
ISSN : 2262-8630
Mots-Clefs :
Mélanges – Jean-Louis Mestre – Histoire du Droit – Histoire du contentieux – Histoire du droit administratif – Histoire du droit constitutionnel et des idées politiques – Histoire de l’enseignement du Droit et des doctrines
Présentation :
Cet ouvrage rend hommage, sous la forme universitaire des Mélanges, au Professeur Jean-Louis Mestre. Interrogeant les « racines » du Droit et des contentieux, il réunit (en quatre parties et deux volumes) les contributions (pour le Tome I) de :
Pr. Paolo Alvazzi del Fratte, Pr. Grégoire Bigot, M. Guillaume Boudou,
M. Julien Broch, Pr. Louis de Carbonnières, Pr. Francis Delpérée,
Pr. Michel Ganzin, Pr. Richard Ghevontian, Pr. Eric Gojosso,
Pr. Nader Hakim, Pr. Jean-Louis Halpérin, Pr. Jacky Hummel,
Pr. Olivier Jouanjan, Pr. Jacques Krynen, Pr. Alain Laquièze,
Pr. Catherine Lecomte, M. Alexis Le Quinio, M. Hervé Le Roy,
Pr. Martial Mathieu, Pr. Didier Maus, Pr. Ferdinand Melin-Soucramanien, Pr. Philippe Nélidoff, Pr. Marc Ortolani, Pr. Bernard Pacteau,
Pr. Xavier Philippe, Pr. François Quastana, Pr. Laurent Reverso,
Pr. Hugues Richard, Pr. André Roux, Pr. Thierry Santolini, M. Rémy Scialom, M. Ahmed Slimani, M. Olivier Tholozan,
Pr. Mathieu Touzeil-Divina & Pr. Michel Verpeaux,
… et pour le Tome II :
M. Stéphane Baudens, M. Fabrice Bin, Juge Jean-Claude Bonichot,
Pr. Marc Bouvet, Pr. Marie-Bernadette Bruguière, Pr. Christian Bruschi,
Prs. André & Danielle Cabanis, Pr. Chistian Chêne, Pr. Jean-Jacques Clère, Mme Anne-Sophie Condette-Marcant, Pr. Delphine Costa,
Mme Christiane Derobert-Ratel, Pr. Bernard Durand, M. Sébastien Evrard, Pr. Eric Gasparini, Père Jean-Louis Gazzaniga, Pr. Simon Gilbert,
Pr. Cédric Glineur, Pr. Xavier Godin, Pr. Pascale Gonod,
Pr. Gilles-J. Guglielmi, Pr. Jean-Louis Harouel, Pdt Daniel Labetoulle,
Pr. Olivier Le Bot, Pr. Antoine Leca, Pr. Fabrice Melleray,
Mme Christine Peny, Pr. Laurent Pfister, Pr. Benoît Plessix,
Pr. Jean-Marie Pontier, Pr. Thierry S. Renoux, Pr. Jean-Claude Ricci,
Pr. Albert Rigaudière, Pr. Ettore Rotelli, Mme Solange Ségala,
Pdt Bernard Stirn, Pr. Michael Stolleis, Pr. Arnaud Vergne,
Pr. Olivier Vernier & Pr. Katia Weidenfeld.
Mélanges placés sous le parrainage du Comité d’honneur des :
Pdt Hélène Aldebert, Pr. Marie-Bernadette Bruguière, Pr. Sabino Cassese, Pr. Francis Delpérée, Pr. Pierre Delvolvé, Pr. Bernard Durand,
Pr. Paolo Grossi, Pr. Anne Lefebvre-Teillard, Pr. Luca Mannori,
Pdt Jean Massot, Pr. Jacques Mestre, Pr. Marcel Morabito,
Recteur Maurice Quenet, Pr. Albert Rigaudière, Pr. Ettore Rotelli,
Pr. André Roux, Pr. Michael Stolleis & Pr. Michel Troper.
Mélanges réunis par le Comité d’organisation constitué de :
Pr. Jean-Philippe Agresti, Pr. Florent Blanco, M. Alexis Le Quinio,
Pr. François Quastana, Pr. Laurent Reverso, Mme Solange Ségala,
Pr. Mathieu Touzeil-Divina & Pr. Katia Weidenfeld.
Ouvrage publié par et avec le soutien du Collectif L’Unité du Droit
avec l’aide des Facultés de Droit
des Universités de Toulouse et d’Aix-Marseille
ainsi que l’appui généreux du
Centre d’Etudes et de Recherches d’Histoire
des Idées et des Institutions Politiques (Cerhiip)
& de l’Institut Louis Favoreu ; Groupe d’études et de recherches sur la justice constitutionnelle (Gerjc) de l’Université d’Aix-Marseille.
L’affaire Pagès (1939-1943).
Quand le Conseil d’Etat
appliquait le Code civil
Katia Weidenfeld
Agrégée des facultés de droit,
Ecole nationale des chartes
– Psl – Centre Jean Mabillon
La décision Sieur Pages du
Conseil d’Etat du 19 février 1943 – qui consacre l’autorité du mari en lui
permettant de s’opposer utilement à l’exercice d’une fonction publique par son
épouse- est généralement traitée comme un accident de l’histoire
jurisprudentielle. Tranchant avec un récit institutionnel qui se plaît à
commémorer le rôle déterminant du Conseil d’Etat dans l’affirmation du principe
d’égalité entre les hommes et les femmes, elle est souvent passée sous silence[1].
Lorsqu’elle est évoquée, elle est volontiers présentée comme un arrêt de
circonstance, trahissant les stigmates d’une époque plus que la volonté d’une
construction juridique[2].
Les archives retraçant la genèse de cette décision contrastent cependant avec cette analyse : elles révèlent la portée de principe que les membres du Conseil entendaient lui donner. L’arrêt Pagès est en effet dépourvu de toute portée pratique : lorsqu’il est délibéré, la situation de l’épouse du requérant était réglée depuis longtemps, à son détriment d’ailleurs. Et la solution retenue par le Conseil d’Etat n’était susceptible d’apporter aucune lumière pour régler la situation future des autres fonctionnaires éventuellement placées dans une situation identique. En 1945, le professeur Marcel Waline le déplore d’ailleurs : s’il approuve le sens de cette décision, au nom de la « fonction sociale » attachée au « pouvoir du mari de s’opposer à l’activité professionnelle qui écarterait sa femme du foyer », il regrette ainsi avec véhémence que la décision du Conseil d’Etat ne précise pas « par quel procédé le secrétaire d’Etat aurait pu mettre fin aux fonctions de l’intéressée[3] ».
L’adoption de la décision Pagès par l’Assemblée du contentieux[4], et non, comme le mentionne à tort le Recueil Lebon, par la Section du contentieux, traduit d’ailleurs clairement la force solennelle que ses auteurs entendaient lui donner. Mais cette solennité ne semble pas principalement liée à la résonnance idéologique de la décision. Il ne s’agissait sans doute pas principalement pour le Conseil d’Etat d’afficher son adhésion au retour à un mythique ordre ancien, valorisant le rôle domestique de la femme, que le gouvernement avait, d’ailleurs, largement perdu de vue en février 1943[5]. L’importance de l’arrêt tenait sans doute plutôt à son inscription dans un dialogue avec les juridictions judiciaires qui avaient également été amenées à se prononcer sur cette affaire.
L’affaire Pagès – qui dura près de quatre ans – fit en effet intervenir trois juridictions. Elle emmène aux confins du droit administratif, là où le droit public s’entremêle au Code civil et où le Palais-Royal est à l’unisson de celui de la Cité. En rompant ostensiblement le lien d’équivalence entre dualité juridique et dualité juridictionnelle, elle ramène sur des terres que les travaux du professeur Jean-Louis Mestre ont intensément scrutées et vers lesquelles il a ouvert de multiples chemins. Par ce diverticule, je voudrais rendre hommage au Maître célébré par ces Mélanges.
I. La guerre des époux Pagès
Au sein du couple Pagès, les hostilités judiciaires débutent le 25 avril 1939. Mais la décision du Conseil d’Etat intervient bien après la résolution du conflit, comme à contretemps.
A. Le conflit (avril 1939-14 juillet 1941)
Quelques mois avant la déclaration de guerre à l’Allemagne, Robert Pagès, expert-comptable, signifie par acte d’huissier à celle qu’il a épousée une dizaine d’années auparavant, Thérèse Marie Charlotte Bouhaye, une mise en demeure de démissionner de son emploi au sein de l’administration des postes, télégraphes et téléphones pour se consacrer entièrement aux soins du ménage. Comme il l’expliquera plus tard, M. Pagès reproche avant tout à sa femme de ne rentrer au domicile qu’à la nuit tombée, fatiguée et amaigrie par de longs trajets, et d’avoir refusé « d’accepter d’autres enfants » que leur fille unique, née en 1930[6].
On ignore pour quelle raison cette opposition ne se manifeste qu’en
1939, alors que T. Bouhaye est
employée des Postes depuis plus de dix ans. Mais il est vraisemblable que la
réforme du statut de la femme mariée, qui avait finalement abouti après la
victoire du Front Populaire, ait paradoxalement joué un rôle. Ce texte et les
débats qui l’ont précédé ont en effet été l’occasion de rappeler une
disposition tombée en désuétude s’agissant des employées d’administration.
Décevant les espoirs des féministes, la loi du 18 février 1938 avait en effet
maintenu l’autorité maritale et reconnu à l’époux le droit de s’opposer à l’exercice
d’une profession séparée par sa femme[7]. Ce
pouvoir n’était pas nouveau dans son principe[8]. Mais son
application s’était faite rare[9]
dans une France qui se distinguait par une forte participation des femmes
mariées au marché du travail[10].
Mme Pagès tente dans un premier temps de résister à l’injonction de son mari et saisit le Tribunal civil de la Seine pour lui faire apprécier le bien-fondé de l’opposition à son activité professionnelle. Par un jugement du 27 novembre 1939, rendu en Chambre du conseil, le Tribunal fait droit à la demande de Mme Pagès et lui accorde l’autorisation de continuer à exercer son emploi[11].
Mais M. Pagès fait appel. Le conseiller Werquin[12] est chargé de l’affaire. Présidée par Vuchot[13], la Cour d’appel de Paris infirme la solution de première instance. Quelques mois après que la loi du 11 octobre 1940 a interdit le recrutement des femmes mariées dans les services publics, l’arrêt du 7 décembre 1940 prescrit à Mme Pagès de cesser son emploi « dans le plus bref délai permis par les règlements administratifs ». Il invite néanmoins les époux à faire preuve de « bonne volonté à consentir les sacrifices réciproquement nécessaires (…) dans le but de resserrer des liens qui tendent, malheureusement, à se relâcher, d’atténuer, chacun en ce qui le concerne, les particularités de caractère qui heurtent manifestement le conjoint » ; la Cour exhorte même le mari, avant « de mettre à exécution la décision qu’il a librement prise dans l’intérêt de la famille, d’attendre que l’effort de compréhension et d’adaptation mutuelle ait porté ses fruits[14] ».
Ce conseil ne sera pas suivi par M. Pagès. En effet, quelques semaines après avoir reçu l’arrêt, il le signifie à la direction du personnel des Postes et, dès le 11 mars 1941, il écrit au Secrétaire général des postes, télégraphes et téléphones, l’ingénieur en chef des Postes Vincent Di Pace[15], pour se scandaliser que l’arrêt soit resté « inerte ». Il le somme de lui indiquer « à quelle date Mme Pagès cesserait ses fonctions ».
L’administration ne s’empresse cependant pas de régler la situation de Mme Pagès. Comme dans de nombreux services, la tentative de Vichy de mettre le droit à l’unisson d’une idéologie prônant le retour des femmes aux foyers se heurte aux contraintes démographiques[16]. La direction des Postes est alors certainement bien plus occupée à prévenir le risque de pénurie de main d’œuvre – les auxiliaires temporaires recrutées dans l’urgence en 1939-1940 et souvent retors[17] avaient commencé à être licenciées en juillet 1940 mais dès le printemps 1941, la réembauche de personnels féminins était à nouveau nécessaire[18]– qu’à se délester de personnels bien formés et zélés. Les fonctions précises occupées par Mme Pagès, dont le dossier ne paraît pas avoir été conservé par l’administration des Postes, ne sont pas mentionnées, mais celle-ci avait au moins le grade de commis[19].
Par la plume de son directeur du personnel, le Secrétariat général répond le 7 avril à M. Pagès « qu’on était disposé à accepter la demande que l’intéressée formulerait en ce sens, mais qu’il n’appartenait pas à l’administration de prononcer d’office sa mise en disponibilité ». Le 28 mai, la dame Pagès jette l’éponge et demande à l’administration « l’autorisation de cesser son service le 1er juillet 1941 ».
Aucune suite immédiate n’est cependant donnée à ce courrier et l’intéressée continue encore à travailler quelques semaines. Manifestement excédé, le mari saisit directement le Secrétaire d’Etat aux communications, Jean Berthelot, les 11 et 12 juillet 1941, d’« une succession de lettres », invoquant un « préjudice considérable » et exigeant qu’il soit sans délai mis fin aux fonctions de sa femme. Le 26 juillet, le Secrétariat d’Etat confirme l’analyse du Secrétariat général et précise que Mme Pagès a toutefois obtenu un congé sans solde de deux mois à compter du 14 juillet.
M. Pagès ne s’en satisfait cependant pas. Représenté par Me Bernard Auger, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui semblait s’être quelque peu spécialisé dans les droits des femmes[20], il saisit, le 4 août 1941, le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre le refus de l’administration de mettre fin aux fonctions de son épouse. Le 10 octobre, le congé sans solde de Mme Pages est prorogé sans limitation de durée.
B. Une vieille affaire
Le dossier a donc perdu tout intérêt pratique lorsque la section du contentieux – revenue à Paris depuis quelques mois- décide, le 13 octobre 1942, de renvoyer son examen devant l’Assemblée. Dans son dernier mémoire, daté du 30 avril 1942, le requérant fait d’ailleurs état de la « satisfaction qu’il a obtenue du fait de la mise de Madame Pagès en congé illimité[21] ». Et l’intéressée ne s’est même pas présentée au secrétariat général de la préfecture de la Seine pour prendre connaissance de la requête, comme elle y avait été invitée. Pour les époux Pagès, l’affaire est close.
Depuis le retour au pouvoir de Laval,
le gouvernement de Vichy avait également abandonné l’ambition de résister à la
« pente des temps[22] » et de ramener de
manière systématique les femmes dans leurs foyers. L’acte dit loi du 12
septembre 1942 avait ainsi abrogé la loi d’octobre 1940 et admis, formellement,
le recrutement des femmes mariées dans les emplois publics où elles étaient
plus nécessaires que jamais. Pour le gouvernement, la valeur symbolique du
pouvoir du mari de faire obstacle à l’activité professionnelle de sa femme s’était
fortement érodée[23].
Aux yeux de la haute juridiction administrative, en revanche, le dossier Pagès n’avait pas perdu de son éclat. Celle-ci se prononce en effet le 19 février 1943 dans sa formation la plus solennelle. Présidée par le vice-président du Conseil d’Etat, Alfred Porche, elle est composée des hommes situés au cœur de l’institution[24]. Si plusieurs avaient bénéficié d’une récente promotion, la plupart y avaient déjà conquis des places élevées sous la IIIe République. A titre d’illustration de cette continuité institutionnelle, on peut noter que les cinq membres les plus hauts placés de l’Assemblée du contentieux de 1943 avaient déjà délibéré sur l’arrêt Delle Bobard aux conclusions Latournerie du 3 juillet 1936, par lequel le Conseil d’Etat avait admis que l’aptitude légale des femmes aux fonctions publiques puisse être limitée par les nécessités propres à chaque administration[25].
L’arrêt Pagès confirme l’impossibilité pour l’épouse de résister au vœu de son mari et annule les refus de l’administration de mettre fin aux fonctions de la fonctionnaire des Postes. Rendu d’ailleurs (comme beaucoup – toutes ? – de décisions de la même époque) sur un papier à en-tête de la « République française », cette décision s’inscrit dans la continuité d’une politique jurisprudentielle qui n’avait pas favorisé la progression de l’emploi féminin. L’originalité de la décision Pagès n’est donc pas là : elle est avant tout de soumettre les fonctionnaires et leur administration d’emploi au Code civil.
II. L’article 216 du Code civil à l’orée du droit public
Les trois juridictions qui se sont prononcées dans l’affaire Pagès se sont en effet fondées sur un seul et même texte, l’article 216 du Code civil dans ses dispositions issues de la loi du 18 février 1938[26].
Si les juridictions civiles et le Conseil d’Etat appliquent le même
article 216 du Code civil, leurs réponses vont cependant porter sur des
implications différentes du texte.
A. Une loi si peu émancipatrice
Les premières ne se prononcent ainsi pas expressément sur le champ d’application
de la loi du 18 février 1938. Ni le Tribunal de la Seine, ni la Cour d’appel de
Paris ne doutent que le fait d’être employée des postes est une « profession » au sens de l’article
216 du Code civil. La réponse (affirmative) leur paraît sans doute
évidente : avec la révolution administrative, l’employée d’administration,
dont le prototype est la sténo-dactylographe, est en effet devenue la figure
emblématique du travail féminin au XXe
siècle[27].
Ni les commentateurs civilistes[28],
ni les parlementaires[29]
ne semblent d’ailleurs avoir relevé la difficulté.
Est également traitée par prétérition la question de la date à laquelle le mari pouvait s’opposer à l’exercice par sa femme d’une profession séparée. Au cours des débats parlementaires, la possibilité pour le mari de faire obstacle à une activité professionnelle à laquelle il avait précédemment consenti, fût-ce implicitement, avait suscité d’importants débats. Dans leur majorité, les parlementaires considéraient, comme Maurice Viollette, ministre d’Etat du cabinet Chautemps, que « le mari est lié par l’autorisation expresse ou tacite qu’il a donnée[30] ». Mais comme l’avait prévu avec clairvoyance le sénateur (docteur en droit et avocat) Edmond Leblanc, il aurait fallu « l’écrire dans un texte et pas seulement le dire en séance parce que (…) les tribunaux ne font guère état de ce que nous disons ici[31] ! ». Ni le Tribunal ni la Cour ne relèvent ainsi la tardiveté de l’opposition formulée par le mari qui, d’ailleurs, n’était pas invoquée par la dame Pagès. Cette solution, qui était appuyée par une partie de la doctrine civiliste[32], conduisait, en pratique, à un recul des droits des femmes par rapport au système de l’autorisation a priori qui prévalait avant 1938 : la logique de celui-ci était en effet que le mari devait exprimer son consentement antérieurement à l’exercice de la profession.
Mais c’est sur un autre terrain encore que la loi sur la capacité de la femme mariée de 1938 se révélait avoir des effets très éloignés de l’ambition « émancipatrice » dont elle était théoriquement porteuse[33]. Pour octroyer l’autorisation de travailler à Mme Pagès, le Tribunal de la Seine – qui se prononce pendant la « drôle de guerre »- avait relevé que l’opposition de son mari n’était pas conforme à l’intérêt du ménage et de la famille. Après avoir constaté que la fille du couple était « élevée par sa grand-mère paternelle à la campagne, à l’abri des dangers de la guerre »comme du besoin matériel, il avait considéré que la prévention de M. Pagès, lequel faisait feu de tout bois pour entretenir une « atmosphère de crise (…) dans les rapports entre les époux », était « essentiellement arbitraire et injustifiée ». Lorsqu’elle rend sa décision, après l’armistice, la Cour ne remet pas en cause cette appréciation des faits. C’est au motif d’une erreur sur l’étendue du contrôle exercé par le juge civil que le jugement de première instance est infirmé. Aux yeux de la Cour d’appel, « le problème, en effet, n’est pas de rechercher si la solution proposée par le mari est la meilleure pour assurer le maintien de la vie commune, mais simplement de dire si le mari s’est laissé inspirer par des considérations autres que celles de l’intérêt du ménage ou de la famille ». Il ne peut être passé outre l’opposition du mari que « dans le cas où ce dernier se serait laissé guider par des mobiles abusivement autoritaires ou vexatoires » car « la décision appartient toujours au mari », le juge ne pouvant pallier le défaut d’autorisation maritale qu’en cas d’abus ou, en termes publicistes, de détournement de pouvoir.
Cette interprétation est accueillie avec d’importantes réserves par tous les commentateurs de l’arrêt. Elle maintient en effet la femme dans une incapacité plus grande encore que celle issue du régime antérieur à la loi de 1938[34]. Depuis le milieu du XIXe siècle[35], les juges s’étaient reconnus compétents pour autoriser une activité professionnelle lorsque la décision prise par le mari, sans présenter de caractère abusif, ne correspondait néanmoins pas, selon eux, à l’intérêt du ménage. L’avocat Boitard refuse même d’admettre que l’arrêt, difficile à justifier juridiquement, serait « une décision prétorienne mais heureuse, bien dans la ligne de la politique familiale actuelle[36] ». Le Petit Parisien – qui s’est alors rallié au gouvernement de Vichy – intitule avec ironie l’article consacré à la dame Pagès : « La femme est toujours mineure[37] », raillant ainsi cette application à front renversé de la loi de 1938 qui était généralement présentée comme octroyant la majorité à l’épouse.
B. Un double inversé de la décision Blanco ?
A ce concert de critiques, le Conseil d’Etat aurait d’autant plus facilement
pu joindre sa voix que cela l’aurait conduit à confirmer la position
gouvernementale. Ce n’est cependant pas la voie choisie. A la défense du
gouvernement – le Secrétaire général des postes, qui gère l’essentiel de cette
affaire, tant du point de vue administratif que contentieux, est toujours Di Pace-, la haute juridiction préfère
la solidarité avec la Cour d’appel.
Ainsi, alors que la question n’était pas discutée par l’administration,
le Conseil d’Etat commence, explicitement cette fois, par faire cause commune
avec les juridictions judiciaires dans leur interprétation du champ d’application
de l’article 216 du Code civil. La faculté reconnue au mari de s’opposer à ce
que sa femme exerce une profession séparée « a une portée générale et s’étend aux fonctions publiques comme aux
emplois privés », précise ainsi l’arrêt.
Cette formulation, qui revendique l’application par le juge
administratif des dispositions du Code civil, contraste singulièrement avec
celle forgée dans les premières années de la troisième République autour,
notamment, de la décision Blanco[38]. Si, on
le sait bien[39],
le lien établi par le Tribunal des conflits entre la compétence
juridictionnelle et le droit appliqué recueillait une tradition née sous le
second Empire, notamment avec les arrêts Lapeyre[40] et Rothschild[41],
il sert, sous la troisième République, d’ « acte de baptême » au droit administratif[42].
Le succès de la décision Blanco ne doit pas seulement à la référence faite au service
public et à l’indépendance qu’elle accordait aux titulaires du pouvoir exécutif[43].
La justice administrative républicaine a également puisé dans l’éviction du Code
civil une légitimité nouvelle, permettant d’éclipser le soupçon de promiscuité
avec l’administration qui avait failli lui coûter son existence. Dès 1883, le
commissaire du gouvernement Le Vavasseur
de Precourt[44]
exprime clairement cette fonction ; la raison d’être de la juridiction
administrative peut ainsi être présentée comme purement technique, liée à l’application
d’un droit distinct des règles civiles : « Si en matière de dommages causés par les travaux publics, le Code civil
eût dû être appliqué, le législateur de l’an VIII n’aurait eu aucune raison
pour attribuer compétence au sujet de ces dommages à la juridiction
administrative. Comment, en effet, justifie-t-on l’existence d’une juridiction
administrative distincte de l’autorité judiciaire ? On la justifie
historiquement en en rattachant la création au principe de la séparation des pouvoirs ;
mais on la justifie aussi, pratiquement, par ce motif que le caractère des lois
administratives est différent du caractère des lois civiles (…) ».
Certes, l’arrêt Pagès est loin d’être le premier à faire une application directe d’articles du Code civil[45]. Certaines dispositions étaient utilisées de manière traditionnelle et régulière par le juge administratif[46]. Mais il s’agissait souvent de dispositions techniques (intérêt ou prescription) et on peine à trouver des rédactions aussi affirmatives que celles de la décision de 1943. En outre, à l’égard des agents des services publics, le Code civil semble, dans l’entre-deux-guerres, encore utilisé comme un marqueur de la compétence juridictionnelle par le Conseil d’Etat[47].On peut ainsi penser que l’arrêt Sieur Pagès a été conçu par ses rédacteurs comme un double inversé de la décision Blanco, permettant de mettre symboliquement le juge administratif de l’Etat français à distance de l’institution républicaine.
C. Les femmes fonctionnaires : entre statut et contrat
La deuxième question posée au Conseil d’Etat était beaucoup plus délicate et elle est tranchée par la décision, sans être motivée. C’est pourtant sur ce point que s’était concentrée la défense du Secrétaire général des postes, télégraphes et téléphones[48] : celui-ci n’avait en effet pas récusé la possibilité pour le mari de s’opposer à l’emploi public de sa femme ; il avait seulement défendu que ce veto, même validé par le juge judiciaire, n’était pas directement opposable à l’administration. A l’égard des tiers, l’effet de l’interdiction maritale était en effet prévu par l’alinéa 4 de l’article 216 du Code civil dans les termes suivants : « L’opposition valable du mari est une cause de nullité des engagements professionnels contractés par la femme ». Or, faisait valoir l’administration, « s’agissant de fonctionnaires – à la catégorie desquels appartient Mme Pagès – il ne peut plus être question d’engagements contractuels ».
L’argument faisait écho à la thèse défendue quelques années auparavant
par Achille Mestre. Interrogé par
le quotidien Le Temps sur la
possibilité pour le nouveau chef du gouvernement du Front Populaire, Léon Blum, de nommer une femme ministre sans
l’autorisation de son mari, le professeur de droit administratif avait répondu
par un syllogisme : « Le poste
de ministre est une fonction publique. Or, la fonction publique ne comporte pas
de contrat. Donc, la femme mariée peut être ministre sans autorisation du mari
». Explicitant son raisonnement, il précisait que le Code civil ne prévoyait qu’une
incapacité contractuelle alors que la fonction publique, « hors du commerce (…) échappe au régime des contrats[49] ».
Dans le contexte de l’arrêt Sieur Pagès, cette position avait encore marqué un point : en ancrant – après des discussions débutées en 1871- les fonctionnaires dans une logique statutaire, l’acte dit loi du 14 septembre 1941 avait clairement fait le choix de l’exorbitance pour les agents[50] – au moins pour ceux relevant de la catégorie des fonctionnaires, dont était la dame Pagès. Le Secrétaire général, qui n’était pas juriste de formation, pensait sans doute séduire la haute juridiction qui avait guidé la rédaction du statut[51] en faisant grand cas de la qualification du lien unissant un fonctionnaire à l’administration : « la situation du fonctionnaire n’a point, en effet, -il n’est pas besoin d’insister sur ce point unanimement reconnu aujourd’hui en jurisprudence comme en doctrine- de caractère contractuel ; elle est de caractère essentiellement réglementaire ; la loi du 14-9-41 est formelle à cet égard (…). On est ici en présence d’une situation administrative qui, normalement, ne peut prendre fin que par des procédés administratifs à mettre en jeu par l’administration dans les conditions prévues par les règlements ». Et de citer Gaston Jeze plaidant pour une « fonction publique, ‘organisée non point pour le fonctionnaire, mais pour la satisfaction la meilleure possible des besoins communs ».
Mais le Conseil d’Etat ne s’embarrasse pas de ces distinctions théoriques[52] dont il n’avait jamais été friand[53]. Il eût d’ailleurs été pour le moins paradoxal qu’une institution qui se considérait comme un pilier de la révolution nationale freine, au nom d’un statut rédigé sous ses auspices, les effets d’une autorité maritale destinée, au moins en théorie, à protéger la famille. Si elle n’emploie pas le vocabulaire civiliste de l’opposabilité, la haute juridiction impose à l’administration de prendre en compte le veto marital. Saisi par le mari, « le secrétaire d’Etat aux Communications ne pouvait plus, dès lors, maintenir la dame Pagès dans son emploi », assène le Conseil d’Etat ; la protection des intérêts publics pouvait justifier « de prendre toutes mesures utiles au cas où le départ immédiat de celle-ci aurait été de nature à nuire à une bonne marche du service public », mais la marge de manœuvre administrative s’arrêtait à cette faculté de différer – légèrement – la fin des fonctions. Pour le reste, la femme mariée fonctionnaire restait soumise à la puissance de son mari, sans que l’autorité administrative y fasse écran.
Les décisions de la Cour d’appel de Paris, d’une part, et du Conseil d’Etat, d’autre part, s’inscrivent dans des contextes politiques assez différents. En décembre 1940, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris conforte les efforts du régime de Vichy pour valoriser la puissance maritale. Celui du Conseil d’Etat, en février 1943, ne peut en revanche être lu comme inspiré par une volonté de complaire au gouvernement de l’Etat français : d’une part, la haute juridiction annule la décision prise par celui-ci ; d’autre part, l’arrêt réaffirme, avec solennité, un attachement à des valeurs de la révolution nationale que les autorités étatiques avaient largement récusées. Mais si l’arrêt Sieur Pagès traduit ainsi une imprégnation idéologique propre à l’institution, il est surtout remarquable par sa volonté d’afficher solennellement l’harmonie des juges.
Dans leur appréhension de l’affaire Pagès, le Conseil d’Etat et la Cour d’appel de Paris paraissent en effet à l’unisson. Les deux juridictions partagent un texte – l’article 216 du Code civil – et un certain détachement à l’égard de la doctrine universitaire républicaine. Leurs décisions s’efforcent également de restreindre les interférences des autorités étatiques – le juge, pour la juridiction civile, l’administration, pour la juridiction administrative – dans la conduite des affaires familiales pour maintenir une place éminente au chef de famille dont l’autorité ne devait souffrir ni contrôle judiciaire, ni pesanteur administrative. Les connexions sociologiques au sein des mondes judiciaires parisiens sous l’Occupation restent malheureusement mal connues. Mais le dialogue entretenu par la haute juridiction administrative avec la Cour d’appel de Paris à l’occasion de l’affaire Pagès invite à s’interroger sur leur existence.
[1] Voir en dernier lieu J.-M. Sauve,
« Allocution introductive au colloque du 14 novembre 2017 », Jcp
A, 20 juillet 2018, n°29, p. 2212.
[2] G. thuillier,
Les femmes dans l’administration depuis
1900, Puf, Paris, 1988, p. 78
et s.
[3] D., 1945, p.
60.
[4] Le Recueil Lebon (1943, p. 44) indique
qu’il s’agit d’un arrêt de section, mais il s’agit d’une erreur, comme le
confirment la minute et le procès-verbal de la décision, Archives nationales,
20010327/30 et AL/4980.
[5] M. O. Baruch,
Servir l’Etat français. L’administration
en France de 1940 à 1944, Fayard, Paris, 1997, p. 110 et s.
[6] Archives Nationales, AL/5800 n°71620.
[7] J.-L. Halperin, Histoire du droit privé français, Paris, Puf, 1996, p. 214 et s ; C. Bard, Les filles de Marianne. Histoire des féminismes 1914-1940, Paris,
Fayard, 1995, p. 361 et s.
[8] Dans le régime antérieur, le principe était celui de
l’autorisation, expresse ou tacite, du mari à l’exercice d’une profession par
son épouse. Mais la différence pouvait apparaître purement « verbale et spectaculaire », P. Voirin,
« Commentaire de la loi du 22 septembre 1942 », Rtd civ., 1943, p. 76.
[9] Le sénateur Edmond Leblanc, qui défend une version
stricte du droit de veto du mari, évoque essentiellement le cas des femmes employées
par les « entrepreneurs de
spectacles immoraux » scandaleuses et admet que l’autorisation est,
par principe, acquise pour une femme médecin ou avocat, séance du 19 mars 1937,
Journal officiel Débats, Sénat, p. 356.
[10] D. Gardey, La dactylographe et l’expéditionnaire. Histoire des employés de
bureau (1890-1930), Paris, Belin, 2001, p. 259.
[11] 27 novembre 1939, Gaz. Pal. 1941, I, 11.
[12]
Il semble s’agir du même magistrat Werquin qui, à
la Libération, fera l’objet d’une mise à la retraite d’office en raison de sa
participation au fonctionnement et au recrutement des sections spéciales. Cette
mesure sera finalement annulée par le Conseil d’Etat (CE, 4 juin 1947, Werquin,
Rec. T. 604). Un article de La Défense (édition du 19 mars
1948), organe de presse de la section française communiste du Secours rouge
international, s’élève violemment à cette occasion contre la politique
contentieuse du Conseil d’Etat en matière d’épuration administrative.
[13] Vuchot sera membre en 1945 de la commission d’instruction de
la Haute cour chargée du procès de Vichy, F. Kupferman, Le procès de Vichy : Pucheu, Petain, Laval, éditions
Complexe, Paris, 2006, p. 53.
[14] 7 novembre 1940,
Gaz. Pal. 1941, I, 12.
[15] Acte dit
décret de l’Etat français du 20 décembre 1940, Bulletin Officiel des Postes, Télégraphes et Téléphones, n°1
page 2 du 10 janvier 1941.
[16] M.-O. Baruch, op. cit., p. 113.
[17] Archives nationales, Note du 7 mars 1940, F/90/21683.
[18] F. Rouquet, « Le sort des
femmes sous le gouvernement de Vichy », Lien social et politiques, n°36, p. 61 et s.
[19] Mme Pagès est en effet qualifiée sans hésitation de « fonctionnaire » pour l’application de l’acte dit loi du 14 septembre 1941, alors que, dans l’administration des Postes, une note préconisait de ranger dans la catégorie des employés les « dames employées, dames dactylographes, assistantes-receveuses, [et] gérantes de cabine téléphonique » (Archives nationales, F/90/21684).
[20] Son article « Les femmes devant le fisc »
inaugure ainsi la revue l’Information féminine, fondée par Marcelle Kraemer-Bach
en 1927.
[21] Archives nationales, AL/5800, n°71620.
[22] S. Verdeau, L’accession des femmes aux fonctions publiques, Imprimerie moderne
Paillès et Chataigner, Toulouse, 1942, p. 179.
[23] M. Bordeaux, La victoire de la famille dans la France défaite.
Vichy (1940-1944), Paris, Flammarion, 2002, p. 160 et s.
[24] Y siègent, outre le vice-président, le président de la
section du contentieux, Rouchon-Mazerat, les présidents des sous-sections, Durand,
Rousselier,
Blondeau, Josse, Latournerie, Bouffandeau, Gelinet, Dulery, les
conseillers d’Etat
Bonifas, Comolet,
Tirman, Canet, Bouët et le maître des requêtes rapporteur Despres.
Leonard
occupe le pupitre du commissaire du gouvernement.
[25] Sur cette lecture, symétrique à celle présentée par
les Grands arrêts de la jurisprudence
administrative, cf. K. Weidenfeld, « Commentaire de
l’arrêt Dlle Bobard », Les Grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative,
éd. T. Perroud ;
Dalloz, 2019.
[26] Ces dispositions seront transférées à l’article 223 du
Code civil par l’acte du 22 septembre 1942, validé par ordonnance du 9 octobre
1945.
[27] D. Gardey, « Du veston au bas
de soie : identité et évolution du monde des employés de bureau,
1890-1930 », Le Mouvement social, avril-juin 1996, no 175,
p. 72 et s.
[28] P.ex. E. Darrouzet, L’exercice d’une profession par la femme mariée, Thèse pour le
doctorat, Paris, Sirey, 1940 ; R. Aynes, La loi du 18 février 1938 sur la capacité de la femme mariée, Thèse
pour le doctorat, Paris, 1939 ; R. Vuichoud, L’application de la loi du 18 février 1938 sur la capacité de la femme
mariée, Thèse pour le doctorat, Paris, éditions Domat-Montchretien,
1941 ; S. Grinberg et O. Simon,
Les droits nouveaux de la femme
mariée : commentaire pratique et théorique de la loi du 18 février 1938,
Paris, Sirey, 1938.
[29] La question n’est semble-t-il pas abordée dans les
débats.
[30] 17 mars 1938, Jorf
Débats, Sénat, p. 358.
[31] Ibid., p. 357.
[32] E. Darrouzet, op. cit., p. 81 et s.
[33] E. Darrouzet, op. cit.,p. 8 et s.
[34] R. Vuichoud, op. cit., p. 63 et s. Voir aussi la note rapide qui accompagne la
publication du jugement et de l’arrêt à la Gazette
du Palais, 1941 (op. cit.).
[35] Cour d’appel de Paris, 24 octobre 1844, S. 1844, 2, 581 ; Cour d’appel de
Paris, 3 janvier 1868, D. 1868, 2, 28.
[36] S. 1943, 2,
13.
[37] Article d’Edmond Turgis, édition du 7 janvier
1941.
[38] TC, 8 février 1873, p. 61 : « la responsabilité qui peut incomber à l’Etat
dans ce cas ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code
civil pour les rapports de particulier à particulier ». On peut aussi citer,
pour l’exclusion expresse de l’article 1384 du Code civil, TC, 17 janvier 1874,
Ferrandini et Ribetti, p. 70. Et,
pour le cas symétrique, la décision TC, 11 décembre 1880, p. 1000 qui renvoie à
l’autorité judiciaire le soin d’apprécier la responsabilité d’un préfet lorsque
celle-ci n’est recherchée que sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
[39] G. Bigot,
L’autorité judiciaire et le contentieux
de l’administration. Vicissitudes d’une ambition (1800-1872), Lgdj, Paris, 1999, spéc. p. 481 et s.
[40] Pour attribuer à l’autorité judiciaire le jugement de
la responsabilité de l’Etat locataire de bâtiments utilisés comme caserne par
un escadron de cavalerie, le premier Tribunal des conflits se fonde ainsi sur
la nécessité d’appliquer l’article 1733 du Code civil (relatif à la
responsabilité du locataire à l’égard de son propriétaire), TC, 23 mai 1851, Lapeyre, p. 377.
[41] L’arrêt Rothschild,
rendu sur conflit, pare d’un nouvel argument la compétence de la
juridiction administrative lorsque la responsabilité de l’Etat agissant dans le
cadre d’un service public était mise en cause : l’impossibilité de l’apprécier au
regard des dispositions du seul droit civil, CE, 6 décembre 1855, Rec. 705.
[42] G. Bigot, Les mythes fondateurs du
droit administratif, Rfda, 2000, p. 527.
[43] J.-C. Ricci, « La difficile
affirmation du juge administratif (1840-1873). Variations autour des arrêts
Rothschild et Blanco », dans ce même
volume.
[44] Conclusions sous CE, 11 mai 1883, Sieur et dame Chamboredon et
sieur Brahic c/ Compagnie de
Paris-Lyon-Méditerranée, Rec. 481.
[45] X. Mondesert, « Le Code civil
et le juge administratif », Centre
de Recherches des Droits Fondamentaux, n°4, 2005, p. 179.
[46] Les articles 1153 et 1154 du Code civil, sur les
intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts, font ainsi l’objet d’une
jurisprudence abondante dès 1856-1857, Tables du recueil Lebon 1849-1858, p. 435.
[47] Ainsi, lorsqu’à l’occasion d’un licenciement, une
indemnité de rupture est réclamée sur le fondement de l’article 1780 du Code
civil, celui-ci récuse sa compétence, CE, 6 mai 1921, Sieur Mourgues,
Rec. 450 ; CE, 30 janvier 1924, Sieur Segaud,
Rec. 118.
[48] Mémoire du 7 avril 1942, Archives nationales, AL/5800
n°71.620.
[49] Le Temps, 1er juin 1936, p. 6.
[50]
G. Thuillier, « Le statut des fonctionnaires
de 1941 », La Revue
administrative, 1979, n° 191, p.
480 et s.
[51] Le président Josse qui participait à la
délibération de l’Assemblée du contentieux avait notamment rapporté sur le
projet de statut devant l’Assemblée générale du Conseil d’Etat. M.-O. Baruch,
« Le Conseil d’Etat sous Vichy », La
Revue administrative, numéro spécial, 1998, p. 57 et s.
[52] P.-Y. Moreau, « Contrer le
contrat. Léon Duguit
et Maurice Hauriou,
inventeurs du statut des fonctionnaires », Rdp, 2016, n°4, p.
1063 et s.
[53] CE, 7 août 1909, Winkell et Rosier, Rec. 826.
Nota Bene : le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso. Vous pouvez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).