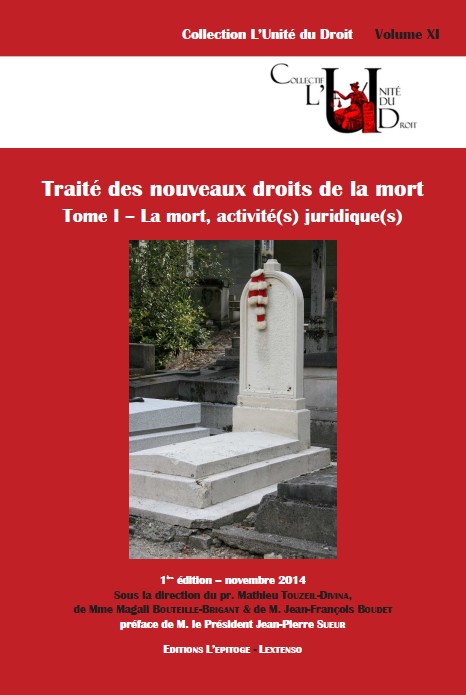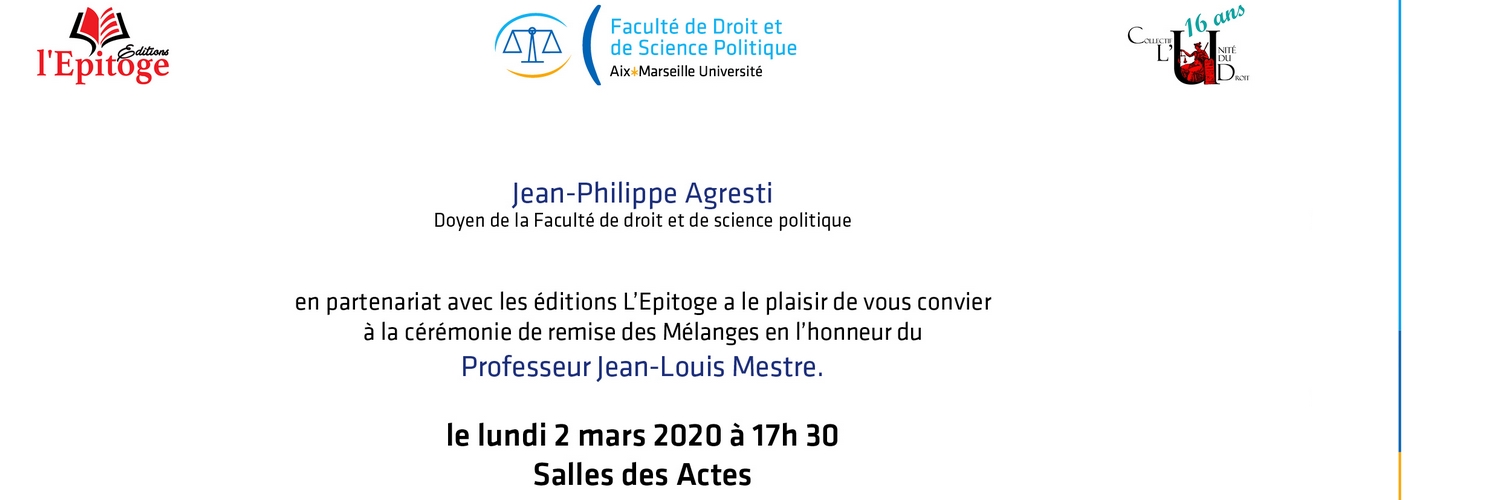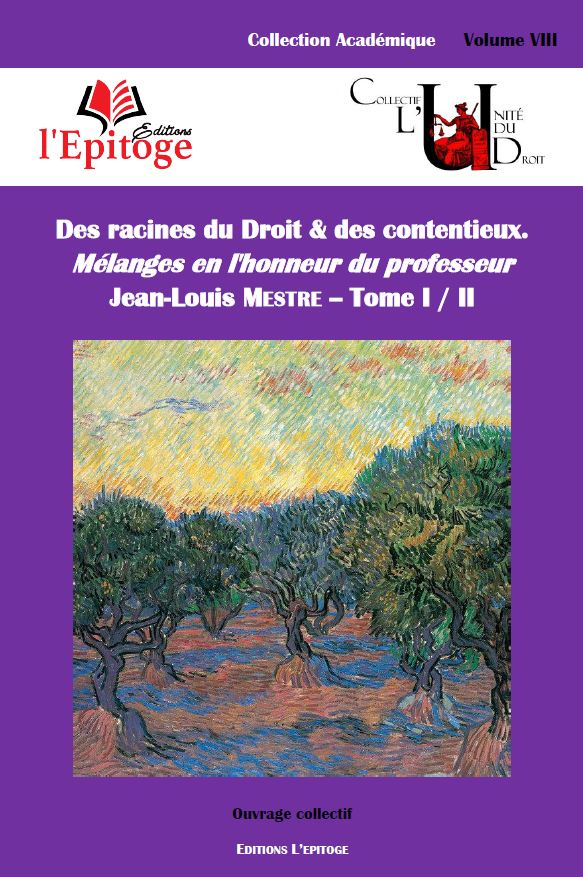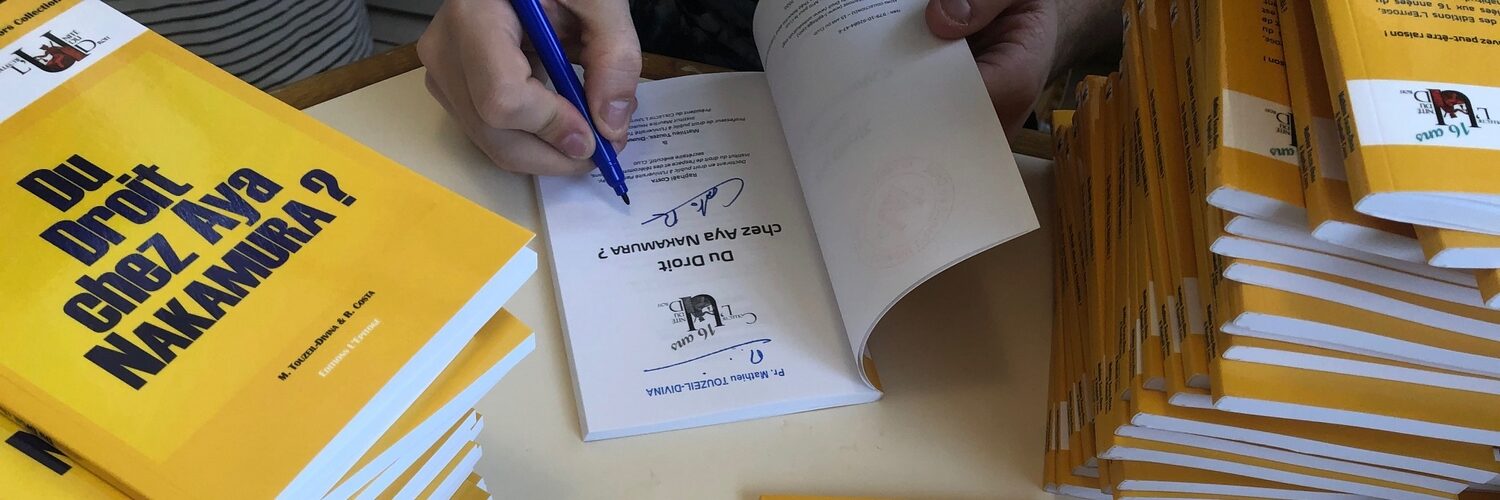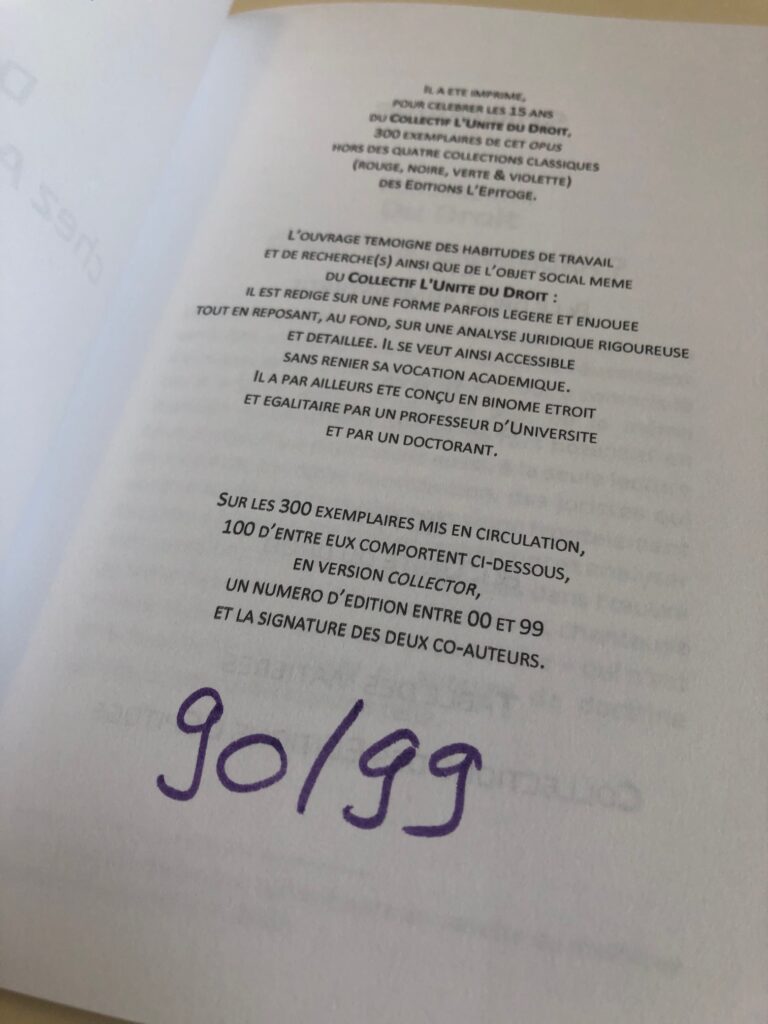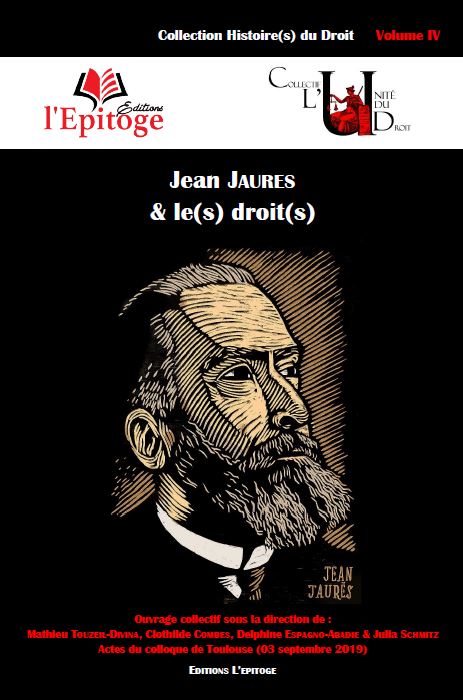Voici la 29e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait des 17e & 18e livres de nos Editions dans la collection L’Unité du Droit, publiée depuis 2012.

Volume XVII : Federalisme, Decentralisation
et Regionalisation de l’Europe :
Perspectives comparatives (I / II).
Federalism, Decentralisation
and European Regionalisation :
comparative Perspectives (I / II).
direction :
Sylvia Calmes-Brunet & Arun Sagar (collectif)
– Nombre de pages : 258
– Sortie : février 2017
– Prix : 39 €
- ISBN / EAN : 979-10-92684-17-9 / 9791092684179
- ISSN : 2259-8812

Volume XVIII : Federalisme, Decentralisation
et Regionalisation de l’Europe :
Perspectives comparatives (II / II).
Federalism, Decentralisation
and European Regionalisation :
comparative Perspectives (II / II).
direction :
Sylvia Calmes-Brunet & Arun Sagar (collectif)
– Nombre de pages : 272
– Sortie : février 2017
– Prix : 39 €
- ISBN / EAN : 979-10-92684-18-6 / 9791092684186
- ISSN : 2259-8812

Présentation :
« Dans cet ouvrage pluridisciplinaire, trente-deux auteurs de treize nationalités différentes, juristes (publicistes et privatistes), politologues, économistes, géographes, historiens ou civilisationistes, s’interrogent sur le phénomène actuel de réorganisation territoriale des Etats, qu’ils soient fédéraux ou unitaires, dans le cadre d’un nouveau contexte géopolitique et économique global. La question se pose de savoir si, de manière générale ou sur certains espaces, ce phénomène révèle une dynamique de répartition centrifuge du pouvoir entre plusieurs échelons, ou s’il cache au contraire, de manière plus ou moins assumée, une certaine re-centralisation du pouvoir. L’étude comparative des régions/Etats fédérés et des autres démembrements de l’Etat, et de leur inscription respective non seulement dans leur Etat national mais également dans une Europe aux tendances toujours plus fédérales qui se développe elle-même dans un monde toujours plus régionalisé, révèle que le fédéralisme, la décentralisation et la régionalisation correspondent à des processus dynamiques et évolutifs, en mouvement et jamais figés. Il n’existe par conséquent pas de « modèles » d’organisation étatique, infra-étatique et supra-étatique, mais des tendances lourdes, communes ou opposées, et une grande variété de formes, toutes plus ou moins centralisées, qu’elles soient formellement qualifiées de décentralisées, régionalisées ou fédérales. Quant à l’« Europe des Régions », elle apparaît aujourd’hui comme un « mirage » et laisse place à l’idée d’une Union européenne décentralisée, plus réaliste, qui constitue elle-même une « macro-région » (non étatique) à l’échelle mondiale, mais qui est actuellement confrontée à des crises multiples (économique, migratoire, écologique…) qui ternissent son image et dévoilent son impuissance. L’Union européenne doit dès lors regagner sa crédibilité interne avant de repenser son rôle international, notamment sa politique de voisinage ».
Vers une Europe fédérale
ou une Europe des Régions ?
Ni l’une, ni l’autre :
une Europe décentralisée
Nicolas Kada
Professeur de droit public, Codirecteur du Crj, Université Grenoble-Alpes
Codirecteur du Grale Gis Cnrs[1]
Autant l’avouer d’emblée, n’est-ce pas un beau trop audacieux que de vouloir identifier une européanisation des collectivités territoriales ? Il existe en effet un statut d’Etat membre de l’Union européenne qui trouve place dans l’ordre constitutionnel de l’Union et qui s’apparente à un ensemble de droits et obligations liant chaque Etat de façon directe et réciproque à l’Union ; mais il n’existe pas de statut européen équivalent pour les collectivités territoriales dans l’Union. L’autonomie locale demeure donc traditionnellement une question nationale, « placée par principe hors du champ d’intervention de l’Union et saisie au plan européen par la médiation des Etats. Ces derniers gardent la maîtrise de leur intégrité territoriale, dont le respect s’impose à l’Union européenne, notamment quand certaines Communautés infra-étatiques aspirent à en être déliées ou en présence de phénomènes d’annexion de territoires de l’Union » comme le décrit Laurence Solis-Potvin[2].
Pourtant, l’autonomie locale et ses différentes déclinaisons dans les Etats s’inscrivent bien dans le processus d’européanisation du droit, comme en témoigne le traité de Lisbonne qui a affirmé la dimension régionale et locale du principe du respect par l’Union de l’identité nationale de ses Etats : « L’Union respecte l’égalité des Etats membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l’Etat, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale » (article 4-2 Tue). De même, et plus largement encore, l’autonomie locale peut être rapprochée de la Charte européenne de l’autonomie locale, désormais ratifiée par l’ensemble des 47 Etats signataires dont les 28 Etats membres de l’Union européenne. Dès lors, loin de constituer un ‘non-sujet’ du droit de l’Union européenne, les collectivités territoriales et plus largement l’autonomie locale illustrent finalement assez bien l’ambivalence qui lie les institutions à l’européanisation : est-ce une européanisation subie ou une européanisation bienvenue ? Est-ce une contrainte ou un facteur positif d’évolution ? Est-ce une menace ou une chance ? Doit-on en déduire l’existence d’un droit européen des collectivités territoriales ?
Et si européanisation du concept il y a, celle-ci se double-t-elle d’une européanisation des structures ? Peut-on encore parler de « l’Europe des régions » à l’heure où la régionalisation semble effectivement être une tendance commune de l’évolution de l’organisation territoriale des Etats européens depuis une trentaine d’années ? Mais est-ce pour autant toujours le niveau régional qui répond le mieux aux besoins de la territorialisation des politiques communautaires, allant jusqu’à constituer les prémices d’une convergence institutionnelle entre Etats membres ? Des indicateurs auraient pu le suggérer, à l’image de la résolution du Parlement européen du 18 novembre 1998 invitant les Etats à régionaliser leurs structures administratives en respectant une « Charte communautaire de la régionalisation [3] ». Néanmoins, Gérard Marcou[4] a certainement raison de nuancer un tel enthousiasme uniformisateur : « Bien que certains auteurs continuent de s’y référer, l’idée d’une Europe des régions a perdu aujourd’hui une grande partie de son crédit et n’est plus guère soutenue, en raison des problèmes de définition que soulève la notion de région et de la position que conservent les Etats, dont, notamment, continue de dépendre l’essentiel des moyens dont disposent les collectivités territoriales, y compris les régions les plus fortes et les Etats fédérés ». D’ailleurs, la Charte précitée n’a eu finalement qu’un faible écho et n’a certainement pas constitué la source d’inspiration d’une quelconque régionalisation.
Cette idée mythique d’une Europe des régions ne cesse néanmoins d’alimenter les débats, tant elle semble prendre vie à travers le droit communautaire et les institutions européennes. Les traités comme le droit dérivé ont en effet cherché à susciter ou amplifier le rôle des régions dans la construction européenne. Ils sont même parvenus à leur reconnaître officiellement une place au sein des institutions européennes (I). Cette idée se heurte cependant à une réalité incontestable : le respect des souverainetés étatiques, qui demeure un principe fondamental en dépit de l’adoption par les collectivités territoriales de stratégies – plus ou moins efficaces – de contournement des Etats et l’avènement, de fait, d’une Europe décentralisée (II).
I. Un mirage : l’Europe des régions
Face à une réelle diversité des constructions étatiques, faut-il renoncer à identifier une conception européenne de la régionalisation ? Celle-ci existe, mais sans doute doit-on la lire ‘en creux’, c’est-à-dire au fil de dispositions inscrites dans les traités communautaires ou à la lumière de la politique régionale de l’Union, ou encore au gré des mécanismes d’association des représentants des collectivités territoriales à la prise de décision. Si les Etats demeurent en effet incontournables, ils ont cependant accepté que leurs propres institutions régionales puissent avoir un lieu officiel d’expression – le Comité des régions – ainsi qu’un accès plus officieux au processus décisionnel communautaire.
A. Par la référence aux textes
Le niveau régional est largement présent dans le droit européen : il est en effet visé par les traités mais aussi pris en compte par le droit dérivé, notamment à travers la politique de cohésion de l’Union et les fonds que l’on désigne traditionnellement comme structurels.
i. Un renvoi aux régions dans les traités
Certes, les communautés européennes consistent tout d’abord en une association d’Etats, mais les traités fondateurs envisagent tout de même la dimension régionale – ou au moins infra-étatique – de la construction européenne. Ainsi peut-on lire au 6e alinéa du préambule du traité de Rome du 25 mars 1957 que « renforcer l’unité des économies [des Etats membres] et en assurer le développement harmonieux en réduisant l’écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées » est l’un des objectifs des communautés européennes. Il s’agit alors d’une approche certes modeste, reposant essentiellement sur une volonté d’harmonisation économique, mais porteuse d’évolutions ultérieures. La rédaction est en effet très générale, ce qui ménage les compétences des nouvelles institutions et respecte les différences entre Etats membres[5]. On peut donc véritablement parler d’une position très prudente des rédacteurs des traités, précaution qui s’exprime dans l’approche principalement économique du développement régional qui est alors privilégiée. Ainsi, par exemple, l’article 92 du traité CE stipule que sont compatibles avec le marché commun « les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi » ou « les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun[6] ».
L’Acte unique européen introduit en 1986 quelques nouveautés, en précisant notamment certains points seulement évoqués à l’origine. Ainsi, l’article 130a de l’Acte unique retient l’attention en consacrant la « cohésion économique et sociale » et la réduction des écarts entre régions au rang d’objectif communautaire. En effet, autant le nouvel article 130a n’innove pas en reprenant le texte initial de 1957 (« la Communauté vise à réduire l’écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées »), autant l’alinéa qui précède permet une nouvelle approche d’un principe désormais classique au niveau des objectifs : « Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale ». De même, l’article 130c impose la correction des déséquilibres régionaux et des ajustements structurels. L’Acte unique précise en outre les attributions du Fonds européen de développement régional (Feder), créé en 1975 et « destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté par une participation au développement et à l’ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin ». L’intervention du Feder s’articule avec d’autres fonds : la section « Orientation » du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (Feoga) et le Fonds social européen (Fse).
Dans le cadre du Traité sur l’Union européenne, une meilleure répartition des compétences entre la Communauté et les Etats membres en matière d’aménagement du territoire et de développement régional semble se dessiner, avec l’introduction du principe de subsidiarité. Et le Comité des Régions constitue une véritable reconnaissance institutionnelle du rôle joué par les collectivités décentralisées. Quant au projet initial de traité établissant une Constitution pour l’Europe (traité de Rome du 29 octobre 2004)[7], quelques points pouvaient retenir l’attention en matière de libertés locales, traduisant juridiquement une reconnaissance de l’existence des collectivités territoriales et de leur rôle dans la structure institutionnelle des Etats membres. Ainsi, deux articles en particulier stipulaient pour l’un que « l’Union respecte l’identité nationale de ses Etats membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris ce qui concerne l’autonomie locale et régionale[8] » et, pour l’autre, qu’« en vertu du principe de subsidiarité, l’Union intervient seulement dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres tant au niveau central qu’au niveau régional ou local[9] ». La réécriture partielle du texte, sous forme de traité dit « simplifié », a abouti au traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 par tous les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres. Ce nouveau traité élargit sensiblement le rôle des collectivités dans le processus de décision en reconnaissant un pouvoir supplémentaire au Comité des régions. A l’instar de ce que prévoyait le projet de Constitution en 2005, l’article 8 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité du traité de Lisbonne octroie au Comité des régions la possibilité d’invoquer la violation du principe de subsidiarité par un acte législatif devant la Cour européenne de justice, et ce dans la limite des actes sur lesquels sa consultation est obligatoire.
De plus, ajouté au traité de Lisbonne, le deuxième protocole sur la subsidiarité et la proportionnalité réaffirme la valeur de ces principes. Au-delà du contrôle renforcé appliqué au principe de subsidiarité, le traité de Lisbonne donne davantage de place aux collectivités locales. Le texte reconnaît en effet que ce principe, traditionnellement appliqué aux relations entre la Communauté et les Etats membres, jouera aussi au profit des collectivités. Mais le traité reconnaît également pour la première fois explicitement le principe d’autonomie locale et régionale. L’article 4 du nouveau texte rappelle en effet que l’Union respecte les identités nationales, « y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale ». Cet article reprend d’ailleurs la formulation retenue dès la première version du traité.
Si l’Union européenne prend donc en considération de manière explicite les compétences des collectivités dans le traité, la reconnaissance de l’autonomie locale par le texte n’aura que peu d’impact pour la France, qui a particulièrement hésité avant de reconnaître officiellement cette notion et toutes ses implications. En outre, il n’existe pas en France de parlements régionaux disposant d’un pouvoir législatif.
Par ailleurs, le texte fait de la cohésion territoriale un objectif de l’Union européenne et celle-ci devra donc désormais prendre en considération les conséquences locales et régionales des politiques communautaires. La Commission européenne aura ainsi pour mission de veiller à limiter les charges financières incombant aux pouvoirs locaux pour la mise en œuvre d’une législation communautaire.
Mais le traité de Lisbonne présente aussi indirectement des avancées pour les collectivités. Ainsi, la codécision devient la règle. En effet, il s’agit désormais de la procédure ordinaire. La codécision élargit ainsi les compétences du Parlement et favorise donc indirectement la prise en compte des intérêts des collectivités dans le processus décisionnel communautaire. Par voie de conséquence, le renforcement des pouvoirs du Parlement européen en fait l’institution la plus sensible aux intérêts des collectivités locales. Depuis l’Acte unique européen, les compétences de cette assemblée n’ont d’ailleurs cessé d’être accrues. Enfin, les Pays-Bas et la France ont obtenu l’ajout d’un protocole sur les services publics, soulignant l’importance des services d’intérêt général et mentionnant « le rôle essentiel et la grande marge de manœuvre des autorités nationales, régionales et locales » pour l’organisation et la fourniture des services d’intérêt économique général. Cette disposition, qui donne une base juridique à une législation transversale sur les services d’intérêt général, répond aux attentes des collectivités.
Mais les traités ne sont – fort heureusement – pas les seules sources de droit communautaire à prendre en compte le fait régional. Le droit européen dérivé, dans tous ses aspects, concerne aussi directement les collectivités territoriales. C’est notamment le cas de la politique de cohésion.
ii. Une déclinaison par la politique de cohésion
Certes, l’Union européenne est assurément l’un des espaces les plus riches du monde, mais il existe entre ses régions d’énormes différences de niveaux de richesse et de développement. Ces écarts, loin de se réduire, se sont bien évidemment encore accentués avec l’arrivée, au printemps 2004, de dix nouveaux Etats membres, dont le revenu par habitant est généralement inférieur à la moyenne de l’Union. Face à ce constat, la politique régionale a toujours eu pour ambition de procéder à des transferts de ressources des régions les plus prospères vers les régions les plus pauvres[10]. Cette politique est conçue à la fois comme un instrument de solidarité financière, un vecteur d’intégration économique et un moyen de parvenir à davantage de cohésion territoriale. Mais une telle politique ne peut se concevoir de la même manière, à quinze ou à vingt-huit, même si les concepts de solidarité et de cohésion résument les valeurs qui animent la politique régionale de l’Union. En effet, elle correspond tout d’abord à un objectif de solidarité, car la politique régionale vise à favoriser les citoyens et les régions économiquement et socialement défavorisés par rapport à la moyenne de l’Union européenne. Ensuite, l’objectif de cohésion[11] est lui aussi évident, car tout un chacun est censé tirer avantage de la réduction des écarts de revenus entre les Etats membres et entre leurs entités régionales. L’existence d’importantes disparités en termes de prospérité entre les Etats membres et à l’intérieur des Etats membres eux-mêmes n’est pourtant pas une nouveauté en elle-même. En effet, avant même l’élargissement, les dix régions les plus dynamiques de l’Union européenne avaient un niveau de prospérité, mesuré en termes de produit intérieur brut (Pib) par habitant, environ trois fois supérieur à celui des dix régions les moins développées[12].
Depuis 1975, la politique de l’Union européenne visant à réduire les disparités régionales s’articule autour de quatre fonds structurels : le Feder, le Fse, la section du Feoga consacrée au développement rural et le soutien financier apporté aux communautés dépendantes de la pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche (Pcp). Mais, avec l’élargissement, la superficie et la population de l’Union ont augmenté de 20 % alors que le Pib n’a augmenté lui que de moins de 5 %. Le Pib des nouveaux Etats membres varie entre environ 35 à 40 % pour les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) et 72 % de la moyenne de l’Union pour Chypre. Outre la politique régionale stricto sensu, afin d’aider les nouveaux venus à s’adapter à leur nouvelle situation de membres de l’Union et à commencer à réduire l’écart de richesse qui les sépare des autres Etats membres, l’Union européenne avait créé en plus pour la période 2000-2006 des programmes financiers sur mesure[13].
En dépit de tous ces efforts, les différences de développement entre les régions ne pouvaient néanmoins se réduire rapidement. Seule une politique régionale établie sur le long terme est susceptible de porter ses fruits. Mais de nouvelles clés de répartition devaient cependant être définies, afin de tenir compte des spécificités du dernier élargissement. Depuis la période 2007-2013, les procédures ont été simplifiées et les aides concentrées sur les régions les plus démunies des vingt-huit Etats membres. L’Union européenne s’est dotée d’un budget pour la politique régionale d’un peu plus de 347 milliards d’euros, ce qui représente toujours environ un tiers de son budget total. En France, un décret du 28 février 2015 est venu préciser le fonctionnement du nouveau Comité Etat-régions chargé de superviser l’utilisation des 26 milliards d’euros de fonds européens, dont la France dispose jusqu’en 2020. Prévue dans la loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique et à l’affirmation des métropoles (Maptam), la décentralisation des fonds européens se décline à présent sur le terrain, les régions ayant entamé la mise en œuvre de leurs programmes d’investissement d’ici 2020. Dans ce domaine, le degré de transfert de compétences varie fortement : si les conseils régionaux ont le champ libre pour programmer les actions relevant du Feder (innovation, infrastructures, etc.), ils n’ont la main que sur 35% du Fse et restent très contraints par le cadre national des aides aux agriculteurs concernant la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). L’Etat veille d’ailleurs à maintenir une supervision globale du dispositif, comme en témoigne le fonctionnement du comité dédié. Sa composition varie en fonction de la nature des questions traitées. Les enjeux transversaux (mise en œuvre de l’accord de partenariat, espaces inter-régionaux, actions financées par plusieurs fonds européens, etc.) dépendent du Premier ministre et du président de l’Association des régions de France (Arf). A l’échelle plus locale, la programmation des actions financées par les fonds européens continue de donner lieu à des comités coprésidés par le président de la région concernée et le préfet.
B. Par le jeu des institutions
Au-delà des dispositions contenues dans les traités et des mécanismes prévus par la politique de cohésion, les régions constituent donc une réalité en Europe, même si cette réalité emprunte des voies différentes d’un Etat membre à l’autre. Par conséquent, il semble logique et légitime de permettre à ces collectivités décentralisées de faire valoir par elles-mêmes leur point de vue auprès des institutions européennes. Cette collaboration utilise deux voies : l’association officielle, par l’intermédiaire du Comité des régions, et l’association plus officieuse, à travers le lobbying et les bureaux de représentation.
i. Une association officielle : le Comité des régions
Le Comité des régions[14] est l’assemblée politique qui fait entendre la voix des collectivités territoriales au cœur même de l’Union européenne. Mis en place en 1994, il a été créé afin d’aborder deux grandes problématiques. En premier lieu, environ trois quarts de la législation communautaire sont mis en œuvre au niveau local ou régional : il était donc logique que les représentants des collectivités locales et régionales aient leur mot à dire dans l’élaboration des nouvelles lois communautaires. En second lieu, l’on craignait à l’époque que les citoyens ne soient laissés à l’écart de la construction de l’Union. Dans cette perspective, associer le niveau de gouvernement élu le plus proche du citoyen était l’une des manières de combler ce fossé. Le Comité des régions est actuellement composé de 350 membres et d’un nombre égal de suppléants, en fonction du poids démographique et parlementaire de chaque Etat au sein de l’Union européenne[15]. Tous ces membres sont nommés pour quatre ans par le Conseil sur proposition des Etats membres. Chaque pays choisit ses membres selon une procédure qui lui est propre, mais les délégations reflètent l’ensemble des équilibres politiques, géographiques et régionaux/locaux de leur Etat membre. Les membres du Comité sont soit des élus, soit des acteurs clefs des collectivités locales et régionales de leur région d’origine.
Le Comité organise ses travaux par le biais de ces six commissions spécialisées. Celles-ci examinent en effet dans le détail les propositions sur lesquelles le Comité est consulté et élaborent un projet d’avis. Ce texte a pour objectif de souligner les points d’accord avec les propositions de la Commission européenne et de proposer éventuellement des modifications pour améliorer le document initial. Le projet d’avis est ensuite examiné lors de l’une des cinq sessions plénières annuelles. S’il est approuvé à la majorité, il est considéré comme adopté et devient un avis du Comité des régions. Il est alors transmis à la Commission, au Parlement européen et au Conseil. Enfin, le Comité des régions peut également adopter des résolutions portant sur des questions d’actualité politique. Les traités font obligation à la Commission et au Conseil de consulter le Comité des régions pour toute proposition formulée dans un domaine ayant des répercussions sur le niveau local ou régional. Le traité de Maastricht en définit cinq : la cohésion économique et sociale, les réseaux d’infrastructure transeuropéens, la santé, l’éducation et la culture. Le traité d’Amsterdam a ajouté à cette liste cinq secteurs supplémentaires qui couvrent désormais une bonne partie de champ d’action communautaire : la politique de l’emploi, la politique sociale, l’environnement, la formation professionnelle et les transports. En dehors des domaines précités, la Commission, le Conseil et le Parlement européen ont la possibilité de consulter le Comité des régions sur toute proposition susceptible, selon eux, d’avoir des conséquences locales ou régionales. Le Comité des régions peut en outre élaborer des avis d’initiative, ce qui lui permet de faire figurer certaines questions à l’ordre du jour de l’Union européenne. Il s’agit bien d’une forme d’européanisation des collectivités décentralisées puisque, comme le souligne Pierre-Alexis Féral[16], trois principes fondamentaux sont au cœur des travaux du Comité : la subsidiarité, la proximité et le partenariat.
ii. Une association officieuse : le lobbying
Il y a un compromis et un équilibre à trouver entre la défense des intérêts nationaux (tâche classique de l’Etat), le souci légitime des collectivités territoriales de se faire entendre et de s’informer, et la nécessité d’une unité d’action vis-à-vis de la Commission. D’où la volonté de certaines régions d’entretenir des bureaux permanents à Bruxelles, à Strasbourg ou à Luxembourg. Mais, à l’instar de la situation française, toutes les collectivités décentralisées n’optent pas pour une telle représentation soit par volonté d’économie, soit par manque d’intérêt, ou par simple respect d’une conception orthodoxe du rôle de l’Etat[17]. Ces bureaux de représentation ont trois fonctions principales. Tout d’abord, ils remplissent une mission d’information : cela signifie être informé en temps utile des projets européens (favorables ou menaçants), mais aussi pouvoir informer les institutions européennes d’expériences locales menées çà et là, dans une logique d’influence constructive de la décision européenne. Cela signifie aussi être informé de ce que font les autres acteurs, voire de dénoncer auprès de Bruxelles les infractions relevées chez les acteurs concurrents. Par ailleurs, ils permettent d’exercer du lobbying : longtemps pratiqué en cachette, il constitue désormais une activité à part entière et reconnue comme nécessaire, en tout cas acceptée par tous. Même les institutions européennes y trouvent leur compte, en ayant face à elles des interlocuteurs clairement identifiés sans avoir besoin d’aller systématiquement les rechercher pour tester une idée. Enfin, il ne faut pas négliger leur rôle en matière de prospection économique : il s’agit du choix effectué par exemple par la région Rhône-Alpes, avec la volonté de privilégier la recherche d’investisseurs étrangers, même si cette démarche présente forcément des limites en raison de données objectives difficilement négociables : coût et qualification de la main d’œuvre, infrastructures, espaces disponibles pour une éventuelle implantation, etc.
Si de telles pratiques ont pu choquer à une époque en raison de leur éloignement avec la conception française traditionnelle de la représentation élective[18], les collectivités décentralisées et l’Etat ont désormais tout à fait intégré les enjeux d’un tel lobbying et cherchent à rivaliser avec les groupes de pression anglo-saxons, familiers de cette « démocratie de couloir[19] ».
II. Une réalité : l’Europe décentralisée
Le renforcement de la participation des régions au processus décisionnel européen, que ce soit dans le cadre de relations directes ou par l’intermédiaire du Comité des régions, est donc une réalité. Mais cette réalité est naturellement limitée à la fois par l’hétérogénéité institutionnelle des Etats membres et leur volonté de préserver leur situation monopolistique de représentation au sein de l’Union européenne. Cette dernière demeure fondamentalement une union d’Etats souverains, qui ne consentent que partiellement à des transferts de souveraineté à son profit et qui n’entendent pas se laisser déposséder par leurs propres collectivités décentralisées d’éléments constitutifs de leur souveraineté. Mais ce respect des souverainetés étatiques n’interdit pas pour autant le développement et la promotion de la décentralisation au sein de l’Union européenne, que ce soit au niveau local, national ou européen. En effet, les différentes collectivités territoriales comme les institutions européennes n’hésitent pas à recourir à de véritables stratégies de contournement, encouragées en cela par le Conseil de l’Europe.
A. Une préservation des intérêts étatiques
Les collectivités territoriales se trouvent associées au processus décisionnel européen de deux manières. Tout d’abord, les entités locales défendent leurs intérêts par l’intermédiaire de leur Etat de rattachement qui se montre soucieux du respect des principes fondamentaux en la matière. Par ailleurs, les collectivités décentralisées n’hésitent pas à développer une collaboration directe, officielle ou plus discrète, avec les institutions communautaires. La prise en compte de la dimension européenne par l’administration étatique française est à cet égard une illustration très éclairante.
i. Une pétition de principe
Les Etats entretiennent des relations très différentes avec le niveau supranational et le niveau infraétatique. En effet, si les rapports avec les institutions communautaires sont placés sous le signe d’une confiance réciproque, les Etats se montrent à l’inverse sensiblement plus méfiants à l’égard de leurs collectivités décentralisées, dont ils continuent à contrôler les actes.
Il existe tout d’abord une association évidente – mais parfois oubliée – des Etats membres au sein du Conseil européen, réelle instance de décision sans pour autant être toujours formellement identifiée comme telle. Ainsi, comme le souligne Henri Oberdorff[20], « il n’est pas de tradition de traiter le Conseil européen dans les institutions de décision car cette instance a un statut un peu à part dans le processus de décision […]. Le Conseil européen ne fait pas partie du fameux triangle institutionnel que constituent le Conseil, la Commission et le Parlement. Pourtant, sa fonction contribue aux évolutions les plus importantes de l’Union ». Instance singulière, le Conseil européen résulte principalement du recours régulier à des sommets européens (depuis celui de La Haye en 1969) pour définir de nouvelles orientations, dépasser une crise ou débloquer une situation politique tendue. Si l’européanisation des régions était une politique officielle, elle aurait fait l’objet d’une analyse précise de la part du Conseil européen et aurait certainement donné lieu à une déclaration commune proclamant une volonté unanime d’uniformiser l’organisation et les compétences des régions au sein de l’Union. Or, à ce jour, aucun Conseil européen n’y a consacré un quelconque ordre du jour, car l’idée peut séduire mais recouvre des réalités très différentes d’un Etat à l’autre. Dès lors, parce que chaque Etat membre entend préserver sa souveraineté en ce qui concerne son organisation territoriale, la décentralisation demeure un sujet politique sensible dont le Conseil européen n’a pas encore souhaité se saisir. Cette absence traduit tout simplement une réalité : l’administration territoriale reste d’abord et avant tout une ‘affaire intérieure’ à chaque Etat. L’Union européenne serait par conséquent bien mal avisée de vouloir imposer une réglementation uniforme en la matière… même si elle s’y emploie indirectement par d’autres voies.
En effet, l’Union européenne a nécessairement besoin des Etats membres – et de leurs administrations territoriales – afin de les utiliser comme relais d’exécution de son droit et de ses politiques. De fait, l’Union européenne ne dispose pas d’une infrastructure administrative suffisante pour procéder elle-même à cette mise en œuvre. C’est ce que l’on appelle le « loyalisme communautaire », que les Etats ont formellement accepté à travers l’article 10 du traité de Rome de 1957. Proche de celui de loyauté fédérale, ce principe impose aux Etats de ne pas entraver la mise en œuvre du droit communautaire. La Cour de justice des Communautés européennes (Cjce) a eu plusieurs occasions de les rappeler à leurs obligations[21].
Cependant, le loyalisme inscrit dans les traités doit composer avec un autre principe : celui de l’autonomie institutionnelle, lui-même défendu et protégé par la Cjce. Ainsi, par exemple, dans une affaire du 15 décembre 1971 relative à une épineuse question de répartition des compétences, la Cour a fait valoir que « la question de savoir de quelle façon l’exercice de ces pouvoirs et l’exécution de ces obligations peuvent être confiés par les Etats membres à des organes déterminés relève uniquement du système constitutionnel de chaque Etat membre[22] ». De même, dans une autre affaire en date du 25 mai 1982, la Cjce rappelle que « chaque Etat membre est libre de répartir comme il le juge opportun les compétences sur le plan interne et de mettre en œuvre une directive au moyen de mesures prises par les autorités régionales ou locales[23] ».
C’est ainsi que la notion d’autonomie sous-entend une limitation des pouvoirs locaux par le législateur, seul à même de maintenir un équilibre entre intérêt général, intérêt public local et préservation des droits individuels. Ainsi, comme le rappelle Roselyne Allemand[24], « la notion d’autonomie exclut la subordination à une autorité supérieure mais autorise le contrôle des actes locaux afin de vérifier que ceux-ci sont conformes aux normes juridiques supérieures ». En la matière, si l’on observe ce qui se passe en la matière en France et dans les Etats limitrophes, les comparaisons s’avèrent particulièrement pertinentes du fait de modèles d’organisation territoriale très différents : l’Allemagne et la Belgique présentent un système fédéral, la France entend préserver son modèle unitaire alors même que l’Espagne et l’Italie ont opté pour un Etat dit « régionalisé » et que le Royaume-Uni s’est engagé sur la voie de la devolution.
ii. Un contrôle étatique réel
En dépit de choix institutionnels fort différents, on peut identifier néanmoins quelques éléments communs à l’ensemble de ces pays européens qui ont tous recours, selon des modalités certes diversifiées, au contrôle administratif des actes des collectivités décentralisées. Quelle que soit la forme de l’Etat, il existe donc toujours un contrôle administratif. Mais celui-ci relève parfois des Etats fédérés, parfois du gouvernement central, parfois encore de l’échelon régional. Ainsi, dans les Etats fédéraux européens, c’est l’entité fédérée qui exerce généralement le contrôle. En effet, en Allemagne par exemple, le droit local relève de la compétence des Länder. Dès lors, il est logique que le contrôle des actes des collectivités locales et le contrôle financier incombent, au niveau fédéré, au ministre de l’intérieur du Land et à ses éventuels représentants locaux. L’Autriche a opté pour un système similaire. Plus original sans doute, plus complexe aussi, le modèle fédéral belge confie la majeure partie du contrôle aux régions (Flandre, Wallonie et Bruxelles-capitale) mais préserve une compétence de contrôle à l’Etat fédéral dans certaines matières telles que l’état civil, les consultations citoyennes, la police ou encore la fonction publique locale. A l’inverse, dans les Etat unitaires, c’est le gouvernement central qui conserve toute compétence en matière de contrôle des collectivités décentralisées. Enfin, l’Union européenne compte en son sein d’autres formes d’organisation étatique, plus hybrides, généralement désignées sous le terme générique d’Etats régionalisés. L’Espagne et l’Italie en sont de parfaites illustrations et ont, par conséquent, largement transféré au niveau régional la compétence du contrôle administratif des collectivités décentralisées.
Qu’il s’agisse d’un simple contrôle de légalité (le plus fréquemment) ou d’un contrôle d’opportunité (de plus en plus rare mais néanmoins subsistant), le champ et l’intensité du contrôle varient d’un Etat européen à l’autre, trahissant ainsi la coexistence de diverses conceptions de la libre administration locale en Europe. Le contrôle a posteriori est néanmoins incontestablement en voie de généralisation et fait donc prévaloir, par essence, les éléments de légalité sur toute appréciation de l’opportunité. Pour autant, ce contrôle de légalité des actes des collectivités décentralisées n’est pas non plus exercé de manière similaire partout en Europe.
Diversité nationale et résistances étatiques se retrouvent également dans la manière d’organiser concrètement le contrôle de légalité des actes de leurs collectivités territoriales qui peut revêtir trois formes différentes. Certains Etats européens ont choisi de confier ce contrôle aux administrations des collectivités de rang supérieur. C’est par exemple le cas de l’Allemagne où chaque Land est certes libre de définir sa propre organisation de contrôle mais où l’on retrouve sensiblement le même schéma d’un Land à l’autre. D’autres Etats privilégient la voie juridictionnelle. Ainsi, en Italie par exemple, depuis le décret du 18 août 2000, tout doute sur la légalité d’un acte local doit être porté devant une juridiction dans les trente jours qui suivent sa publication. Enfin, il existe une voie moyenne, explorée par certains pays, qui associe une phase purement administrative à une phase juridictionnelle. C’est bien entendu le cas de la France mais c’est aussi le cas de l’Espagne.
Face à ces résistances étatiques, les collectivités décentralisées cherchent des voies de contournement que leur européanisation peut finalement faciliter.
B. Des stratégies de contournement
Contourner les Etats pour mieux défendre ses intérêts et tout simplement exister. Cette stratégie n’est sans doute pas des plus originales, mais elle a convaincu tout autant les institutions européennes que les collectivités décentralisées. Il est vrai que leurs intérêts se rejoignent incontestablement sur un point : ne plus faire des Etats centraux un point de passage obligé permet tout à la fois de valoriser le niveau local et de renforcer l’Union européenne. La manœuvre, si elle n’est jamais clairement revendiquée, se décline de deux manières : au niveau européen[25] par la promotion de la décentralisation et au niveau local par la constitution d’associations ou de réseaux afin de mieux défendre des intérêts communs.
i. Une promotion européenne de la décentralisation
La valorisation de l’administration locale est une réalité en droit communautaire. Mais il s’agit aussi d’un des objectifs récurrents du Conseil de l’Europequi est à l’origine de textes conventionnels importants en la matière. Parmi eux, on retiendra ici la Charte européenne de l’autonomie locale, même si la Charte urbaine européenne[26] et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires[27] contribuent aussi à une européanisation de la culture administrative et politique locale.
Adoptée par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, la Charte européenne de l’autonomie locale constitue le premier instrument conventionnel qui définit et promeut les grands principes politiques et administratifs que doit respecter tout système démocratique d’administration locale. Dans la mesure où il s’agit d’un traité international, elle a par voie de conséquence une valeur juridique supérieure qui s’impose aux Etats signataires, tenus d’en respecter l’esprit, sinon la lettre. La Charte a ainsi été ouverte à la signature de tous les Etats membres du Conseil de l’Europe le 15 octobre 1985 et a pu entrer en vigueur le 1er septembre 1988. A ce jour, tous les Etats membres de l’Union européenne ont signé et ratifié la Charte.
Contraignante, la Charte oblige les Etats à mettre en œuvre et à respecter un ensemble de règles fondamentales qui entendent préserver l’indépendance politique, administrative et financière des collectivités locales. Pour cela, elle définit un principe essentiel – l’autonomie locale – qui doit être reconnu dans le droit interne de chaque Etat signataire. Elle impose également le respect du principe de subsidiarité qui implique que les collectivités décentralisées puissent gérer, sous leur propre responsabilité, une partie importante des affaires publiques dans l’intérêt de leur population locale. Outre le préambule qui énonce les principes fondamentaux[28] sur lesquels repose la Charte, la première partie doit retenir l’attention puisqu’elle est consacrée à des dispositions de fond relatives aux principes de l’autonomie locale. Il est ainsi précisé la nécessité pour chaque Etat de reconnaître un fondement constitutionnel et légal à l’autonomie locale (article 2). Puis, le concept d’autonomie locale est défini (article 3), avant que ne soient établis les principes relatifs à la nature et à l’étendue des pouvoirs des autorités locales (article 4). Dans ce cadre, il est stipulé le principe d’attribution législative ou constitutionnelle des compétences des collectivités décentralisées. En outre, l’article 5 entend protéger les limites territoriales des collectivités locales alors que l’article 6 consacre un principe d’autonomie en ce qui concerne l’organisation de leurs structures administratives ainsi que la possibilité de recruter du personnel. L’article 7 définit quant à lui les conditions d’exercice d’un mandat électif local. Quant au contrôle administratif des actes des collectivités locales, il doit en principe être limité (article 8), et les collectivités décentralisées se voient reconnaître par l’article 9 le droit de disposer de ressources financières suffisantes afin de préserver leur autonomie. L’article 10 leur reconnaît le droit de coopérer entre elles et de constituer des associations. Enfin, l’article 11 organise la protection de l’autonomie locale par le droit à un recours juridictionnel.
La seconde partie présente diverses dispositions relatives à la portée des engagements souscrits par les Etats signataires de la Charte. Le Conseil de l’Europe étant toujours soucieux de ménager les particularités juridiques et institutionnelles de chaque Etat membre, la Charte de l’autonomie locale autorise en effet les Etats à exclure certaines de ses dispositions (article 12). Fort heureusement, cet article prévoit tout de même un certain nombre de principes fondamentaux contenus auxquels les Etats doivent obligatoirement adhérer, sans possibilité de s’y soustraire. Classiquement en droit européen, cette Charte constitue donc un véritable compromis entre, d’une part, la reconnaissance de principes fondamentaux tels que l’autonomie locale en elle-même et l’attachement de l’administration territoriale à des idéaux démocratiques et, d’autre part, le fait que la décentralisation demeure une ‘affaire interne’ à chaque Etat membre, dans le respect de sa souveraineté nationale et de sa liberté d’organisation administrative[29].
ii. Une démarche associative
Afin de mieux défendre des intérêts communs, les collectivités locales ont également développé des lieux d’échange et d’expression de leurs préoccupations. Ces lieux peuvent être institutionnalisés – à l’image du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux – ou reposer sur une structure de nature associative moins intégrée. Ils n’en promeuvent pas moins l’idée de la pertinence d’une administration territoriale en Europe.
Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux constitue ainsi l’institution conçue pour représenter les collectivités locales et régionales au sein du Conseil de l’Europe[30]. S’il a été créé en 1994 par une résolution du Comité des ministres, ce Congrès est néanmoins le résultat d’une longue évolution institutionnelle trahissant une reconnaissance progressive de deux niveaux d’administration infra-étatique, d’abord local et ensuite régional, mais aussi une volonté d’assimiler cette assemblée à une véritable enceinte parlementaire, de par son organisation et son fonctionnement. Les deux chambres du Congrès réunissent des représentants disposant d’un mandat électif au sein d’une collectivité locale ou régionale, représentant au total plus de 200 000 collectivités locales et régionales, avec un mandat d’une durée équivalente à deux sessions ordinaires (soit deux années). Pour faciliter le bon fonctionnement de l’assemblée et mieux affirmer encore le caractère parlementaire de cet organe, les membres du Congrès se regroupent à la fois par délégation nationale et par groupe politique. Enfin, le Congrès désigne en son sein son président, dont le mandat est d’une durée similaire à celle des représentants, soit deux ans.
Le Congrès a pour missions principales de veiller à garantir la participation des collectivités locales et régionales au processus d’unification européenne et aux travaux du Conseil de l’Europe, de promouvoir la coopération entre collectivités décentralisées (par exemple sous la forme d’eurorégions) et d’œuvrer au développement de la démocratie locale et régionale. Plus précisément, il revient au Congrès d’accompagner les Etats membres du Conseil de l’Europe, et notamment les nouvelles démocraties, dans leurs processus de décentralisation. Il a également pour tâche d’examiner la situation de la démocratie locale et régionale dans les pays candidats à l’adhésion. De plus, de par son caractère parlementaire, le Congrès entend représenter et défendre les intérêts des conseils locaux et régionaux dans l’élaboration de la politique européenne. Enfin, le Congrès est parfois amené à observer le bon déroulement d’élections locales ou régionales dans des pays qui en font demande. Pour toutes ces activités, le Congrès s’appuie sur la collaboration de différents partenaires comme des associations nationales ou internationales de collectivités locales, des organisations non-gouvernementales, des mouvements citoyens, etc.
On pourrait également citer le Conseil des communes et régions d’Europe (Ccre). Créé en 1951, il s’agit d’une association à but non lucratif qui entend assurer la promotion d’une Europe fondée sur l’autonomie locale et régionale et la démocratie. Regroupement beaucoup moins formel que le précédent, il s’attache à influencer la réglementation et les politiques communautaires et à développer les échanges d’informations aux niveaux local et régional. Pour affirmer plus clairement son rôle au niveau mondial, le Conseil a tissé des coopérations avec des partenaires de tous les continents, notamment dans le cadre de la structure dénommée Cités et gouvernements locaux unis. Avec près de 100 000 membres, le Ccre constitue incontestablement la plus grande association d’autorités locales et régionales en Europe[31].
De même, l’Assemblée des Régions d’Europe (Are) regroupe plus de 270 régions issues de 33 pays et 16 organisations interrégionales. Organe de représentation politique et forum de coopération interrégionale, elle a été fondée sous la forme initiale d’un Conseil des régions d’Europe en 1985 avant de devenir officiellement l’Assemblée actuelle à partir de 1987 : la nouvelle dénomination insiste davantage sur son caractère représentatif et politique.
Conclusion
Si le droit européen
relatif à l’administration territoriale comme les institutions européennes
dévouées à la cause des collectivités territoriales constituent bien une
réalité incontestable, cette forme d’européanisation – bottom down – des collectivités décentralisées ne doit cependant
pas occulter une autre forme – bottom up
– à laquelle les Etats éprouvent davantage de difficultés à s’opposer. Il s’agit
donc bien d’une double européanisation, de moins en moins subie et de plus en
plus choisie, qui cherche à contourner les réticences persistantes des Etats. Ceux-ci
protègent néanmoins en toute légitimité leurs modèles respectifs d’administration
locale, fruits d’une histoire et d’une géographie nationales que l’européanisation
ne saurait remettre en cause.
[1] Nicolas.kada@upmf-grenoble.fr.
[2] Solis-Potvin L., « Intégration européenne et autonomie locale » in KadaN. (dir), Les Tabous de la décentralisation, Paris, Berger-Levrault, 2015, p. 119.
[3] Résolution sur la politique régionale communautaire et le rôle des régions, 18 novembre 1998, Joce, n° C326, p. 289.
[4] Marcou G., La régionalisation en Europe, Rapport au Parlement européen (réf. PE 168.498), Paris, Grale, 1999.
[5] En effet, aux débuts de la construction européenne, les différences de conceptions nationales en ce qui concerne le niveau régional sont flagrantes. Par exemple, en France, les régions étaient alors conçues uniquement dans une configuration de circonscriptions d’action régionale ; en Italie, seules les régions à statut spécial fonctionnaient ; les Länder allemands étaient dès l’origine bien plus que de simples régions, etc.
[6] Sous le contrôle de la Commission : Cf. art. 93 du traité CE.
[7] Après un an et demi de travaux au sein de la Convention sur l’avenir de l’Europe, où siégeaient 105 conventionnels, incluant des observateurs (dont 6 membres du Comité des régions), de décembre 2001 à juin 2003, puis une Conférence Inter Gouvernementale (Cig) qui s’est réunie à partir d’octobre 2003 jusqu’à début 2004, le traité établissant une Constitution pour l’Europe voyait enfin le jour. Il s’agissait d’un résultat qui se voulait simplificateur et plus démocratique, mais rejeté depuis par référendum en France et aux Pays-Bas. La ratification a dès lors été suspendue dans les autres Etats de l’Union, avant qu’un projet de relance sous forme de traité simplifié ne réapparaisse en juin 2007…
[8] Article I.5 du traité de Rome du 29 octobre 2004.
[9] Article J.11 du traité de Rome du 29 octobre 2004.
[10] Drevet J.-F., Histoire de la politique régionale de l’Union européenne, Paris, Belin, 2008.
[11] Comité des Régions, La cohésion territoriale en Europe, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 2003.
[12] Il faut souligner en complément que les régions les plus prospères – Londres, Hambourg et Bruxelles – sont toutes des zones urbaines.
[13] Ces programmes (Ispas, Sapard, Phare…) correspondaient à un montant total d’environ 22 milliards d’euros et des fonds supplémentaires sont disponibles pour l’après-adhésion.
[14] Pour davantage de précisions, cf : Feral P.-A., Le Comité des régions, Paris, Puf, coll. Que-sais-je, 1998.
[15] Art.263 Traité CE.
[16] Féral P.-A., Le Comité des régions de l’Union européenne, du traité de Maastricht au traité d’Amsterdam, Paris, Anrt ; Thèse à la carte, 2004.
[17] Pour davantage d’exemples et une excellente présentation du contexte général : Lecherbonnier B., Les lobbies à l’assaut de l’Europe, Paris, Albin Michel, 2006.
[18] Vayssière B., Groupes de pression en Europe : Europe des citoyens ou des intérêts ? Toulouse, éd. Privat, 2002.
[19] Nonon J., Clame M., L’Europe et ses couloirs : lobbying et lobbyistes, Paris, Dunod, 1991.
[20] Oberdorff H., L’Union européenne, Grenoble, Pug, coll. Europa, 2007, p.113.
[21] Cf. notamment : Cjce, 21 septembre 1988, Commission c/ Grèce (aff. 68/88) et Cjce, 10 avril 1984, Von Colson et Kaman (aff. 14/83).
[22] Cjce, 15 décembre 1971, International Fruit Compagny (aff. 51 à 54/71).
[23] Cjce, 25 mai 1982, Commission c/ Pays-Bas (aff.97/81).
[24] Allemand R., Les modalités de contrôle administratif des actes locaux dans les pays de l’Union européenne (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne et Italie) in Combeau P. (dir.), Les contrôles de l’Etat sur les collectivités territoriales aujourd’hui, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 246.
[25] Dans une acception plus large que le seul cadre européen puisqu’il s’agit plutôt ici du Conseil de l’Europe.
[26] Conseil de l’Europe, La charte urbaine européenne (Actes du colloque de Sofia du 16-17 mai 2002), Strasbourg, éd. du Conseil de l’Europe, 2006, 127 p.
[27] Adoptée le 5 novembre 1992 sous les auspices du Conseil de l’Europe afin de défendre et promouvoir les langues historiques régionales et les langues des minorités en Europe, cette convention, dont le but affiché est principalement d’ordre culturel, ne peut guère dissimuler des préoccupations politiques sous-jacentes en matière de démocratie et d’identité locales.
[28] Ces principes sont très généraux, et par conséquent de portée juridique réduite. Il s’agit, par exemple, d’affirmer la contribution vitale de l’autonomie locale à la démocratie, à l’efficacité de l’administration et à la décentralisation du pouvoir. Le préambule de la Charte insiste également sur le rôle important des collectivités locales dans la construction européenne.
[29] Pour un bilan (provisoire), cf. : Conseil de l’Europe, La charte européenne de l’autonomie locale. Vingtième anniversaire (Actes du colloque de Lisbonne du 8 juillet 2005), Strasbourg, éd. du Conseil de l’Europe, 2006.
[30] Pour un bilan (provisoire) de son activité, cf : Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, Cinquante ans de démocratie locale en Europe (table ronde organisée à l’ouverture de la quatorzième session plénière du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe), Strasbourg, Vd. du Conseil de l’Europe, 2007.
[31] Il est présidé depuis décembre 2004 par Michaël Häupl, gouverneur-maire de Vienne (Autriche).
Nota Bene : le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso. Vous pouvez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).