Voici la 23e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait des 8e & 9e livres de nos Editions dans la collection « Académique » :
les Mélanges en l’honneur
du professeur Jean-Louis Mestre.
Mélanges qui lui ont été remis
le 02 mars 2020
à Aix-en-Provence.

Vous trouverez ci-dessous une présentation desdits Mélanges.
Ces Mélanges forment les huitième & neuvième
numéros issus de la collection « Académique ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :
Volumes VIII & IX :
Des racines du Droit
& des contentieux.
Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Louis Mestre
Ouvrage collectif
– Nombre de pages : 442 & 516
– Sortie : mars 2020
– Prix : 129 € les deux volumes.
ISBN / EAN unique : 979-10-92684-28-5 / 9791092684285
ISSN : 2262-8630
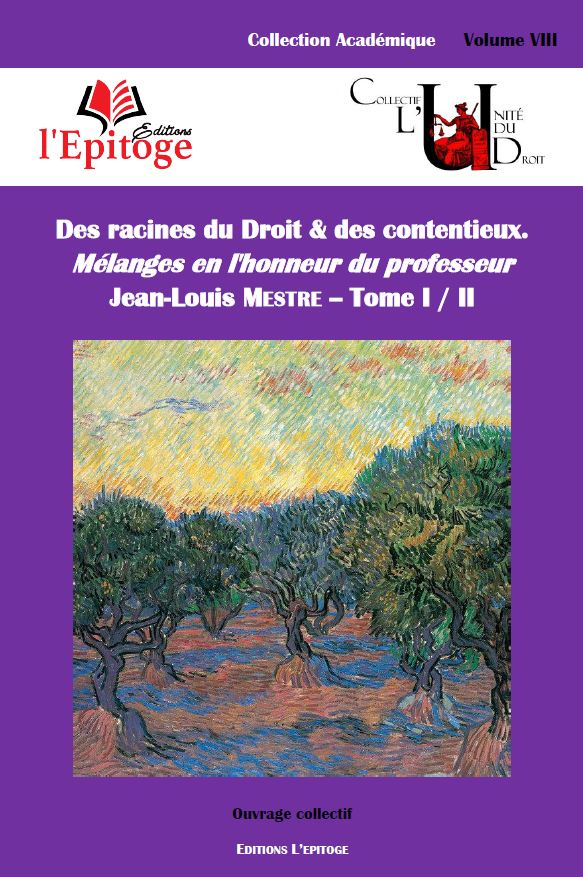

Mots-Clefs :
Mélanges – Jean-Louis Mestre – Histoire du Droit – Histoire du contentieux – Histoire du droit administratif – Histoire du droit constitutionnel et des idées politiques – Histoire de l’enseignement du Droit et des doctrines
Présentation :
Cet ouvrage rend hommage, sous la forme universitaire des Mélanges, au Professeur Jean-Louis Mestre. Interrogeant les « racines » du Droit et des contentieux, il réunit (en quatre parties et deux volumes) les contributions (pour le Tome I) de :
Pr. Paolo Alvazzi del Fratte, Pr. Grégoire Bigot, M. Guillaume Boudou,
M. Julien Broch, Pr. Louis de Carbonnières, Pr. Francis Delpérée,
Pr. Michel Ganzin, Pr. Richard Ghevontian, Pr. Eric Gojosso,
Pr. Nader Hakim, Pr. Jean-Louis Halpérin, Pr. Jacky Hummel,
Pr. Olivier Jouanjan, Pr. Jacques Krynen, Pr. Alain Laquièze,
Pr. Catherine Lecomte, M. Alexis Le Quinio, M. Hervé Le Roy,
Pr. Martial Mathieu, Pr. Didier Maus, Pr. Ferdinand Melin-Soucramanien, Pr. Philippe Nélidoff, Pr. Marc Ortolani, Pr. Bernard Pacteau,
Pr. Xavier Philippe, Pr. François Quastana, Pr. Laurent Reverso,
Pr. Hugues Richard, Pr. André Roux, Pr. Thierry Santolini, M. Rémy Scialom, M. Ahmed Slimani, M. Olivier Tholozan,
Pr. Mathieu Touzeil-Divina & Pr. Michel Verpeaux,
… et pour le Tome II :
M. Stéphane Baudens, M. Fabrice Bin, Juge Jean-Claude Bonichot,
Pr. Marc Bouvet, Pr. Marie-Bernadette Bruguière, Pr. Christian Bruschi,
Prs. André & Danielle Cabanis, Pr. Chistian Chêne, Pr. Jean-Jacques Clère, Mme Anne-Sophie Condette-Marcant, Pr. Delphine Costa,
Mme Christiane Derobert-Ratel, Pr. Bernard Durand, M. Sébastien Evrard, Pr. Eric Gasparini, Père Jean-Louis Gazzaniga, Pr. Simon Gilbert,
Pr. Cédric Glineur, Pr. Xavier Godin, Pr. Pascale Gonod,
Pr. Gilles-J. Guglielmi, Pr. Jean-Louis Harouel, Pdt Daniel Labetoulle,
Pr. Olivier Le Bot, Pr. Antoine Leca, Pr. Fabrice Melleray,
Mme Christine Peny, Pr. Laurent Pfister, Pr. Benoît Plessix,
Pr. Jean-Marie Pontier, Pr. Thierry S. Renoux, Pr. Jean-Claude Ricci,
Pr. Albert Rigaudière, Pr. Ettore Rotelli, Mme Solange Ségala,
Pdt Bernard Stirn, Pr. Michael Stolleis, Pr. Arnaud Vergne,
Pr. Olivier Vernier & Pr. Katia Weidenfeld.
Mélanges placés sous le parrainage du Comité d’honneur des :
Pdt Hélène Aldebert, Pr. Marie-Bernadette Bruguière, Pr. Sabino Cassese, Pr. Francis Delpérée, Pr. Pierre Delvolvé, Pr. Bernard Durand,
Pr. Paolo Grossi, Pr. Anne Lefebvre-Teillard, Pr. Luca Mannori,
Pdt Jean Massot, Pr. Jacques Mestre, Pr. Marcel Morabito,
Recteur Maurice Quenet, Pr. Albert Rigaudière, Pr. Ettore Rotelli,
Pr. André Roux, Pr. Michael Stolleis & Pr. Michel Troper.
Mélanges réunis par le Comité d’organisation constitué de :
Pr. Jean-Philippe Agresti, Pr. Florent Blanco, M. Alexis Le Quinio,
Pr. François Quastana, Pr. Laurent Reverso, Mme Solange Ségala,
Pr. Mathieu Touzeil-Divina & Pr. Katia Weidenfeld.
Ouvrage publié par et avec le soutien du Collectif L’Unité du Droit
avec l’aide des Facultés de Droit
des Universités de Toulouse et d’Aix-Marseille
ainsi que l’appui généreux du
Centre d’Etudes et de Recherches d’Histoire
des Idées et des Institutions Politiques (Cerhiip)
& de l’Institut Louis Favoreu ; Groupe d’études et de recherches sur la justice constitutionnelle (Gerjc) de l’Université d’Aix-Marseille.
Etat
& anthropomorphisme
Grégoire Bigot
Université de Nantes
« En vérité, elle est étrange, cette prétention
des juristes de se créer un Etat à eux[1] ».
La recherche en droit, à l’instar de la philosophie, doit cultiver le doute, afin de se départir, comme l’écrivait Descartes, de ces « fausses opinions » que nous tenions pour « véritables ». Or ce que l’on appelle l’Etat fait partie « [d]es choses que l’on peut révoquer en doute[2] » tant les principes sur lesquels on l’a fondé en droit sont incertains.
En un mot deux interrogations : comment le droit public a-t-il prétendu s’ériger en science juridique à partir d’un mot, l’Etat, dont on ne savait pas ce qu’il recouvrait ? Ce qui appelle immédiatement la seconde interrogation : pourquoi cette chose que l’on appelle l’Etat est-elle irréductible au droit conçu comme science pure, prétendument délivrée de tous les autres pans de notre culture ?
I. L’anthropomorphisme évacué
La théorie de la personnalité morale de l’Etat est en soi schizophrénique puisque l’Etat y figure comme une personne juridique sans corps physique. C’est d’ailleurs, nous disent les juristes, tout l’intérêt de cette fiction – à moins qu’il ne s’agisse d’une abstraction : le propre de l’Etat est d’être désincarné. Comme nous le racontent avec amusement nos professeurs aux commencements de nos études de droit : « Je n’ai jamais mangé avec une personne morale ». Et pourtant on lui reconnaît – en droit – les attributs qu’on attache d’ordinaire à la personne physique. Avant même de voir en quoi le débat relatif à la personnalité morale, après 1900[3], fait triompher la fiction de l’Etat (contre la théorie de la réalité de la personne morale), un détour s’impose pour tâcher de dater l’apparition de l’Etat comme catégorie juridique dans le droit public puisqu’il faut, avant même qu’on lui attribue une personnalité, supposer qu’il existe.
A. L’Etat sans existence ? Un siècle d’« oubli » de l’Etat
C’est un fait connu que, à la suite d’Adhémar Esmein, Carre de Malberg, dans sa Contribution à la théorie générale de l’Etat, postule que « l’Etat est la personnification de la nation[4] ». Par cette expression nos deux auteurs croient résoudre la question pourtant insoluble de la constitutionnalité de l’Etat. En outre, ils offrent à cet Etat une origine révolutionnaire dont il est à tout le moins incertain que les révolutionnaires l’aient approuvée.
Il est en effet à tout le moins incertain, du moins pour l’historien du droit d’aujourd’hui, que l’Etat soit, en 1789, la personnification de la nation. D’abord parce que si le mot Etat existe depuis des siècles et a notamment connu un regain d’intérêt avec l’avènement de la raison d’Etat au XVIe siècle, la juridicité de l’Etat est quasi nulle à l’orée de la Révolution. C’est qu’ensuite le débat est ailleurs : il porte sur la légitimité, et donc l’assise, de la souveraineté. C’est un fait suffisamment connu que le propre de la Révolution française est d’avoir opéré le transfert de la titulature de la souveraineté depuis le Roi jusqu’à la Nation. Le 17 juin 1789, le Tiers-Etat se proclame assemblée nationale parce qu’il dit, suivant les idées de l’abbé Sieyès, représenter quatre-vingt-seize centièmes de cette nation ; la logique du chiffre et de la raison, qui fonde le principe représentatif, offre à la souveraineté sa nouvelle assise. L’autorité de l’histoire et de la religion, sur laquelle le Roi fondait la légitimité de sa souveraineté – le sacre de 1774 en témoignait – est rejetée dans une forme à jamais révolue du passé. La souveraineté traverse donc intacte le 17 juin comme l’atteste le fait que la loi – prérogative dont s’emparent immédiatement les députés – reste la première marque d’une souveraineté qui demeure absolue. En revanche, c’est son assise qui est précisément révolutionnée. Or il est essentiel pour notre sujet d’insister sur ce point que la ligne de fracture qui se dessine le 17 juin tient au fait que la souveraineté incarnée de l’Ancien Régime cède à la souveraineté désincarnée du nouveau régime représentatif fondé sur l’élection. La nation souveraine est ainsi une pure fiction parce qu’elle est précisément aux antipodes de la souveraineté royale, visible, incarnée. Sans doute la rupture n’est-elle pas aussi radicale que nous venons de le dire dans la mesure où, depuis la captation de la souveraineté par le roi, les juristes ont su forger une souveraineté perpétuelle abstraite, qui transcendait le corps mortel du roi. C’est la théorie bien connue du double corps du roi au terme de laquelle le corps mystique du roi – siège immortel de la souveraineté – survit toujours au corps mortel du roi. Il n’empêche que même mystique, le siège de la souveraineté a le corps pour principe et pour postulat ; même abstraite, la souveraineté conserve avec l’anthropomorphisme un lien consubstantiel. Il tient bien entendu aux origines religieuses de la monarchie et au fait que la chrétienté ne peut se figurer sa foi autrement que par l’incarnation. Les deux abstractions – nation et corps mystique du roi – ont ceci d’irréconciliables que la nation n’est pas à l’image d’un corps d’homme. Elle est totalement désincarnée. Elle est, pour reprendre la fameuse expression du philosophe Claude Lefort, « le lieu vide du pouvoir ». La concrétisation de la nation en « un tout unique » passe par la départementalisation dont l’objet est à ce titre constitutionnel au sens premier du terme : ce sont des territoires qui constituent la nation de façon ascendante ; nous sommes aux antipodes d’une nation conçue à l’image de l’humain ; c’est d’ailleurs la République, et non la nation, qui empruntera à un anthropomorphisme animal (le lion) ou féminin (sur le modèle d’une déesse grecque) sa mise en images.
Une telle nation souveraine peut-elle être ce que les juristes de la troisième République appelleront l’Etat ? Le doute s’accroit si, à l’instar de ce qu’avait prétendu faire Carre de Malberg, on prend le droit constitutionnel de la Révolution au sérieux. Le premier et simple constat qui s’impose est que l’Etat est un inconnu du constitutionnalisme révolutionnaire. Si l’Etat était tout ce qui fonde le droit public, si l’Etat était vraiment la personnification de la nation, on peut supposer que les révolutionnaires, à tout le moins, auraient employé ce mot. Or aucune des trois constitutions votées avant 1799 n’en font ne serait-ce que mention. Pour cette raison essentielle que la nation, et elle seule, est devenue le siège inexpugnable de la souveraineté. L’article 3 de la Déclaration est sur ce point on ne peut plus clair et ferme : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ». La nation n’a donc pas besoin de personnification ; elle est à elle-même suffisante lorsqu’elle délègue ses pouvoirs à ceux qui en émanent.
Le mot Etat est constitutionnellement consacré pour la première fois par le texte de frimaire an VIII qui institue le Consulat. Plus précisément le mot Etat fait son entrée sur la scène du constitutionnalisme écrit par la création du Conseil d’Etat auquel le texte de l’an VIII consacre tout un chapitre. Or cet Etat nommé en 1799 est lourd de signification pour trois raisons qui se combinent. D’abord il consacre le retour à une institution d’Ancien Régime. Il est ensuite présidé par les consuls là où, sous l’ancienne monarchie, il était réputé présidé par le roi. Enfin ce Conseil d’Etat présente la bizarrerie, à rebours de la tradition constitutionnelle de la Révolution, de confondre les pouvoirs en son sein par l’exercice de ses fonctions. Il possède logiquement des attributions dans le domaine exécutif puisqu’il prépare des règlements d’administration publique pour le gouvernement (le mot remplace celui d’exécutif en l’an VIII) et ses sections administratives chapeautent l’administration générale dont les départements sont la première interface. Mais le Conseil d’Etat a également des attributions législatives : il prépare les projets de loi dont le gouvernement a seul l’initiative. Il jouit enfin d’attributions juridictionnelles puisqu’il est chargé dès sa création de résoudre le contentieux administratif en lieu et place de la bureaucratie ministérielle du Directoire. Le fait qu’un corps nommé (qui plus est par le seul premier Consul) détienne une prérogative législative qui jusqu’ici ne pouvait relever que des élus de la nation en dit long sur le fait que le Consulat, par le bais même de son Conseil d’Etat, renie les idéaux révolutionnaires. Il le fait suivant l’objectif assumé de « finir », précisément, la Révolution comme en témoigne la proclamation des consuls de frimaire an VIII. Or, clore la décennie révolutionnaire, c’était mettre un terme à la représentation nationale abstraite qui, posée pour principe en 1789, a échoué à donner satisfaction, tout particulièrement sous le Directoire. Comme l’a très bien analysé Marcel Gauchet dans La Révolution des pouvoirs, la solution consistait à renier la souveraineté abstraite pour la réincarner en un homme, par le retour à une tradition issue de l’Ancien Régime[5]. Chacun sait que les trois constitutions du régime napoléonien avant 1814 consacrent au mieux un « césarisme » ; elles sont monocratiques dans la mesure où elles confient l’essentiel des prérogatives de la souveraineté à un seul et même homme : premier Consul en l’an VIII, Consul à vie en l’an X, Empereur – et donc roi – en l’an XII. Ainsi que l’atteste le fait qu’il préside autant qu’il le peut son Conseil d’Etat, depuis lequel il gouverne, le nouveau César ou l’Empereur ressuscité est le premier chef de l’Etat de l’histoire politique contemporaine. L’Etat, à ce stade, est pétri d’anthropomorphisme : il a à sa tête – sens étymologique de « chef » – un homme en qui se donne à voir le souverain. Ce lien intime entre Etat et anthropomorphisme au sortir de la Révolution tient au fait que l’exécutif domine – voire écrase – de ses prérogatives le législatif (le Tribunat est supprimé en 1807 et le Corps Législatif est un « corps de muets »). L’apparition du mot Etat coïncide avec un renforcement de l’Exécutif au détriment des élus de la nation. L’Etat napoléonien est alors possiblement antinomique de la nation souveraine même si la Constitution de l’an VIII, fort habilement, donne l’illusion de consacrer une démocratie par la reconnaissance d’un suffrage universel à la vérité neutralisé dans ses effets (il ne sert qu’à constituer des listes de confiance). La consécration du mot « gouvernement » en lieu et place de l’ancien « pouvoir » exécutif n’est pas sans lien, elle non plus, avec une représentation du souverain incarné en un homme : le capitaine du vaisseau, en homme providentiel, tient le gouvernail pour braver les éléments et conduire à bon port son vaisseau. Les révolutionnaires avaient longuement débattu de la nécessité d’un gouvernement qui fut fort et les travaux parlementaires font état de longues discussions à ce sujet dès la Constituante[6]. Une évolution notable se produit à l’occasion des débats relatifs à l’adoption de la Constitution de l’an III puisque, dans un souci de bien hiérarchiser les fonctions de gouvernement et d’administration au sein d’un exécutif renforcé, les constituants usent de la métaphore corporelle : le Directoire exécutif serait la tête là où l’administration serait le bras. C’est cette métaphore que constitutionnalise le régime du Consulat au profit du premier Consul en consacrant textuellement le vocable « gouvernement ».
Bien qu’elle renoue en grande partie avec le régime représentatif par le truchement d’une chambre des députés élue qui discute et vote les lois, la Charte de juin 1814 pourrait se prêter au même type d’analyse pour l’emploi symptomatique qu’elle fait du mot Etat. Celui-ci est en effet employé au sujet des très particulières « ordonnances pour la sûreté de l’Etat ». Alors que le pouvoir réglementaire classique, d’exécution des lois, oblige le Roi à une collaboration des pouvoirs, dans le cadre du pouvoir réglementaire autonome des ordonnances pour la sûreté de l’Etat, il exerce une souveraineté déliée puisqu’aussi bien elles lui attribuent l’équivalent d’un pouvoir législatif sans partage. Certes la souveraineté est-elle monarchique au terme de la Charte, mais le gouvernement, comme l’avait promis Louis XVIII en mai 1814, est en principe représentatif : il doit composer avec les élus de départements qui, depuis 1789, constituent la nation abstraite. Avec les pouvoirs exceptionnels que lui confèrent les ordonnances pour la sûreté de l’Etat, le monarque s’écarte du principe représentatif, et donc de la nation : rien d’étonnant à ce titre qu’il figure comme garant non de la nation mais de l’Etat, mot qui depuis 1799 caractérise la confusion des pouvoirs au profit de l’exécutif.
Pour autant que le mot Etat ait fait son intrusion dans le constitutionnalisme écrit, il reste d’usage exceptionnel au profit des catégories et représentations anciennes : à savoir, tant la tradition du constitutionnalisme révolutionnaire est prégnante, les pouvoirs législatif et exécutif. L’Etat ne fonde en rien le droit public du XIXe siècle comme en témoigne la littérature publiciste de ce siècle. Ainsi que l’a souligné Luc Heuschling, il n’existe quasiment aucun ouvrage théorique qui soit consacré à l’Etat avant les années 1900 sous la plume d’un juriste[7]. Le monopole de l’enseignement du droit public appartient aux professeurs de droit administratif, matière qui se généralise dans les Facultés à compter de la monarchie de Juillet. Mais l’Etat ne requiert à aucun moment leur attention en tant qu’il servirait de soubassement à l’élaboration de leur science.
B. L’Etat sans corps ?
Le débat relatif à la personnalité morale de l’Etat
L’Etat ne s’invite sérieusement dans le débat politique en France qu’à compter du second Empire. Du fait que ce second césarisme, qui entend renouer en ses origines avec les principes de l’an VIII, consacre un retour à la centralisation administrative, il réarme le discours décentralisateur. Celui-ci s’était une première fois manifesté sous la Restauration dans la mesure où il exigeait que l’administration napoléonienne, autoritaire puisque nommée, fût réformée sur le modèle libéral de la Charte. En un mot les décentralisateurs exigeaient le retour à l’élection de l’organe délibératif au sein des départements et des communes et la reconnaissance, pour ces administrations, du pouvoir de délibérer librement sur les affaires d’intérêt local. Après que la législation décentralisatrice de la monarchie de Juillet leur procure en partie raison, le second Empire renoue avec la logique centralisatrice, notamment par ses décrets de 1852 et 1861 qui renforcent les pouvoirs de décision de l’administration préfectorale. La contestation décentralisatrice sous le second Empire se distingue néanmoins clairement du discours décentralisateur sous les monarchies censitaires dans la mesure où précisément elle sait dépasser le simple dilemme entre libéralisme du régime représentatif et illibéralisme de l’administration napoléonienne. Ce dont veulent faire prendre conscience les libéraux sous le second Empire, c’est que l’administration de type napoléonienne étoufferait jusqu’aux libertés individuelles et collectives. Il y aurait eu, du fait de l’accroissement continu des domaines d’intervention de l’administration, une mise sous tutelle de ces libertés. Ou pour le dire autrement, suivant une expression qui sera celle de Carre de Malberg, la société française serait devenue une société étatisée. C’est en effet par métonymie, alors qu’ils fustigent le poids de l’administration centrale et, à travers elle, le pouvoir trop important de l’exécutif, que les détracteurs de la centralisation emploient par commodité le mot Etat. Il est donc en grande partie une invention de ses détracteurs comme en témoigne par exemple l’œuvre d’Edouard Laboulaye[8]. L’Etat devient un sujet essentiel de controverse chez les publicistes comme en témoignent les titres même des essais publiés pro ou contra la centralisation entendue comme d’un Etat qui doit ou non instituer le social et administrer les libertés. Là où Charles Dupont-White défend la société étatisée en 1856 dans son ouvrage L’individu et l’Etat, Edouard Laboulaye plaide pour la réduction de la sphère de l’Etat en 1865 dans son essai L’Etat et ses limites.
Mais bien que Laboulaye fût juriste, il ne serait pas venu à l’idée de ces publicistes de fournir de l’Etat une définition purement abstraite parce qu’elle serait exclusivement juridique. Ce souci d’abstraire l’Etat pour l’arrimer dans le champ exclusif de la science juridique est essentiellement l’œuvre des universitaires Allemands. Cette histoire de la qualification juridique de l’Etat outre Rhin est bien connue grâce aux remarquables travaux de Michael Stolleis. Après l’échec du Wormärz, les libéraux cherchent, par des moyens juridiques, à assigner des limites à un modèle politique impérial et autoritaire. Contrairement aux publicistes français du second Empire englués dans les réalités de la centralisation administrative qualifiée d’Etat, les universitaires allemands ont tendance à révéler l’Etat par une approche exclusivement juridique, désengagée en quelque sorte des contingences politiques et/ou institutionnelles. L’Etat est à la fois titulaire de droit mais rencontre des limites qui seraient celles du droit. Le droit public Allemand se structure ainsi tout entier autour d’une science juridique de l’Etat qui, par là même, accède comme abstraction à la vie[9].
Après Sedan, dans le contexte de la crise Allemande de la pensée française, dans le contexte de la montée en puissance de ce que l’on qualifiera par la suite les Etats-nations, les universitaires français s’approprient la science juridique allemande et, entre les années 1890 et 1920, la question de la définition juridique de l’Etat restructure l’ensemble du droit public sur notre territoire, aussi bien le droit constitutionnel naissant que le droit administratif qui trouve dans la définition juridique de l’Etat la possibilité de relégitimer et de refonder sa science. Après que la Revue du droit public a été lancée en 1894 avec pour objectif essentiel de structurer tout ce droit autour de la question de l’Etat, ce dernier fait l’objet d’un premier traité en deux tomes sous la plume acerbe de Léon Duguit[10]. Paradoxalement, alors qu’il entend réfuter complètement les théories allemandes qui attribuent à l’Etat une personnalité juridique, il contribue à acclimater les juristes français à cette fiction.
Si Duguit mène une croisade contre la fiction de l’Etat, c’est qu’il ne supporte pas qu’on puisse lui attribuer la titulature de la souveraineté comme un droit en lieu et place de la nation, qui l’exerçait comme un pouvoir. D’ailleurs Duguit a le mérite de la cohérence : il nie que la nation abstraite ait pu réussir à exercer sa souveraineté[11]. En connaisseur de l’histoire du droit, il s’oppose à la fiction première pour laquelle on cherche à trouver un titulaire, à savoir qu’il lutte contre l’idée de souveraineté elle-même. Issue selon ses propres mots de la théocratie médiévale, elle doit être répudiée comme une sorte de monstruosité métaphysique[12]. Le progrès des sciences juridiques – on sait ce que le positivisme de Duguit doit à Auguste Comte – consiste en ceci qu’il ne peut envisager que la réalité des titulaires de droits. L’Etat et la souveraineté sont des idées inadaptées à une analyse juridique du pouvoir, qui doit être centrée sur les seuls rapports gouvernants/gouvernés.
En réponse, les théoriciens de la personnalité morale de l’Etat ne peuvent faire l’économie d’un débat qui consiste à trancher le point de savoir si l’Etat est une pure immatérialité ou s’il prend appui sur le réel d’organes, pour reprendre un mot qu’affectionne Carre de Malberg. Sur ce point, les écrits de ce dernier ainsi que ceux de Léon Michoud, avant lui, sont pétris d’ambiguïtés. Eric Maulin a parfaitement rendu compte des contorsions intellectuelles de Carre de Malberg : l’Etat n’est pas un organisme vivant mais il se fonde sur une réalité qui serait au moins issue de l’histoire, si ce n’est de la nature[13]. Pour le professeur strasbourgeois, « il y aurait dans l’Etat une double personnalité : une personnalité réelle, antérieure à sa personnalité juridique, et formant le substratum de cette dernière qui viendrait s’ajouter à la première[14] ». Mais l’Etat, in fine, doit être totalement désincarné parce que c’est la condition scientifique pour bâtir ce à quoi aspire Carre de Malberg : une théorie pure, à entendre comme purement juridique. A la suite de Jellinek et de Michoud dont il s’inspire, il peut ainsi écrire que « […] l’Etat ne doit pas être envisagé comme une personne réelle, mais seulement comme une personne juridique, ou plutôt l’Etat, n’apparaît comme une personne qu’à partir du moment où on le contemple sous son aspect juridique[15] ». A ce titre, Carre de Malberg écarte d’un revers de main (en note de bas de page) toute possibilité d’anthropomorphisme, considérant qu’il s’agirait d’une théorie « discréditée » : « Il est superflu d’ajouter que cette notion purement juridique n’a rien de commun avec la théorie naturaliste qui prétend que l’Etat est un organisme vivant tout comme l’homme ou l’animal, et qui fonde sur cette prétendue constatation la réalité de son être et de sa personnalité[16] ».
Du côté de Léon Michoud, qui dès 1906 livre sa somme consacrée à la Théorie de la personnalité morale, les mêmes ambiguïtés produisent les mêmes effets. Les ambiguïtés résultent du fait que, comme l’a souligné Nader Hakim récemment, Michoud ne peut se départir complètement de l’argument d’autorité qu’il tire d’une forme de jusnaturalisme[17] : l’Etat serait né d’un fait (essentiellement historique) que le droit constaterait (on reconnaîtra ici la charge classique des publicistes de la troisième République contre l’anhistoricité de la théorie du contrat social[18]). L’effet à tout le moins paradoxal est que le droit à un moment se défait ou se départi du réel : l’Etat connaît son hypostase dans la fiction de sa personnalité seulement morale.
II. L’anthropomorphisme inévacuable
Le lecteur inattentif nous objectera que nous n’avons rien entendu de la théorie pure (i.e. juridiquement pure) de la personnalité morale de l’Etat : elle consiste seulement à imputer à une unité abstraite, qui a le mérite de la continuité, des actes juridiques, pour la force et la sécurité de ces derniers. Qu’importe si d’un œuf juridique – l’acte – on déduit la poule, à savoir la nature de l’auteur de l’acte, dont pourtant l’acte ne nous dit rien. Il n’y aurait pas là de quoi fouetter un juriste.
Comme l’a minutieusement étudié François Brunet dans une thèse récente[19], et dont il n’a pas été suffisamment rendu compte, toute la limite à la théorie du droit consiste en ceci qu’elle prétend évacuer les considérations qui porteraient sur les valeurs, et donc les croyances, dont le droit pourrait rendre compte.
C’est ainsi qu’il n’est pas dit une fois pour toute, c’est ainsi qu’il n’est pas absolument certain que le droit ne soit qu’une opération de la raison – qui plus est juridique – où par un pur jeu de l’esprit il ne serait par exemple qu’un rapport de normes qui se subsument. Le droit restera toujours confronté à la double problématique de son origine et de sa légitimité. Il s’inscrit ainsi dans une culture qui a plus à lui apprendre qu’il ne l’éclaire en retour. Pour le dire autrement, la méthode logico-déductive de la théorie de l’Etat semble aux antipodes de ce que l’anthropologie dogmatique nous dit de l’Etat.
A. Un détour par l’anthropologie dogmatique :
là où l’Etat recouvre tout autre chose qu’une personne morale
La théorie de l’Etat et l’anthropologie dogmatique partent d’un même constat : l’Etat a pour raison d’être d’éviter, comme l’écrivait Georges Burdeau dans son essai sur L’Etat, qu’un homme s’impose par la force à un autre homme[20]. La pure domination trouve dans l’Etat des limites qui sont celles du droit. C’est ce qui incite les théoriciens du droit à ne qualifier que juridiquement l’Etat. Mais c’est ce qui incite l’anthropologie dogmatique à qualifier l’Etat autrement que par le droit ; à savoir comme un invariant garant du droit. L’Etat est ainsi pour Pierre Legendre et Alain Supiot à prendre au sérieux comme question de langage : il est étymologiquement ce qui se tient debout parce que « [c]e montage institutionnel est la réponse occidentale à un impératif anthropologique affronté par toutes les civilisations humaines, qui doivent, pour se maintenir, métaboliser les ressources de la violence en référant le pouvoir à une origine qui tout à la fois le légitime et le limite[21] ».
Là où, par conséquent, théorie du droit et anthropologie dogmatique divergent profondément est que, pour la première, il est contre-productif de vouloir dévoiler l’origine d’un Etat : il ne présenterait que la figure odieuse de la Gorgone. En revanche, tout l’objet de l’anthropologie dogmatique est de précisément lever le voile ou, pour employer l’expression de Pierre Legendre, de « dévoiler les coulisses » de tout montage institutionnel dont l’Etat serait la figure type depuis l’appropriation, par les canonistes, de l’héritage juridique romain au profit de l’empire universel de Rome aux XIIe-XIIIe siècles. Car le propre de l’anthropologie dogmatique – qui de ce point de vue est très datée dans l’histoire des sciences humaines – consiste en une forme de structuralisme. Elle cherche les invariants en quelque sorte sous, ou en amont, des constructions juridiques ; elle cherche à éclairer non le droit en lui-même mais sa raison d’être ; elle tente d’appréhender non pas tant le comment du droit public mais son « pour quoi ? ». Et si l’anthropologie dogmatique est une histoire généalogique, elle fait fi forcément du moment 1789 et de la désincarnation de la souveraineté. En effet, si l’Etat emprunte à un prototype pontificaliste, il se doit d’être incarné parce que le christianisme est par essence la religion de l’incarnation. Il se doit du moins d’avoir l’anthropomorphisme comme croyance fondatrice même si le droit, comme opération du langage ou comme « forçage » ainsi que l’exprime Legendre, saura très bien distinguer ce qui relève du corps immortel du souverain ; c’est l’objet même de la souveraineté, perpétuelle par principe dès lors que « tout pouvoir vient de Dieu » selon le père de l’Eglise.
Toute la limite, peut-être, de l’anthropologie dogmatique, est de prendre très au sérieux un prototype d’Etat pontifical, de supposer comme intangible et comme seule genèse occidentale ce modèle à la vérité situé historiquement. En un mot l’anthropologie dogmatique prend pour modèle l’œuvre des canonistes qui considèrent que la fiction ne peut contrarier une nature créée par Dieu là où pour le droit romain – et peut-être pour la théorie du droit – la fiction de la personnalité est un mensonge assumé aux fins de l’efficacité des opérations du droit[22]. Ce qui n’empêche pas Pierre Legendre, notamment dans Le désir politique de Dieu, d’insister sur le fait que l’Etat forgé par la « bible » romano-canonique reste une fiction au sens d’un mensonge[23]. Mais ce qui distingue cette fiction de la personne eu égard à la fiction romaine de la personnalité, est qu’elle emprunte, du fait de son monothéisme, à un anthropomorphisme au moins symbolique. L’Etat est comme Dieu : l’éternel absent auquel les fictions donnent corps. L’Etat est donc une fiction qui parle par le droit parce que l’Etat emprunte à un anthropomorphisme symbolique qui est pour Legendre inévacuable. Cette histoire généalogique et symbolique, fondée principalement en croyance (la Raison avec un R majuscule pour Legendre), du fait qu’on ne pourrait évacuer le monothéisme latin, justifie ainsi qu’on doive assimiler l’Etat à un Père. Comme on l’a analysé en détail dans une contribution récente[24], la figure structurante de toute identification au pouvoir est celle du Père car, pour Legendre, il convient toujours de « remonter jusqu’à la manœuvre institutionnelle du père pour découvrir le fondement anthropologique du pouvoir comme fonction[25] ».
Si la souveraineté est tout ce qui donne corps à l’Etat comme l’écrivait Loyseau, la représentation dogmatique du souverain – au sens spécifiquement legendrien de mise en scène – ne peut faire l’économie d’un anthropomorphisme au moins en images : il se donne à voir pour que l’individu s’y projette.
B. Le corps désiré de l’Etat : l’Etat en images pieuses
L’acceptation du droit dépend de sa légitimité. L’acceptation est-elle raisonnée ? Il reste incertain que le droit tire sa force obligatoire de la sanction ; aussi bien peut-il tirer cette force obligatoire en quelque sorte en amont de toute sanction ; aussi bien peut-elle résulter d’un lien de confiance : le lien fiduciaire. Ce dernier, pour l’anthropologie dogmatique, tiendrait au fait que ce lien n’est pas une pure opération de la raison. Par emprunt à la psychanalyse, Pierre Legendre considère ainsi que l’Etat, en tant qu’Institution, s’adresse d’abord au désir. C’est en cela qu’il institue : il résout la question anthropologique liée à la question massive de l’Etre. L’Etat ce serait rien moins que le tiers garant d’une identification à soi et au monde.
Si « [n]ous ne sommes pas prêts à reconnaître que les constructions institutionnelles mettent en scène des figurations du désir[26] » c’est essentiellement parce que, pour l’anthropologie dogmatique, le droit public contemporain commet l’erreur de vouloir ignorer les enseignements de la psychanalyse. A commencer par cet « accident de la pensée » que serait la découverte de l’inconscient. La « prise en compte de l’inconscient défait notre vision de l’institutionnel. Pourquoi ? Parce que le lien du sujet et de la société n’apparaît plus comme relation de surface, faite de discours et comportements objectivables[27] ». Mû par son inconscient qui n’est que désir, « l’animal parlant » qu’est l’homme a besoin d’être borné – éduqué – dans l’expression de son désir : il doit pouvoir le projeter sur l’Etat. A ce titre, les justifications juridiques et savantes du pouvoir de cet Etat n’auraient pour fonction que de s’adresser au désir. Pierre Legendre, dès 1974, consacre tout un essai à rendre compte des catégories du droit public à l’aune d’un inconscient qui ne serait que la manifestation du ou des désirs. Dans L’Amour du Censeur, au chapitre intitulé « Où Freud pouvait voir l’institution », il considère ainsi que le « grand œuvre institutionnel […] travaille à escamoter ou réduire le désir ». La soumission à l’institution doit être alors « l’amour de l’institution ». Elle doit, pour y parvenir, se mettre en scène et prendre l’apparence d’une personne à laquelle « l’amour de l’institution » pourra être dédié[28]. On devine ici, pour Legendre, toute l’importance de la fiction juridique qui consiste à assimiler l’Etat à une personne. Même si l’Etat est une fiction et donc a priori une forme vide, par l’effet du monothéisme latin, il investit le corps d’une personne. Alors que la théorie du droit rejette hors du droit la représentation par les images, l’anthropologie dogmatique, au contraire, insiste sur son importance. On sait tout l’intérêt que Pierre Legendre porte à l’iconographie du pouvoir où l’anthropomorphie est en quelque sorte un passage obligé ; elle en dit aussi long que le discours juridique en soutien de la souveraineté car elle met en scène son prestige ; c’est ce prestige qui fonde la foi en ce qu’on nomme l’Etat. Ainsi de la gravure anglaise extraite de George Wither, A Collection of Emblems, 1630 que Legendre reproduit à deux reprises, dans son essai La Balafre puis dans son essai Fantômes de l’Etat en France. Elle représente le Prince armé d’une épée et d’un livre. Pour notre auteur, « [e]lle énonce la représentation iconique de l’Etat en Europe, sur fond de romano-christianisme : le César, maître du Livre et de l’Epée[29] ». Charles Ier, déguisé en empereur romain, représente l’Etat du fait de la Couronne, symbole de la souveraineté. C’est ainsi, poursuit Legendre, que « [l]’Emblème du roi portant sa Couronne nous permet de mettre le doigt sur ce qui constitue le ressort des structures étatiques […]. Ce ressort, c’est la logique des valeurs […]. Autrement dit, l’Etat est un sujet de fiction, une personne morale comme disent les juristes, dans la présence et l’efficacité de laquelle on croit. Cela signifie que, sans le ressort de valeurs fiduciaires, sans le ressort des croyances, un Etat se décompose ou n’est qu’une apparence d’Etat[30] ».
Les
portraits officiels des présidents de la cinquième République ne perpétuent-ils
pas ce tour de passe-passe du souverain incarné ? Ne sont-ils pas ce qu’étaient
pour l’église les images pieuses : celles auxquelles on voue sa dévotion
et sa foi ? Ce n’est pas la Nation, encore moins l’Etat que l’on
figure : c’est un homme. Juridiquement Président de la République.
Inconsciemment, pour l’imaginaire collectif auquel le portrait officiel s’adresse,
chef de l’Etat. De l’Etat il a visuellement la stature puisqu’il se tient debout. En l’occurrence dans un palais,
celui de l’Elysée. Outre que ce palais perpétue la tradition du souverain
plébiscité – donc aimé – du second Empire, son nom même s’adresse au désir
collectif comme à notre insu : réservées aux âmes vertueuses après leurs
morts, les champs élyséens sont pour Homère
le lieu où la vie la plus douce est offerte aux humains. Debout donc, le
souverain moderne qu’est Emmanuel Macron
n’est pas en pieds : l’iconographie moderne se doit de nous le montrer
comme par sa tête. L’effet visuel le couronne. Ce souverain est, ainsi que le
disaient les médiévaux au sujet des lois du Roi, de certa scienca. En témoigne le livre ouvert, comme consulté à l’instant,
posé à la droite du président sur son bureau et dont le photographe vient de le
distraire. Le chef de l’Etat était au travail ; il s’inspirait de la
vérité des écritures qu’il est chargé de nous relever comme en témoigne cette
mise en scène. Il est à la fois le prêtre des lois comme l’étaient les
magistrats pour Domat et la loi
vivante comme l’était le Roi dans l’ancien droit parce qu’il a la maîtrise du
texte de ce livre volontairement anonyme puisque qu’il est un symbole – de ce
maître livre (sinon à quoi bon le faire figurer ?) dont tout porte à
croire qu’il puisse s’agir d’une Bible.
[1] L. Duguit, L’Etat, le droit objectif et la loi positive, Paris, Fontemoing, 1901, p. 242.
[2] R. Descartes, Méditations métaphysiques (1647 pour la version française), Paris, Garnier-Flammarion, 2009, p. 79 (Première Méditation. Des choses que l’on peut révoquer en doute).
[3] La querelle sur la question de savoir si la personne morale est « réelle » ou purement fictive occupe en premier lieu la doctrine dite privatiste à un moment où le législateur reconnaît, par la loi de 1901, la personnalité morale aux associations. Le débat est d’autant plus vif que la Révolution avait, par la suppression des privilèges et donc des ordres, comme jeté un interdit sur la question de la personnalité morale appliquée à des êtres collectifs.
[4] R. Carre de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, Paris, Sirey, 1920, tome I, p. 9 : « […] dans les sociétés étatisées, ce que les juristes nomment à proprement parler l’Etat, c’est l’être de droit en qui se résume abstraitement la collectivité nationale. Ou encore, suivant la définition adoptée par les auteurs français : l’Etat est la personnification de la nation ». Carre de Malberg se réfère explicitement à A. Esmein qui, dans ses Eléments de droit constitutionnel, Paris, 1896, écrivait dès la page 1 de son Introduction : « L’Etat est la personnification d’une nation ».
[5] M. Gauchet, La Révolution des pouvoirs. La souveraineté, le peuple et la représentation (1789-1799), Paris, Gallimard, p. 187 et s.
[6] G. Bigot, « La force du gouvernement. Ecritures et réécritures constitutionnelles de l’administration (1789-1795) », Ahrf, 2017, n° 3, p. 19-37.
[7] L. Heuschling, Etat de droit, Rechtsstaat, Rule of Law, Paris, Dalloz « Nouvelle Bibliothèque de Thèses », 2002, p. 348 : « Du temps de la Révolution, le terme Etat tombe quelque peu dans l’oubli […]. Si le terme est connu de tous les auteurs de l’époque allant de 1815 à 1870, on cherchera néanmoins en vain un chapitre exclusif consacré à une théorie générale de l’Etat […]. En général, les définitions de l’Etat sont rares et succinctes ».
[8] G. Bigot, « La conception de l’Etat dans l’œuvre d’Edouard Laboulaye », Rfhip, n° 47, 2018, p. 59-80.
[9] M. Stolleis, Histoire du droit public en Allemagne, 1800-1914, Paris, Dalloz « Rivages du droit », 2014, notamment p. 587 et s. V. également O. Jouanjan, Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918), Paris, Puf « Léviathan », 2005, p. 231 et s.
[10] L. Duguit, L’Etat, le droit objectif et la loi positive, préc. et L’Etat, les gouvernants et les agents, Paris, Fontemoing, 1903.
[11] L. Duguit, L’Etat, le droit objectif et la loi positive, préc. p. 251.
[12] Ibid. p. 243 et s.
[13] E. Maulin, La théorie de l’Etat de Carré de Malberg, Paris, Puf « Léviathan », notamment p. 149 et s.
[14] R. Carre de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, préc. p. 25.
[15] Ibid. p. 27.
[16] Ibid. note de bas de page n° 22.
[17] N. Hakim, « Michoud et la doctrine de droit privé », in Léon Michoud, X. Dupre de Boulois et Ph. Yolka (dir.), Paris, Institut Universitaire Varenne « Colloques & Essais », 2014, p. 63-84.
[18] L. Michoud, La théorie de la personnalité morale. Son application au droit Français (1906), 2e édition par Louis Trotabas, Paris, Lgdj, 1924, Tome I, p. 289 (chapitre III – La création des personnes morales de droit public) : « L’Etat est la première personne juridique que nous rencontrons dans le monde actuel. Son existence est un fait naturel, que le Droit n’a qu’à interpréter, et dont il paraît tirer les conséquences juridiques ».
[19] F. Brunet, La normativité en droit, Paris, Mare & Martin « Bibliothèque des thèses », 2011, notamment p. 427 et s. pour ce qui concerne le droit public.
[20] G. Burdeau, L’Etat, Paris, Seuil, 1970, p. 15.
[21] A. Supiot, La Gouvernance par les nombres. Cours au collège de France (2012-2014), Paris, Fayard « Poids et mesures du monde », 2015, p. 274.
[22] Cette distinction fondamentale entre la fiction juridique romaine et la fiction juridique du droit romano-canonique a été parfaitement mise en lumière par Yan Thomas, Les opérations du droit, Paris, Ehess Gallimard-Seuil, 2011, p. 133-185.
[23] P. Legendre, Leçons VII. Le désir politique de Dieu. Etude sur les montages de l’Etat et du Droit, Paris, Fayard, 2e édition, 2005, p. 55 et s.
[24] G. Bigot, « Une généalogie de l’Etat ? Notes brèves sur le Trésor historique de l’Etat en France au miroir de l’anthropologie dogmatique », Revue d’Histoire des Facultés de Droit, 2017, p. 563-583.
[25] P. Legendre, Leçons VII. Le désir politique de Dieu, préc. p. 280.
[26] Ibid. p. 27.
[27] P. Legendre, De la société comme texte. Linéaments d’une anthropologie dogmatique, Paris, Fayard, 2001 ;p. 114.
[28] P. Legendre, L’Amour du Censeur. Essai sur l’ordre dogmatique, Paris, Seuil « Champ Freudien », 1974, réédition 2005, p. 29.
[29] P. Legendre, La Balafre. A la jeunesse désireuse d’apprendre… Discours à de jeunes étudiants sur la science et l’ignorance, Paris, Mille et une Nuits « Les quarante piliers », 2007, p. 110.
[30] P. Legendre, Fantômes de l’Etat en France. Parcelles d’histoire, Paris, Fayard « Les quarante piliers », 2015, p. 196-198.
Nota Bene : le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso. Vous pouvez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).
À propos de l’auteur