Voici la 71e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 8e livre de nos Editions dans la collection L’Unité du Droit, publiée depuis 2012.

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :
Cet ouvrage, paru en juin 2014, est le huitième
issu de la collection « L’Unité du Droit ».
Volume VIII : Fragmentation
en Droit /
Fragmentation du Droit
Ouvrage collectif
(Direction Jordane Arlettaz & Romain Tiniere)
– Sortie : 03 juin 2014
– Prix : 39 €
- ISBN : 979-10-92684-02-5
- ISSN : 2259-8812
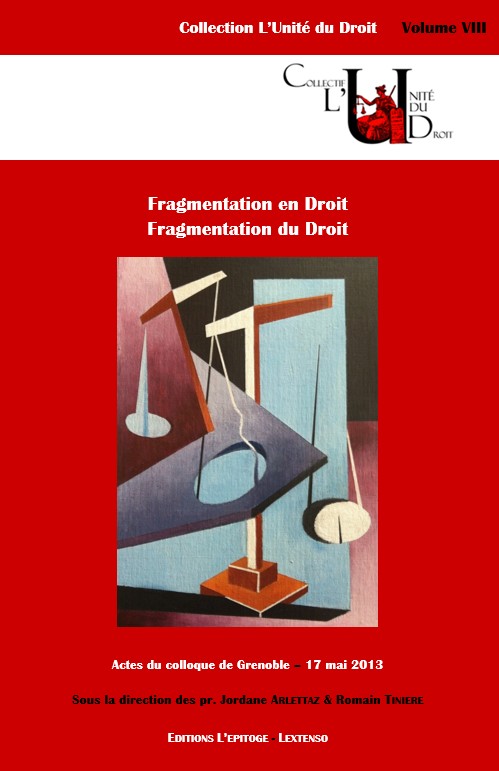
Présentation :
Fragmentation des notions, fragmentation des normes, fragmentation des acteurs juridiques : le Droit, constitutif d’un véritable système juridique, n’échappe pas à la problématique de la fragmentation qui traverse depuis longtemps l’ensemble des sciences sociales et humaines. Déjà largement défrichée en Droit international, la fragmentation appelle une réflexion théorique et interdisciplinaire qui s’avère à ce jour encore latente.
Ce Colloque entend ainsi offrir le cadre idoine à l’étude du phénomène tant de la fragmentation du droit que de la fragmentation en droit. Le système juridique se fragmente-t-il ? Quelle figure emprunte la fragmentation dans le champ juridique ? Quels effets produit la fragmentation au regard de la construction de la norme juridique, du dialogue des juges ou encore des droits des citoyens ?
Droits fondamentaux
& fragmentation
de l’application des droits international et européen
Sébastien Platon
Professeur de droit public à l’Université Bordeaux IV
La présente contribution s’inscrit dans le cadre d’une problématique qui n’a plus guère besoin d’être présentée tant elle est désormais empreinte de classicisme, celle qu’il est convenu de qualifier de problématique des « rapports de systèmes »[1]. Il s’agira ici d’étudier si, et dans quelle mesure, le respect des droits fondamentaux, valeurs que l’on pourrait pourtant considérer comme unificatrices à défaut d’être universelles, peut être source d’une fragmentation au stade de la mise en œuvre des normes internationales et européennes, en raison notamment des différents ordres juridiques successivement impliqués dans cette mise en œuvre.
Cette réflexion nécessite en tout premier lieu de procéder à un éclaircissement d’ordre sémantique, à savoir le choix de l’expression « mise en œuvre ». Ce choix a été guidé par la volonté d’englober le plus largement possible toutes les formes de « réalisation »[2] du droit de l’Union européenne. Certes, il aurait été tout à fait envisageable d’utiliser à cette fin le terme « exécution », qui est d’ailleurs le plus usité en doctrine[3]. La Cour de justice a d’ailleurs pu elle-même interpréter largement ce terme en affirmant qu’il « comprend tout à la fois l’élaboration de règles d’application et l’application de règles à des cas particuliers par le moyen d’actes à portée individuelle »[4]. Le terme « ap-plication » lui-même aurait également pu être choisi, tant il est vrai que l’extrait qui vient d’être cité donne l’impression que les deux expressions sont interchangeables[5]. Le choix de l’expression « mise en œuvre » s’explique cependant pour deux séries de raisons.
Tout d’abord, il existe une certaine ambiguïté quant à la signification exacte des notions d’exécution et d’application, et même quant aux rapports existant entre elles, malgré l’impression d’une identité sémantique que laisse la jurisprudence.
Par exemple, dans la doctrine administrativiste française, les deux termes ne font pas l’objet d’un emploi univoque. Ainsi par exemple J.-M. Auby appelle-t-il « règlement d’exécution d’une loi » les règlements qui fixent les mesures complémentaires de la loi, qui déterminent, dans certaines limites juridiques, les modalités d’application de la loi, sans lesquelles celle-ci serait inapplicable[6]. J.-C. Venezia, en revanche, préfère qualifier de mesures prises « pour l’application » d’un texte les mesures venant « préciser les détails ou les modalités d’application de règles édictées par une autorité supérieure »[7]. Par ailleurs, ce même auteur considère comme synonymes les expressions « mesures prises en application » et « mesures d’exécution », expressions qui renvoient en outre surtout chez lui à des mesures individuelles[8].
Cette ambiguïté se retrouve en droit de l’Union européenne, même lorsque l’on se cantonne au seul droit originaire. Ainsi, le Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité contient les modalités procédurales du contrôle du respect de ces principes. Parallèlement, le Protocole sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni semble également porter sur les modalités d’application de la Charte, mais cette fois plus dans le sens d’une restriction de la portée de la Charte vis-à-vis de ces deux pays que dans le sens d’une effectivité de celle-ci. Le terme « exécution » est quant à lui au centre de l’article 291 Tfue, relatif précisément aux actes d’exécution. Mais la notion d’exécution n’y est pas définie en elle-même, et une ambiguïté existe entre « mise en œuvre » et « exécution ». En effet, le premier paragraphe énonce que « les Etats membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union ». Mais dès le paragraphe 2, il est précisé que « lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l’Union européenne, au Conseil ».
De cette disposition, il est difficile de déduire le lien existant entre « exécution » et « mise en œuvre ». L’impression d’une équivalence sémantique totale est forte. Mais l’articulation des deux paragraphes, le premier énonçant le principe et le deuxième énonçant une exception, peut également suggérer un contour plus restreint pour l’exécution que pour la mise en œuvre, qui semble alors avoir un contour plus large. C’est là la deuxième raison qui a présidé à ce choix terminologique. Cette impression du caractère « large » de la notion de mise en œuvre est en effet confirmée par la jurisprudence relative à une autre disposition du droit originaire qui emploie l’expression « mise en œuvre », à savoir l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En vertu de cette disposition, la Charte s’applique aux Etats membres lorsqu’ils « mettent en œuvre » le droit de l’Union. Or, la jurisprudence de la Cour de justice semble donner un sens très large à cette notion de « mise en œuvre » : par exemple, dans l’arrêt N.S. du 21 décembre 2011[9], reprenant sur ce point l’arrêt ERT du 13 juillet 1989[10], la Cour de justice a estimé que le fait, pour un Etat, d’utiliser une dérogation prévue par le droit de l’Union était encore constitutive d’une mise en œuvre du droit de l’Union, de sorte que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union européenne s’imposent aux Etats membres lorsqu’ils utilisent cette dérogation. Or, dans une telle hypothèse, « le « lien fonctionnel » entre la norme communautaire et l’acte national paraît manquer »[11], de sorte qu’il est difficile de parler « d’exécution ».
C’est donc la notion de « mise en œuvre » qui sera ici retenue. Néanmoins, et pour la clarté du propos, il est important d’insister sur le fait que la notion de « mise en œuvre » sera employée, dans le cadre de cette contribution, dans un sens stipulatif et volontairement large, indépendamment de sa signification exacte en droit de l’Union européenne, laquelle n’est pas complètement univoque. Et c’est tout autant (voire encore plus) de façon stipulative que l’on essaiera de définir les phénomènes ainsi « englobés » dans cette notion-mère. Nous nous permettrons donc de définir ici la notion de « mise en œuvre » comme recouvrant plusieurs modalités ayant des fonctions distinctes.
Pour désigner la première forme de mise en œuvre, nous proposons, malgré sa nette inélégance, le néologisme « applicabilisation ». Il s’agit de l’adoption des actes, qui sont en principes des actes à portée générale, nécessaires à l’application de la norme de référence. Ainsi d’un décret qui fixe les modalités d’application d’une loi ou apporte les précisions sans laquelle cette loi ne saurait être applicable. Pour ainsi dire par nature, l’applicabilisation est obligatoire pour les autorités de mise en œuvre puisque, sans elle, la norme de référence est inapplicable. En revanche, et là aussi par nature, l’autorité de mise en œuvre dispose d’une certaine marge d’appréciation pour définir les détails et les modalités d’application de la norme de référence.
L’application, quant à elle, renvoie intuitivement au fait d’appliquer la règle générale dans un cas particulier. Cette modalité de concrétisation par individualisation requiert logiquement plutôt le recours à des décisions individuelles, entendues dans un sens large incluant à la fois les décisions administratives et les décisions de justice (application individuelle). L’application ne nous semble toutefois pas exclusive de l’adoption de mesures générales, le « cas particulier » pouvant être en réalité une catégorie abstraite d’individus (application abstraite). Dans les deux cas, l’application est donc, comme l’applicabilisation, de nature normative. L’application n’est en revanche pas forcément obligatoire : si la norme donne un pouvoir à l’autorité de mise en œuvre, celle-ci peut ne pas l’utiliser. Elle peut en revanche être obligatoire, et cette obligation peut aller jusqu’à une compétence liée.
La notion d’exécution, nous l’avons vu, est habituellement utilisée dans un sens très large par la doctrine relative à l’Union européenne[12]. L’article 291 Tfue semble également l’utiliser dans un sens très large, englobant certainement « l’applicabilisation » et une partie de l’application (mais certainement pas, par exemple, l’application des dérogations prévues par le droit de l’Union européenne[13]). L’on se permettra ici de faire preuve d’une nette autonomie sémantique ici, et de retenir au contraire un sens étroit à ce terme. Par emprunt au droit administratif (l’exécution d’une décision) et au droit pénal (l’exécution d’une peine) plutôt qu’à la théorie constitutionnelle (la fonction exécutive), l’on considérera ici l’exécution comme relevant plutôt de la concrétisation matérielle de la norme, y compris, le cas échéant, en ayant recours à la force publique lorsque la norme créé des obligations à la charge de personnes privées. C’est ce sens-là, nonobstant les ambiguïtés sémantiques précédemment relevées dans la doctrine administrativiste française, que nous retiendrons ici.
Enfin, il nous semble que la sanction de la norme, y compris (mais non seulement) pénale, a aussi sa place dans la notion de mise en œuvre. Par exemple, dans l’affaire dite des « maïs grecs »[14], la Cour a déduit du principe de coopération loyale l’obligation de sanctionner les violations du droit de l’Union de manière effective, proportionnée et dissuasive.
Cette définition stipulative de la mise en œuvre étant posée, reste à déterminer, d’une part, comment les droits fondamentaux peuvent constituer une source de fragmentation de la mise en œuvre des normes internationales et européennes et, d’autre part, quelles peuvent en être les conséquences.
La problématique des rapports de systèmes est sur ce point suffisamment connue pour qu’il ne soit pas nécessaire de s’étendre outre mesure. De la jurisprudence Solange de la Cour constitutionnelle allemande[15] à l’arrêt Arcelor du Conseil d’Etat[16] en passant par l’arrêt Bosphorus de la Cour européenne des droits de l’homme[17], l’arrêt Kadi de la Cour de justice[18] ou encore la décision Economie numérique du Conseil constitutionnel[19], les jurisprudences marquantes sur cette question sont connues au-delà des disciplines dont elles relèvent.
On se contentera donc, pour amorcer la réflexion, de rappeler la crainte qui est ici en cause, à savoir que la mise en œuvre des normes internationales et européennes soit entravée par la protection des droits fondamentaux. Il y a bien dans ce cas un risque de fragmentation puisque la façon dont la norme internationale ou européenne est mise en œuvre sera différente, selon les Etats ou selon les régions, en fonction des standards de protection des droits de l’homme applicables. Et on le voit, ce qui est menacé, c’est l’uniformité d’application des droits international et européen, mais également, au-delà, leur primauté et leur effectivité.
Présenté ainsi, l’enjeu semble être de taille, puisqu’il s’agit apparemment de choisir entre respect des droits fondamentaux et uniformité d’application des droits international et européen. Et ce, d’autant plus que le « normateur » européen ou international est le plus souvent démuni de la puissance d’exécution des normes qu’il édicte, devant par conséquent abandonner leur mise en œuvre à des acteurs intermédiaires, le plus souvent les Etats, astreints à leur propre système de protection des droits fondamentaux. Cette logique se retrouve également en droit de l’Union européenne, sous la forme du principe d’administration indirecte[20]. Pour autant, la menace est-elle si lourde ? On se souvient, par exemple, que la « menace constitutionnelle » contre la primauté du droit de l’Union, s’était cristallisée dans les années 60-70 par les jurisprudences constitutionnelles allemandes[21] autour, précisément, de la protection des droits fondamentaux. Mais par la suite, en raison de la protection croissante des droits fondamentaux en droit de l’UE, la menace s’est dégonflée[22].
Par ailleurs, la fragmentation, quand elle existe, n’est pas forcément dangereuse ou indésirable. En réalité, dans un grand nombre de cas, on pourrait même dire qu’elle est acceptée, voire voulue par les auteurs de la norme. Par exemple, en vertu de l’article 291 Tfue, si c’est normalement aux Etats qu’incombe l’exécution des actes juridiques de l’UE, le législateur européen peut néanmoins décider qu’il incombera à la Commission, ou bien, dans des cas exceptionnels, au Conseil, d’assurer l’exécution de l’acte, lorsque précisément « des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires ». Le législateur de l’Union a donc le pouvoir d’éviter le risque de fragmentation s’il le souhaite, en privilégiant une exécution centralisée plutôt que décentralisée du droit de l’UE.
Il faut donc se focaliser sur les hypothèses dans lesquelles la fragmentation est non seulement possible mais également préjudiciable, en particulier au regard de l’effectivité de la norme européenne et internationale mise en œuvre. Or, il apparaît ici que, contrairement à ce qu’une présentation catastrophiste des rapports de systèmes pourrait suggérer, le respect des droits fondamentaux n’est qu’un vecteur marginal de fragmentation dans la mise en œuvre des droits international et européen (I). Reste, toutefois, une hypothèse dans laquelle la protection des droits fondamentaux est indubitablement un facteur de fragmentation : il s’agit du cas particulier des sanctions ciblées onusiennes, en raison de la faible protection des droits fondamentaux dont ces sanctions sont assorties (II).
I. L’impact limité de la protection des droits fondamentaux sur la fragmentation des normes internationales et européennes
Cet impact limité s’explique par les conditions, exigeantes, auxquelles est soumise l’existence d’une telle fragmentation. D’une part, se pose la question de l’origine de la violation des droits fondamentaux (A). D’autre part, il ne peut y avoir de fragmentation que lorsque tous les acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre ne sont pas soumis aux mêmes standards (B). Et enfin, il ne peut y avoir fragmentation durable ou structurelle que si les standards de protection des droits fondamentaux sont plus exigeants au stade de la mise en œuvre de la norme qu’ils ne le sont au stade de son élaboration (C).
A. La question de l’origine de la violation des droits fondamentaux
De deux choses l’une : soit la violation résulte intrinsèquement de la norme mise en œuvre, soit elle résulte de la façon dont elle a été mise en œuvre. Il est assez facile de voir que, dans le premier cas, les droits fondamentaux posent une entrave structurelle à toute mise en œuvre de la norme. Dans le second cas, au contraire, cette norme n’est pas elle-même mise en cause et peut toujours être mise à exécution.
Il se peut par exemple que ce soient les formes et la procédure qui ont présidé à la mise en œuvre qui posent problème. Et dans ce cas, la violation des droits fondamentaux ne résulte pas de la norme elle-même, seulement de sa mise en œuvre. Par exemple, les mesures « d’applicabilisation » ou d’application, au sens retenu dans le cadre de cette étude[23], peuvent être grevées d’une illégalité externe, ce qui ne remet pas en cause la norme mise en œuvre elle-même. L’on peut relever ainsi que le Conseil constitutionnel, dans sa décision Droits d’auteur[24], a contrôlé sans réserve la régularité de la procédure d’une loi de transposition d’une directive. De même, le Conseil d’Etat réserve expressément, dans l’arrêt Arcelor, la possibilité d’un « contrôle des règles de compétence et de procédure » pour les actes réglementaires de transposition des directives, puisque l’exécution du droit de l’Union ne bouleverse pas l’ordre des compétences établi par le droit français[25]. Le même raisonnement s’applique à l’exé-cution, notamment à l’exécution forcée, et à la sanction de la norme internationale ou européenne. En effet, de telles mesures sont, par leur nature même, susceptibles de violer les droits fondamentaux indépendamment de la norme ainsi exécutée ou sanctionnée. Il suffit alors aux autorités concernées de mettre en œuvre la norme dans le respect des voies et procédures requises par le respect des droits de l’homme pour que l’effectivité de la norme internationale ou européenne soit intacte. La fragmentation ici ne peut être que très ponctuelle et accidentelle, par exemple dans le cas de l’annulation, pour violation d’un droit fondamental, de la sanction d’une violation de la norme internationale ou européenne.
Il se peut également que la violation des droits fondamentaux résulte non pas de la norme elle-même mais de l’exercice, par l’autorité de mise en œuvre, d’une marge d’appréciation laissée par la norme. On retrouve notamment cette question de la marge d’appréciation dans la jurisprudence française du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat, avec les jurisprudences Economie numérique et Arcelor, déjà mentionnées. En effet, ces solutions, on s’en souvient, ne concernent que les mesures nationales qui se bornent à transposer les dispositions inconditionnelles et précises d’une directive. L’absence de marge d’appréciation est également une condition de l’irrecevabilité des contestations constitutionnelles contre les lois de transposition[26] et les mesures d’exécution du droit de l’Union européenne[27] dans la jurisprudence constitutionnelle allemande. Et enfin, la Cour européenne des droits de l’homme fait également de l’absence de marge d’appréciation laissée aux Etats par le droit de l’Union une condition d’octroi de la présomption d’équivalence[28]. Ces positions jurisprudentielles signifient nettement que, en présence d’une marge d’appréciation pour l’autorité de mise en œuvre, aucun problème ne se pose, aucun risque de conflit insurmontable ne se présente. C’est qu’en effet, si l’Etat bénéficie d’une marge d’appréciation, il a donc le choix entre plusieurs mesures de mise en œuvre. Il lui appartient alors, parmi toutes ces mesures possibles, de choisir une de celles qui ne violent pas les droits fondamentaux. Dans ce cas-là, les droits fondamentaux n’entravent donc pas la mise en œuvre de la norme. Cette approche semble compatible avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE, et notamment avec l’arrêt Melloni du 26 février 2013, selon lequel « lorsqu’un acte du droit de l’Union appelle des mesures nationales de mise en œuvre, il reste loisible aux autorités et aux juridictions nationales d’appliquer des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, pourvu que cette application ne compromette pas (…) la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union »[29]. Or, il semble logique que plus la marge d’appréciation de l’Etat est large, plus cet espace dans lequel les standards nationaux peuvent s’appliquer est lui aussi large, et inversement.
On peut alors relever que certaines « formes » de mise en œuvre, telles qu’on les a classées plus haut, sont plus susceptibles que d’autres de laisser une marge d’appréciation certaine aux Etats. Par exemple, en ce qui concerne « l’applica-bilisation », il va de soi que celle-ci n’a de sens que si la norme est à la base insuffisamment claire ou précise, ce qui induit une certaine latitude pour l’autorité de mise en œuvre. Il faut cependant mettre de côté le cas de la transposition des directives, qui se rattache fondamentalement à la logique « d’applicabilisation » (sauf, éventuellement, à considérer la transposition comme une modalité sui generis de mise en œuvre) mais qui s’impose même lorsque la directive est claire, précise et inconditionnelle, en raison de la nature singulière de « législation à deux étages » des directives. En ce qui concerne en revanche l’application, l’exécution et la sanction, la norme mise en œuvre peut être tout aussi bien vague que précise, générant alors soit un pouvoir discrétionnaire soit une compétence liée pour l’autorité en charge de la mise en œuvre. Notamment, on peut considérer que l’exercice d’une simple faculté offerte par la norme internationale ou européenne peut tout à fait être soumis aux contraintes résultant de la protection des droits fondamentaux sans que cela porte atteinte à l’effectivité de la norme mise en œuvre. Cela inclut en particulier les hypothèses dans lesquelles la norme internationale ou européenne accorde à ses destinataires une faculté de dérogation à la règle ou au principe qu’elle pose[30] : dans ce cas-là, soumettre l’exercice de cette faculté de dérogation au respect des droits fondamentaux ne remet pas en cause l’effectivité de la règle à laquelle il est dérogé.
En toute hypothèse, il convient de relever, comme il l’a été évoqué précédemment, que lorsque la norme internationale ou européenne réserve une marge d’appréciation aux acteurs qui sont en charge de sa mise en œuvre, la fragmentation dans cette mise en œuvre est non seulement inévitable mais acceptée, voire voulue a priori. Et ce, en réalité, indépendamment de l’interposition des droits fondamentaux dans la mise en œuvre. Pour le dire autrement, si l’auteur de la norme internationale ou européenne veut limiter le risque de fragmentation dans l’application de la norme, il lui suffit de la préciser. Mais il est vrai que l’imprécision a certains avantages, et notamment l’amphibologie que requiert parfois le consensus…
B. La différence de standards de protection entre autorités de mise en œuvre
Il faut également relever que, quasiment par définition, il ne peut y avoir de fragmentation que lorsque les acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre ne sont pas tous soumis aux mêmes standards.
Par exemple, tous les Etats membres de l’UE sont parties à la Cedh. Par conséquent, celle-ci ne peut que marginalement engendrer une fragmentation dans la mise en œuvre du droit de l’UE. Il se peut certes que certains Etats aient émis des réserves à la Cedh. Par ailleurs, tous les Etats membres n’ont pas ratifié les mêmes protocoles additionnels. Dans ces cas-là, la disposition ayant fait l’objet de la réserve, ou bien contenue dans un protocole non ratifié par tous les Etats membres de l’UE, peut engendrer une inexécution du droit de l’UE par certains Etats membres (ceux soumis à la disposition en cause) cependant que les autres (ceux qui n’y sont pas soumis) ne souffriront d’aucun obstacle juridique pour exécuter correctement leurs obligations au titre du droit de l’Union.
En dehors de ces cas, il est vrai qu’il peut théoriquement y avoir un conflit entre droit de l’UE et Cedh, ce qui pose bien évidemment des questions complexes de primauté et d’effectivité des normes en question. Mais il n’y a pas fondamentalement un problème d’homogénéité dans la mise en œuvre puisque tous les Etats concernés sont confrontés au même conflit entre mise en œuvre d’une norme et respect d’une autre – par exemple lorsqu’une directive s’avère incompatible avec la Cedh.
La fragmentation n’existe alors que de façon marginale. Elle peut résulter par exemple d’une différence entre Etats quant aux choix qu’ils font entre les normes en conflit. Les uns peuvent choisir de mettre en œuvre malgré tout la norme qui viole les droits fondamentaux, les autres peuvent privilégier la protection des droits de l’homme et laisser cette même norme inappliquée. Il en découle alors effectivement une fragmentation dans la mise en œuvre de la norme. Mais celle-ci est en réalité aléatoire, tributaire des choix des Etats sachant que, dans ce genre de situation, par définition, tous les choix sont mauvais…
Dans la même veine, peut également être mentionnée l’hypothèse dans laquelle un Etat est effectivement condamné, par exemple par la Cour européenne des droits de l’homme, du fait de la mise en œuvre d’une norme internationale ou européenne alors que les autres Etats parties également soumis à cette même norme ne le sont pas, ou pas encore. Dans ce cas-là, seul l’Etat concerné est explicitement confronté au conflit. Mais en réalité, tous les autres le sont virtuellement aussi, car si la violation des droits fondamentaux résulte bien intrinsèquement de la norme appliquée, alors tous les Etats qui ont mis en œuvre cette norme sont également en situation de violation.
Au final donc, lorsque les standards de protection des droits fondamentaux sont les mêmes dans tous les systèmes juridiques impliqués dans l’opération de mise en œuvre, le risque de fragmentation est faible, voire nul. On peut même aller plus loin ici et relever qu’il y a des hypothèses dans lesquelles la condamnation de l’Etat par la Cour européenne des droits de l’homme porte en elle une incitation à une plus grande homogénéité dans la mise en œuvre des normes de l’Union européenne. On pense ici à l’arrêt Michaud de la Cour Edh du 6 décembre 2012[31] : dans cet arrêt, la Cour a implicitement reproché au Conseil d’Etat français de ne pas avoir posé une question préjudicielle en appréciation de validité à la Cour de justice de l’UE à propos des directives européennes sur la lutte contre le blanchiment d’argent[32]. En raison de cette carence du Conseil d’Etat français, la Cour a estimé que le système juridictionnel communautaire de protection des droits de l’homme n’avait pas pu jouer. Et par conséquent, la France ne pouvait pas bénéficier de la présomption de respect des droits fondamentaux résultant de la jurisprudence Bosphorus[33]. On voit très bien en quoi une telle position est de nature à inciter les juridictions nationales à respecter leurs obligations en matière de renvoi préjudiciel. Or, il n’est pas besoin de rappeler que la raison même de la procédure préjudicielle est précisément l’uniformité d’application et d’interprétation du droit de l’UE.
C. L’existence d’un standard de protection plus élevé au stade de la mise en œuvre qu’au stade de l’élaboration de la norme
Le risque de fragmentation dans la mise en œuvre des droits international et européen n’est en outre sérieux que lorsque les standards de protection des droits fondamentaux applicables à l’échelon où la norme est mise en œuvre sont plus exigeants qu’ils ne le sont à l’échelon où la norme a été adoptée. En effet, dans cette hypothèse, la mise en œuvre de la norme est localement paralysée, alors que la norme est elle-même valide du point de vue de son système juridique de référence.
Il en résulte que les droits fondamentaux constitutionnels ne sont plus guère de nature à occasionner une fragmentation de la mise en œuvre des normes issues du droit de l’Union. La Cour de justice s’est en effet efforcée de développer des standards de protection des droits fondamentaux qui sont globalement équivalents à ceux résultant des constitutions nationales. L’arrêt Internationale Handelsgesselchaft[34] mentionne les traditions constitutionnelles communes parmi les sources des principes généraux du droit de l’Union – même si, par la suite, cette source spécifique a été beaucoup moins utilisée que la Cedh, beaucoup plus facile à mobiliser. L’article 52§4 de la Charte des droits fondamentaux, sur un registre plus musical, précise que les dispositions de la Charte doivent dans la mesure du possible être interprétées « en harmonie » avec les traditions constitutionnelles communes. Cette convergence, il est inutile de le rappeler, est à l’origine des jurisprudences constitutionnelles d’apaisement des rapports entre droit constitutionnel et droit de l’Union, que ce soit en Allemagne, en Italie, ou en France avec les jurisprudences Economie numérique et Arcelor déjà mentionnées.
Il est à noter en revanche que la jurisprudence Arcelor du Conseil d’Etat, contrairement aux autres jurisprudences évoquées, ne présume pas a priori et in abstracto l’équivalence entre principes constitutionnels et principes européens : cette équivalence doit être prouvée au cas par cas, et elle doit l’être in concreto. Autrement dit, les principes doivent être équivalents au regard des moyens soulevés par les requérants. C’est ce qu’illustre l’arrêt Arcelor. Dans cette affaire, les requérants invoquaient le principe d’égalité sous ses deux facettes : l’interdiction de traiter différemment des situations analogues, reconnue par le droit français, et l’interdiction de traiter de façon identique des situations différentes, reconnue par le droit européen[35] mais niée par le droit français[36], sauf en matière fiscale[37]. Dans l’arrêt Arcelor, le Conseil d’Etat prend soin avant toute chose d’écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que des situations différentes n’auraient pas été traitées de façon différente, en rappelant que le principe constitutionnel français n’implique pas une obligation de traitement différent des situations différentes. Ce n’est qu’une fois ceci fait que le Conseil d’Etat recherche (avec succès) un équivalent européen au principe constitutionnel d’égalité, c’est-à-dire l’interdiction de traiter de façon différente des situations analogues.
Au final donc, l’hypothèse de la fragmentation dans la mise en œuvre des normes européennes et internationales sous l’effet des droits fondamentaux est dans un grand nombre de cas une hypothèse très largement théorique. Il reste cependant un domaine dans lequel cette fragmentation est une réalité lourde de menaces, dans la mesure où toutes les conditions en sont réunies (absence de marge d’appréciation, divergence de standards entre autorités de mise en œuvre et standards plus élevés au stade de la mise en œuvre qu’au stade de l’élaboration de la norme). Il s’agit de la question de la compatibilité entre, d’une part, la mise en œuvre des « sanctions ciblées » onusiennes et, d’autre part, les standards régionaux et nationaux de protection des droits fondamentaux.
II. Un risque avéré de fragmentation
concernant les sanctions ciblées onusiennes
Rappelons ici que les sanctions dites « ciblées »[38] sont des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité non pas contre des Etats mais contre des personnes privées. Ces sanctions sont de natures diverses mais impliquent le plus souvent des gels d’avoirs financiers, ainsi parfois que d’autres mesures comme des interdictions de séjour.
Or, la mise en œuvre de ces sanctions ciblées réunit toutes les conditions précédemment évoquées pour qu’existe un risque de fragmentation. D’une part, les sanctions ciblées sont nominatives et relativement précises quant aux mesures à prendre, ce qui laisse une faible marge d’appréciation aux autorités de mise en œuvre. D’autre part, ces dernières, en l’occurrence l’ensemble des 193 Etats membres de l’Organisation, ne sont bien évidemment pas toutes soumises aux mêmes standards en matière de protection des droits fondamentaux. Enfin, et peut-être même surtout, les standards de protection des droits fondamentaux au niveau de l’édiction de ces sanctions sont bien inférieurs à ceux en vigueur en Europe.
Ce dernier point mérite d’être étayé. Le système de sanctions ciblées est affecté de graves carences en termes de protection des droits fondamentaux. En particulier, la possibilité pour un individu de contester son inscription sur la liste des personnes ciblées par ces sanctions est loin d’être effective. Pendant longtemps, les intéressés devaient en effet demander à leur Etat de nationalité d’adresser au Comité des sanctions une demande de radiation pour ne plus être sur une liste de personnes destinataires d’une sanction ciblée. Certes, il est désormais possible pour toute personne ou entité de s’adresser directement au comité des sanctions en soumettant sa demande de radiation de la liste récapitulative au point dit « focal ». Néanmoins, la procédure devant ce comité demeure essentiellement de nature diplomatique et interétatique, et n’est pas assortie des garanties essentielles d’une procédure juridictionnelle. Pour le dire autrement, le standard de protection des droits fondamentaux dans le cadre du système onusien de sanctions ciblées est donc très faible, comme l’ont expressément constaté la Cour de justice dans l’arrêt Kadi I[39], réaffirmé sur ce point par l’arrêt Kadi II[40], et la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt Nada c. Suisse[41]. Or, on l’a vu, c’est le différentiel de standards entre l’échelon où la norme est émise et celui où elle est mise en œuvre qui peut générer la fragmentation.
Les problèmes de fragmentation peuvent donc ici se poser. Et ils peuvent même se poser en cascade puisque l’Union européenne, bien que non membre de l’Onu, met elle-même en œuvre les sanctions ciblées onusiennes, lesquelles peuvent ensuite nécessiter des mesures nationales de mise en œuvre. Dans une telle configuration, les résolutions onusiennes, puis leur mise en œuvre européenne, puis leurs mises en œuvre nationales, peuvent se trouver confrontées aux droits fondamentaux garantis par le droit de l’UE et à la Cedh et aux droits fondamentaux constitutionnels nationaux. Autant dire que tous les ingrédients sont réunis pour un imbroglio juridique de premier ordre.
Face à cette problématique, quelle a été la réaction des différentes juridictions concernées ? Alors que le Conseil d’Etat français a adopté une position quelque peu ambiguë (A), les juridictions européennes ont, plus ou moins ouvertement, décidé d’opposer leur conception des droits fondamentaux à la mise en œuvre des sanctions ciblées onusiennes, de sorte que, du point de vue de l’Onu, la mise en œuvre de ces sanctions sera fragmentée entre, d’une part, l’Europe et, d’autre part, le reste du monde (B).
A. La position ambiguë du Conseil d’Etat français
Au niveau interne français, il semble que le Conseil d’Etat ait résolument décidé… d’éviter le problème ! Et pour cela, il a eu recours à une antiquité que l’on aurait pu croire remisée au grenier de la jurisprudence administrative : la théorie des actes de gouvernement.
En effet, dans un arrêt Héli-Union du 29 décembre 1997[42], le Conseil d’Etat a estimé qu’un décret qui appliquait une résolution du Conseil de sécurité des Nations-Unies n’était « pas détachable de la conduite des relations internationales de la France ». Par conséquent, un tel décret échappe à tout contrôle juridictionnel. Puis, quelques années plus tard, dans un autre arrêt Héli-Union, mais cette fois du 12 mars 1999[43], le Conseil d’Etat a à nouveau utilisé la qualification d’acte de gouvernement, à propos cette fois des mesures individuelles prises sur le fondement du décret qui avait été attaqué dans l’arrêt précédent. Pour réutiliser la terminologie stipulative choisie dans le cadre de cette étude[44], cela signifie que l’applicabilisation et l’application individuelle des résolutions du Conseil de sécurité sont des actes de gouvernement.
Il est certain que cette solution, pour contestable qu’elle peut être, a au moins l’avantage d’éviter un hiatus entre la protection des droits fondamentaux et le respect des résolutions onusiennes – au détriment, il faut bien le noter, de la première. On se permettra cependant deux remarques ici.
D’une part, on peut trouver quelque peu étrange que les actes nationaux d’application des résolutions onusiennes bénéficient du « parapluie » de la théorie de l’acte de gouvernement, alors que les actes d’application du droit dérivé de l’UE n’en bénéficient pas. Sans insister sur ce point, qui n’est pas l’objet premier de cette communication, il est quand même possible de voir dans cette différence de traitement une manifestation de la spécificité du traitement juridique national du droit de l’Union par rapport au droit international. En l’occurrence, la spécificité découle peut-être du fait que le système européen est tellement intégré au système national qu’on ne peut plus vraiment l’appréhender comme un élément des « relations internationales » de l’Etat, au sens de la théorie des actes de gouvernement.
D’autre part, on le sait, la théorie des actes de gouvernement dans l’ordre international est susceptible de modulation dans son champ d’application lorsqu’un acte s’avère, en réalité, détachable de la conduite des relations internationales de la France. La théorie de la détachabilité a d’ailleurs précisément trouvé à s’appliquer en matière de mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité, dans un arrêt Association secours mondial de France du CE en date du 3 novembre 2004[45]. Dans cette affaire, l’association concernée attaquait un décret du 19 octobre 2002 qui la plaçait sur une liste de personnes et d’entités pour lesquelles « les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements financiers de toute nature entre la France et l’étranger » étaient soumis à autorisation préalable du ministre de l’Economie et des Finances. Or, huit mois auparavant avait été adoptée la résolution n° 1390 en date du 16 janvier 2002 par laquelle le Conseil de sécurité avait adopté des sanctions ciblées contre Ben Laden, Al-Qaeda, les Talibans et les personnes associées, ce dont était justement soupçonnée l’association en question. Il était tentant de faire le lien entre les deux, et c’est notamment ce qu’a fait le Gouvernement, invoquant la qualification d’acte de gouvernement eu égard aux précédents Héli-Union. Or, le Conseil d’Etat n’a pas suivi le Gouvernement. Et pour écarter la qualification d’acte de gouvernement, il a estimé que « le décret attaqué ne se born[ait] pas, contrairement à ce que soutient le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, à tirer les conséquences d’une résolution du conseil de sécurité des Nations-Unies ». La formule est évidemment intéressante car elle semble faire directement écho à la logique de marge d’appréciation que l’on a évoquée précédemment. Si l’on s’en tenait à cette affirmation, on pourrait arriver à la conclusion que la confrontation entre droits fondamentaux et résolutions du Conseil de sécurité est efficacement évitée. De deux choses l’une en effet : soit l’acte national se borne à tirer, sans marge d’appréciation, les conséquences de la résolution, et dans ce cas-là c’est un acte de gouvernement inattaquable, soit ce n’est pas le cas, mais dans ce cas la censure de l’acte national n’a pas de réelle répercussion sur la résolution elle-même, comme on l’a vu précédemment.
Cette architecture est intellectuellement séduisante. Mais il faut cependant regarder plus attentivement l’arrêt Association secours mondial de France pour y lire les raisons circonstanciées de la solution. Le Conseil d’Etat précise en effet que c’est « eu égard à [la] date de publication [du décret] et en tout état de cause » qu’il est possible d’affirmer que le décret ne se borne pas à appliquer la résolution. Cet argument de date renvoie au fait que, si la résolution sur les sanctions ciblées contre Al Qaeda avait été adoptée huit mois avant le décret litigieux, l’inscription de l’association elle-même sur la liste onusienne des personnes visées est quant à elle postérieure, de trois jours, à la date du décret visé. Par conséquent, à la date où il a été adopté, le décret ne pouvait passer pour une application pure et simple de la résolution puisque, à ce moment-là, l’association requérante n’était pas visée. Cet argument est compatible avec la logique de marge d’appréciation : à la date du décret, placer une association requérante sous « surveillance financière » alors qu’elle n’est pas listée relevait indéniablement de l’exercice, par l’Etat français, de sa marge d’appréciation.
Reste l’emploi de la formule « en tout état de cause », qui a toujours de quoi laisser perplexe l’observateur tentant de déterminer la teneur et la portée des raisonnements élaborés par les juges du Palais Royal. Cette formule est cependant éclairée ici par Francis Donnat[46], qui était commissaire de gouvernement dans cette affaire, et qui indique que « malgré son origine et le contexte dans lequel il s’insère, [l’objet de la mesure] est en effet entièrement tourné vers l’ordre interne ». D’ailleurs, le Conseil d’Etat précise bien que le décret litigieux « doit être regardé comme une mesure de police détachable de la conduite des relations internationales de la France ». La base juridique du décret était en effet l’article L151-2 du code monétaire et financier, selon lequel « le Gouvernement, peut pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie : / 1 Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle : / a) Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l’étranger ; / b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l’étranger ; c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France ; d) L’importation et l’exportation de l’or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la France et l’étranger ». La situation était donc bien différente de celle de l’arrêt Héli-Union, où il s’agissait cette fois d’une mesure d’embargo contre la Lybie, c’est-à-dire d’une mesure dont la nature même la rattache très nettement aux relations internationales de la France.
Le problème c’est que, précisément, les sanctions ciblées onusiennes prennent souvent la forme de mesures restrictives quant aux mouvements financiers. Il est par conséquent difficile d’interpréter l’arrêt Association secours mondial de France. Signifie-t-il que les mesures d’application d’une résolution onusienne seront attaquables dès lors qu’elles peuvent être rattachées à un pouvoir de police ? Si tel est le cas, étant donné précisément la nature des sanctions ciblées, cela risque d’être souvent le cas. Par ailleurs, la théorie des actes de gouvernement étant une exception au droit au recours et à l’Etat de droit, elle doit être d’interprétation stricte, ce qui justifierait également cette solution. Il en résulte par conséquent que, du point de vue en tout cas du juge administratif français, le risque d’une confrontation entre droits fondamentaux et sanctions ciblées demeure, même s’il est nimbé d’incertitude.
Au niveau des juridictions européennes en revanche, la solution est plus claire – encore qu’entourée d’une certaine hypocrisie en ce qui concerne la Cour européenne des droits de l’homme. Très nettement, les juridictions européennes estiment que les standards européens de protection des droits fondamentaux sont effectivement susceptibles d’entraver – et partant, du point de vue de l’Onu, de fragmenter – la mise en œuvre des sanctions ciblées onusiennes.
B. La prévalence des droits fondamentaux
dans la jurisprudence des juridictions européennes
Au niveau des juridictions européennes, les juridictions de l’Union européenne ont été les premières à se positionner sur ce point. Il n’est pas nécessaire de rappeler ici dans le détail les tumultueux soubresauts de l’affaire Kadi, qui a vu s’opposer le Tribunal de l’Union européenne (à l’époque Tribunal de première instance des Communautés européennes) et la Cour de justice. Tout au plus rappellera-t-on que le premier[47] avait conclu à une immunité juridictionnelle des actes de droit de l’Union mettant en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. On peut faire ici un parallèle intéressant avec la solution adoptée par le Conseil d’Etat, que l’on a déjà évoquée. Mais ce parallèle ne peut être que superficiel : le Conseil d’Etat se fonde globalement sur « les relations internationales » dans le cadre de sa théorie des actes de gouvernement, alors que le Tribunal développe quant à lui une argumentation spécifiquement fondée sur le droit onusien et la primauté de la Charte des Nations Unies. En outre, il faut relever que l’immunité juridictionnelle accordée par le Tribunal n’était pas absolue puisqu’il réservait l’hypothèse dans laquelle la résolution elle-même serait incompatible avec le toujours mystérieux jus cogens.
A l’inverse, la Cour de justice[48] a quant à elle adopté sans complexe une solution nettement dualiste en affirmant que, en raison de l’importance constitutionnelle de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union, il était impossible d’accorder une quelconque immunité juridictionnelle aux règlements européens qui mettent en œuvre les sanctions ciblées onusiennes. La Cour prend d’ailleurs expressément argument, sur ce point, du fait que la procédure devant le comité des sanctions « n’offre manifestement pas les garanties d’une protection juridictionnelle ».
Il est peut-être moins connu que la Cour européenne des droits de l’homme a elle aussi apporté sa voix au chapitre, dans l’arrêt Nada c. Suisse du 12 septembre 2012, déjà évoqué. Dans cette affaire, le requérant M. Nada, de nationalités italienne et égyptienne, résidait à Campione d’Italia, enclave italienne entourée par le canton suisse du Tessin et séparée du reste du territoire italien par le Lac de Lugano. En 2001, M. Nada fut inscrit sur la liste onusienne des personnes soupçonnées d’être liées à Al-Qaïda et à Oussama Ben Laden, et soumises à ce titre aux sanctions dites « ciblées ». L’une de ces sanctions, ajoutée en 2002, était l’interdiction d’entrée et de transit sur le territoire des Etats destinataires, à l’exception des Etats dont les personnes visées ont la nationalité. La Suisse ayant adopté les mesures internes nécessaires à la mise en œuvre des résolutions onusiennes, elle a interdit l’entrée et le transit de M. Nada sur le territoire helvétique. Et de ce fait, le requérant fut donc de facto « prisonnier » de l’enclave de Campione d’Italia jusqu’à sa radiation de la liste en 2009.
La Cour européenne des droits de l’homme fut saisie d’un recours contre la Suisse. Il faut relever que ce n’était pas tout à fait la première fois qu’un Etat était attaqué à Strasbourg en raison d’une mise en œuvre d’une résolution onusienne. En effet, c’était déjà le cas dans la célèbre affaire Bosphorus, puisqu’il s’agissait dans cette affaire de la mise en œuvre de sanctions onusiennes dirigées contre la République fédérative de Yougoslavie. Mais dans l’affaire Bosphorus, ces sanctions avaient d’abord été mises en œuvre par la Communauté européenne avant d’être exécutées au niveau national : l’échelon communautaire avait donc en quelque sorte fait écran. Ce n’était pas le cas en l’espèce, et l’on pouvait donc se demander si la Cour de Strasbourg allait reprendre les prémisses logiques de son raisonnement Bosphorus en l’appliquant cette fois aux Nations Unies. Or, la réponse à cette interrogation dans l’arrêt Nada est, en réalité, plutôt mitigée.
Il faut rappeler que le raisonnement Bosphorus est un raisonnement en trois étapes. Première étape : l’Etat a-t-il appliqué sans marge d’appréciation une obligation découlant de l’appartenance à une obligation internationale ? Si l’Etat dispose d’une marge d’appréciation, il demeure pleinement responsable des violations de la Cedh qu’il commet en appliquant ladite obligation. S’il n’a pas de marge d’appréciation, la Cour passe alors à la deuxième étape, à savoir : cette organisation internationale garantit-elle une protection des droits fondamentaux qui soit globalement équivalente à celle offerte par la Convention ? Si ce n’est pas le cas, l’Etat reste pleinement responsable. S’il y a une protection équivalente, la Cour passe enfin à la troisième étape : y a-t-il eu en l’espèce une insuffisance manifeste de cette protection assurée par l’organisation internationale ? Si oui, l’Etat est responsable. S’il n’y a pas eu d’insuffisance manifeste, l’ingérence par l’Etat à un droit protégé par la Convention est considérée comme justifiée.
Or, dans l’affaire Nada, la Cour s’arrête à la première étape : elle considère que la Suisse disposait d’une marge d’appréciation dans la mise en œuvre des sanctions onusiennes, et que par conséquent les violations commises la Cedh lui sont totalement imputables. Et elle conclut à la violation.
Sur le papier, ce raisonnement semble parfaitement orthodoxe. On peut être déçu que la Cour ne se soit pas prononcée sur la question fondamentale du niveau de protection des droits fondamentaux dans le système de sanctions ciblées, mais on peut se dire qu’il ne s’agit là que d’une occasion manquée, due à l’existence de cette marge d’appréciation.
Le problème est que cette marge d’appréciation que mentionne la Cour est en réalité parfaitement chimérique. Comme l’ont relevé plusieurs juges dans leurs opinions concordantes[49], la Suisse n’a fait qu’exécuter strictement, sans marge d’appréciation, l’obligation découlant des résolutions onusiennes d’interdire sur son territoire l’entrée et le transit des personnes mentionnées dans la liste et qui n’ont pas la nationalité suisse. Il apparaît donc qu’en réalité, la Cour n’a précisément pas voulu se prononcer sur le niveau de protection des droits fondamentaux dans le système onusien. Ce refus semble découler, d’une part, d’une certaine déférence pour la mission de l’Onu, le maintien de la paix, et, d’autre part, d’une volonté de contourner la question sensible de la primauté de la Charte des Nations Unies sur les autres obligations conventionnelles des Etats – y compris donc la Cedh.
La Cour a donc apparemment trouvé une solution de compromis, qui permet d’assurer l’effectivité de la Cedh sans se heurter frontalement à la Charte des NU : il aura suffi d’imputer à la Suisse la violation des droits fondamentaux de M. Nada dont, en réalité, l’Onu était responsable. Mais en réalité, derrière la diplomatie et le self-restraint de façade, l’arrêt Nada aboutit bien, in fine mais in petto, à contrôler et à censurer indirectement la norme onusienne.
En conclusion, l’hypothèse d’une fragmentation préjudiciable de la mise en œuvre des normes européennes et internationales en raison des droits fondamentaux est très largement une hypothèse d’école. En effet, dans la plupart des cas, la proximité des standards et l’existence d’une marge d’appréciation dans la mise en œuvre feront que la fragmentation, si elle existe, sera ponctuelle et sans grande incidence sur l’effectivité et l’homogénéité d’application du droit international et du droit européen. Reste cependant une hypothèse véritablement problématique, c’est celle de la mise en œuvre des sanctions ciblées onusiennes. Ici, les lacunes du système onusien en matière de protection des droits fondamentaux exposent ces sanctions à un risque de fragmentation mettant en danger leur effectivité, en raison de l’interposition des standards régionaux et nationaux de protection des droits fondamentaux. Il faut donc espérer que l’Onu saura, comme elle a déjà commencé à la faire, prendre en compte la réalité de cette menace en augmentant encore les garanties des droits fondamentaux dans le cadre de la procédure de sanctions ciblées.
[1] Cf. notamment, pour une étude récente : Bonnet B., Repenser les rapports entre ordres juridiques, Paris, Lextenso, 2013.
[2] Pour reprendre le terme utilisé par J. Porta dans sa thèse : La réalisation du droit communautaire. Essai sur le gouvernement juridique de la diversité, Paris, Lgdj, 2008.
[3] Cf. not. Kovar R., « Le droit national d’exécution du droit communautaire : essai d’une théorie de « l’écran communautaire » », in L’Europe et le droit : mélanges en hommage à Jean Boulouis, Paris, Dalloz, 1991, p. 341 ; Gautier Y., « L’Etat membre et l’exécution du droit communautaire », in Duprat G. (dir.), L’Union européenne. Droit, politique, démocratie, Paris, Puf, 1996, p. 39 ; Mehdi R., « L’exécution nationale du droit communautaire. Essai d’actualisation d’un problématique au cœur des rapports des systèmes », in 50 ans de droit communautaire, Mélanges en l’honneur de Guy Isaac, Toulouse, Presses de l’université des sciences sociales de Toulouse, 2004, p. 623 ; Nabli B., L’exercice des fonctions d’Etat membre de la Communauté européenne : étude de la participation des organes étatiques à la production et à l’exécution du droit communautaire. Le cas français, Paris, Dalloz, 2007 ; Dutheil de la Rochère J. (dir.), L’exécution du droit de l’Union, entre mécanismes communautaires et droits nationaux, Bruxelles, Bruylant, 2009.
[4] Cjce, 24 oct. 1989, Commission c. Conseil, aff. 16/88, point 11.
[5] Cf. en ce sens Gautier Y., article précité, spéc. p. 41.
[6] Auby J.-M., « Le pouvoir réglementaire des autorités des collectivités locales : à propos d’une controverse récente », Ajda 1984, p. 470.
[7] Venezia J.-C., « Les mesures d’application », in Mélanges René Chapus : droit administratif, Paris, Montchrestien, 1992, p. 674.
[8] Ibid., p. 676.
[9] Cjue, 21 décembre 2011, N. S. et M. E., aff. jtes C-411/10 et C-493/10.
[10] Cjce, 18 juin 1991, Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE (ERT), aff. C-260/89.
[11] Azoulai L., « Pour un droit de l’exécution de l’Union européenne », in Dutheil de la Rochère J. (dir.), L’exécution du droit de l’Union, entre mécanismes communautaires et droits nationaux, op. cit., p. 1, spécialement p. 10.
[12] Cf. supra.
[13] Cf. supra.
[14] Cjce, 21 septembre 1989, Commission c. Grèce, aff. 68/88, point 24.
[15] Ccf, 29 mai 1974, BVerfGE 37, 271 dit Solange I ; Ccf, 22 oct. 1986, BVerfGE 73, 339, dit Solange II et Ccf, 7 juin 2000, BVerfGE 102, 147, dit Solange III.
[16] CE, Ass., 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine e. a., concl. Guyomar, Rec., p. 55.
[17] Cour Edh, 30 juin 2006, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlande, Rec. 2005-VI.
[18] Cjce, 3 sept. 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation c. Conseil et Commission, aff. C-402/05 P et C-415/05 P.
[19] CC, n°2004-496 DC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique.
[20] Cf. art. 291§1 Tfue : « Les Etats membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union ».
[21] Jurisprudence Solange I précitée.
[22] Jurisprudences Solange II et Solange III, précitées.
[23] Cf. supra introduction.
[24] CC, 2006-540 DC, 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.
[25] CE, 30 juillet 2003, Association Avenir de la langue française, Rec. p. 347.
[26] Ccf, 13 mars 2007, BVerfGE, 118, 79. Cette décision a été comparée à la jurisprudence Arcelor du Conseil d’Etat français : cf. not. Mayer F. C., Lenski E., Wendel M., « Der Vorrang des Europarechts in Frankreich – zugleich Anmerkung zur Entscheidung des französischen Conseil d’Etat vom 8 Februar. 2007 (Arcelor u.a.) », EuR, 2008, I, p. 63, spéc. p. 82.
[27] Ccf, 4 octobre 2011, BVerfG, 1 BvL 3/08.
[28] Cour Edh, arrêt Bosphorus précité.
[29] Cjue, 26 février 2013, Melloni, aff. C-399/11, point 60.
[30] Cf. arrêts E.R.T. et N.S., précités.
[31] Cour Edh, 6 déc. 2012, Michaud c. France, req. n° 12323/11
[32] L’Union européenne a adopté successivement trois directives visant à prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux. La première (91/308/CEE ; 10 juin 1991) vise les établissements et institutions financières. Elle a été amendée par une directive du 4 décembre 2001 (2001/97/CE) qui, notamment, élargit son champ d’application à divers professionnels ne relevant pas du secteur financier, dont les « membres des professions juridiques indépendantes ». La troisième (2005/60/CE ; 26 octobre 2005) abroge la directive du 10 juin 1991 amendée, en reprend le contenu et le complète.
[33] Arrêt précité.
[34] Cjce, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH, aff. 11-70.
[35] En droit de l’UE, cf. not. Cjce, 17 juillet 1963, Italie c. Commission, aff. 13/63 ; Cjce, 17 juillet 1997, National Farmers’ Union e. a., aff. C-354/95, point 61 ; Cjce, 30 juin 1998, Brown, aff. C-394/96, points 31 et 32 ; Cjce, 2 octobre 2003, Garcia Avello c. Etat belge, aff. C-148/02, points 31 s. En droit de la Cedh, cf. Cour Edh, 6 avril 2000, Thlimmenos, Rec. 2000-IV, point 48.
[36] CC, n°87-232 DC, 7 janvier 1988, Loi relative à la mutualisation de la Caisse nationale de Crédit agricole, cons. 10 ; CE, Ass., 28 mars 1997, Société Baxter e. a. Rec. p. 114.
[37] CC, n°2000-437 DC, 19 décembre 2000, Loi de financement pour la sécurité sociale.
[38] Sur cette question, cf. not. Balmond L., Grewe C. et Rideau J. (dir.), Sanctions ciblées et protections juridictionnelles des droits fondamentaux dans l’Union européenne : équilibres et déséquilibres de la balance ; Bruxelles, Bruylant ; 2010.
[39] Précité.
[40] Cjue, grande chambre, 18 juillet 2013, Commission c. Kadi, aff. C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, point 133 : « en dépit des améliorations qui leur ont été apportées, notamment, après l’adoption du règlement litigieux, les procédures de radiation et de révision d’office instituées au niveau de l’Onu n’offrent pas à la personne dont le nom est inscrit sur la liste récapitulative du comité des sanctions et, subséquemment, sur la liste figurant à l’annexe I du règlement n° 881/2002, les garanties d’une protection juridictionnelle effective ».
[41] Cour Edh, grande chambre, 12 septembre 2012, Nada c. Suisse, req. n° 10593/08, point 211.
[42] Req. n° 138310.
[43] Req. n° 162131.
[44] Cf. supra introduction.
[45] Req. n° 262626.
[46] Droit Administratif n° 12, décembre 2004, comm. 177.
[47] TPICE, 21 septembre 2005, Kadi c. Conseil et Commission, aff. T-315/01.
[48] Arrêt Kadi I, précité.
[49] Cf. not. L’opinion concordante des juges Bratza, Nicolaou et Yudkivska et celle du juge Malinverni.
À propos de l’auteur