Voici la 38e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 5e livre de nos Editions dans la collection « Académique » :

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :
Volume V :
Le(s) droit(s) selon & avec
Jean-Arnaud Mazères
Ouvrage collectif
(Direction Mathieu Touzeil-Divina
Delphine Espagno, Isabelle Poirot-Mazères
& Julia Schmitz)
– Nombre de pages : 220
– Sortie : novembre 2016
– Prix : 49 €
- ISBN / EAN : 979-10-92684-19-3 / 9791092684193
- ISSN : 2262-8630
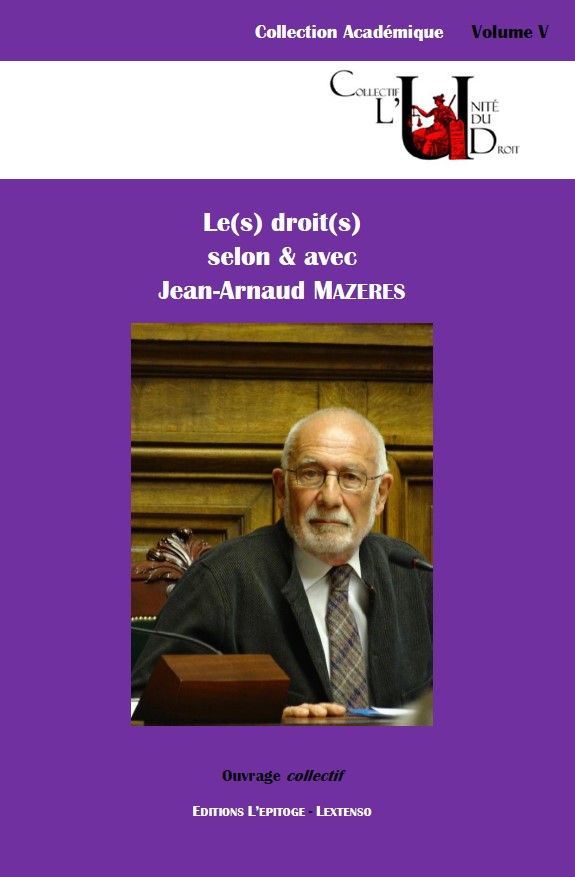
Présentation :
Un professeur, un maître, un père, un ami, un guide, un modèle, un inspirateur, un trouvère et, à toutes les pages, un regard. Tous ces qualificatifs pour un seul homme, un de ces êtres doués pour le langage, le partage, l’envie de transmettre, le goût de la recherche et de l’analyse, l’amour des livres et de la musique, l’attention aussi aux inquiets et aux fragiles. La générosité de Jean-Arnaud, l’homme aux mille facettes, est aujourd’hui célébrée, à travers le regard de ses amis. Tous ceux qui ont contribué à cet ouvrage ont quelque chose à dire, à écrire, à expliquer aussi, de ce moment où leur trajectoire a été plus claire, parfois s’est infléchie lors d’un cours ou d’un entretien, où leurs doutes ont rencontré non des réponses mais des chemins pour tenter d’y répondre. Chacun a suivi sa voie, chacun aujourd’hui a retrouvé les autres. Cet ouvrage est pour toi Jean-Arnaud ! Cela dit, si tu ne t’appelles pas Jean-Arnaud, toi – lecteur – qui nous tient entre tes mains, tu peux aussi t’intéresser non seulement au professeur Jean-Arnaud Mazères mais encore t’associer aux hommages et aux témoignages qui lui sont ici rendus. L’ouvrage, qui se distingue des Mélanges académiques, est une marque de respect et d’affection que nous souhaitons tous offrir à son dédicataire et ce, pour ses quatre-vingt ans. L’opus est alors bien un témoignage : celui de celles et de ceux qui ont eu la chance un jour de rencontrer le maestro, de partager les moments plus ou moins délicats du passage de l’innocence estudiantine à celui de la vie d’adulte, voire de faire une partie de ce chemin à ses côtés comme collègue et / ou comme ami. Des vies différentes pour chacun d’entre nous, des choix que le professeur Mazères a souvent directement inspirés, influencés, compris, soutenus mais pour nous tous ce bien commun partagé : celui d’avoir été, et d’être toujours, son élève, son ami, son contradicteur parfois. Par ce « cadeau-livre », nous souhaitons faire part de notre affection, du respect et de l’amitié que nous avons à son égard. Bel anniversaire, Monsieur le professeur Jean-Arnaud Mazères !
Ont participé à cet ouvrage (qui a reçu le soutien de Mme Carthe-Mazeres, des professeurs Barbieri, Chevallier, Douchez, Février, Lavialle & Mouton) : Christophe Alonso, Xavier Barella, Jean-Pierre Bel, Xavier Bioy, Delphine Costa, Abdoulaye Coulibaly, Mathieu Doat, Arnaud Duranthon, Delphine Espagno-Abadie, Caroline Foulquier-Expert, Jean-François Giacuzzo, Philippe Jean, Jiangyuan Jiang, Jean-Charles Jobart, Valérie Larrosa, Florian Linditch, Hussein Makki, Wanda Mastor, Eric Millard, Laure Ortiz, Isabelle Poirot-Mazères, Laurent Quessette, Julia Schmitz, Philippe Segur, Bernard Stirn, Sophie Theron & Mathieu Touzeil-Divina.
Ouvrage publié par le Collectif L’Unité du Droit avec le concours de l’Académie de Législation de Toulouse, du Centre de Recherches Administratives (ea 893) de l’Université d’Aix-Marseille et avec le soutien et la complicité de nombreux amis, anciens collègues, étudiants, disciples…
Libres propos
sur les prétendues « Ecoles »
en droit (et un peu en science politique…)
Eric Millard
Professeur de droit public
à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Lorsque j’ai rencontré Jean-Arnaud Mazeres (le Jam, comme affectueusement nous le nommions, prononcé djame, comme les mods londoniens qui constituaient davantage la bande son de nos nuits toulousaines que le Schubert qu’il affectionnait), j’étais un étudiant qui apprenait le droit depuis plusieurs années et qui se demandait comment on pouvait perdre autant de temps à apprendre des choses si peu pourvues d’intérêt. Le droit, tel qu’il était enseigné à peu près uniformément au début des années 80 du siècle dernier dans une université française était juste un non sens, au vrai sens du terme. Cela tombait bien car le Jam sous couvert de science administrative tenait un discours critique qui semblait partir d’à peu près le même constat : désert épistémologique, absence d’outils critiques, hermétisme à toute question politique ou sociale sous couvert de technicité. Ce n’est pas peu dire que ses enseignements de science administrative, puis plus tard de droit administratif en Dea m’ont sinon réconcilié avec la matière (à l’impossible nul n’est tenu) du moins incité à creuser pour voir par où et comment saper cette dogmatique juridique. Plus tard bien sûr, nos discussions pendant ma thèse, d’autres rencontres, et un peu mon travail personnel ont permis de construire la posture qui est désormais la mienne. Mais cette rencontre fut décisive, et essentielle.
Philosophie politique, et philosophie des sciences ; sciences juridiques comme sciences sociales ; toutes les questions qui peuvent nourrir une approche un peu distanciée et critique du droit, au nom de l’externalité de la description, ou de l’analyse politique ; toutes les choses que pompeusement on nommait pluridisciplinarité, lorsque le cursus juridique se paraît d’ouverture : méthodes des sciences sociales, sociologie, etc., qui au mieux étaient sérieusement faites et donc n’abordaient guère la question juridique, au pire était un saupoudrage apparemment savant que la dogmatique mobilisait au profit d’une légitimation de son approche conservatrice. Et voilà qu’en science administrative, version Jam, ces questions se confrontaient au droit, à l’Etat, à l’administration, et à bien d’autres choses encore…
La création du Laboratoire des Sciences Sociales du Politique quelques quinze années plus tard, au sein de l’Iep de Toulouse, et autour notamment, côté juristes du moins, d’anciens élèves du Jam, entendait répondre à, outre des questions institutionnelles et biographiques contingentes mais qu’il serait vain de taire, l’idée que des juristes et des spécialistes de science politique, appelés à travailler en commun au sein d’un Institut d’Etudes Politiques, pouvaient et devaient échanger sur leurs objets de recherche, leurs méthodes d’investigation, et que de ces échanges pouvait se dégager une forme de savoir nécessaire : inscrire épistémologiquement la recherche en droit et en sciences politiques dans une conception des sciences sociales dans laquelle le mot sciences n’est pas simplement esthétique ou légitimant. Et cela malgré une histoire de ces disciplines pour le moins compliquée, qui a provoqué une ignorance mutuelle assez radicalisée, et une méfiance.
Il ne m’appartient pas d’évaluer si cette idée avait quelque intérêt, ou si elle a trouvé quelque justification dans l’action et dans les résultats. Je le crois mais je n’entends pas le réaffirmer ni ne peux le démontrer. Je ne suis en vérité pas à l’origine de cette démarche commune : ma route a croisé (avec un plaisir que je ne dissimulerai pas, en raison des amitiés personnelles qui en sont à l’origine) quelques temps celle du Lassp, mais si évidemment le projet dont je viens de tracer à la serpe les contours ne pouvait que me séduire, et faisait écho à ces enseignements que j’ai précédemment évoqués, ce moment partagé ne tenait, comme souvent dans l’université, pas réellement au projet mais une fois de plus à des contingences bureaucratiques, et à des intérêts (institutionnels) communs.
En confrontant ces deux expériences, comme étudiant du Jam, comme chercheur au moment de la mise en forme du Lassp, je réalise que ce que j’ai intuitivement perçu dès le départ au Lassp, et dans d’autres instances dans lesquelles la pluridisciplinarité (à considérer qu’il s’agisse réellement de disciplines, droit et science politique) se trouve de fait convoquée, comme difficulté pratique première, ne me semble toujours pas clarifié, ni même clarifiable : quelle posture adopter pour parler de droit à la fois à des juristes et des politistes, qui échappe aux représentations a priori que s’en font les uns et les autres ? La définition même de l’objet dont je veux parler, qui ici s’étale sur plusieurs années, avec des contacts irréguliers avec plusieurs amis, en témoigne. Je vois que je suis passé, sans que je ne sache trop comment ni pourquoi, d’une lecture de ce que les juristes ont (ou pas) en commun et qui ferait discipline, à la question des écoles et des courants en droit, inscrite dans une réflexion plus large sur la manière de faire preuve en droit et science politique. Il y a dans ce glissement ce que je conçois comme malentendu fondamental, conscient ou non, construit ou non, volontaire ou non, qui ramène les juristes au droit (et réciproquement), et qui établit une frontière stricte entre le regard externe et critique, et l’objet conçu comme discipline, confondu avec le corps disciplinaire. Ce qui justement me faisait fuir lors de mes études, et dont je voyais l’approche du Jam comme réfutation. Là où je voulais poser une question épistémologique : est-ce que le droit fait l’objet d’une construction comme objet de savoir des (et par des) juristes (entendus ici de manière déjà obscure au sens de ceux qui connaissent le droit), supposant une épistémologie minimale commune (et la question ne présuppose pas de réponse positive) ?, apparaît une autre question : quels sont les processus de construction des lieux de pouvoir dans la discipline, et de l’évaluation/validation des discours de connaissance qui y sont produits (une question épistémologique clairement reformulée dans une question des sciences du politique). Ce glissement révèle déjà une difficulté (non une aporie, mais une difficulté) du projet initial : de la présupposée revendication commune d’une épistémologie des sciences sociales dans laquelle s’inscrirait droit et science politique, on passe à la double réduction du droit à un objet et de la science politique à un savoir (critique monopolistique).
Deux stratégies de réaction sont alors envisageables face à cette délimitation du débat, au moins. Je dirais de la première qu’elle est quelque peu épidermique, corporatiste et à proprement parler réactionnaire ; de la seconde qu’elle est offensive et prospective. Il n’y a guère à s’étonner que la première soit plus répandue, plus aisée à mobiliser, mais qu’en même temps elle contienne les éléments pour figer le débat, pour conforter les représentations a priori, et donc pour finalement transformer la difficulté initiale d’un projet du type Lasspien en aporie ; et que la seconde puisse paraître assez utopique tant elle présume un aggiornamento partagé, qui ne paraît guère (actuellement ?) envisageable.
Réaction : Nous les juristes… sommes légitimes à revendiquer une autonomie de nos savoirs.
Prospection : Il n’y a ni juristes ni politistes… dès lors qu’est en jeu la question de l’épistémologie des sciences sociales, au moins sur l’objet droit.
Dans une version préparatoire aux rencontres autour du dixième anniversaire du Lassp, et à partir de laquelle ces lignes ont été conçues, les organisateurs écrivaient : « Certains concepts sont partagés par les disciplines mais restent partiellement indéterminés du fait même de ce nomadisme. De même, certains auteurs et certaines écoles de pensée offrent des cadres d’analyse qui, à défaut d’être pluridisciplinaires peuvent cependant être appropriés et mobilisés mais différemment par plusieurs disciplines des Shs. Car lorsqu’un auteur, un article de référence… sont partagés, ils sont alors généralement lus différemment. Comment dès lors œuvrer à plus d’interdisciplinarité sans velléité hégémonique d’une discipline ou d’une autre ? ». Davantage qu’une réponse dès lors aux questions que j’envisageais ou que l’équipe du Lassp attendait, c’est par rapport à cette forme de problématique que je voudrais me situer, en assumant une forme de libres propos et de subjectivité.
Ecoles, courants, droit, juristes : l’imprécision des mots rendrait en effet ces questions, sans plus de clarification, totalement secondaires. Et si on parvenait à les clarifier, il est probable qu’on les rendrait en grande partie superflues.
Juristes : on se sert communément de ce mot pour désigner au moins deux groupes de personnes, qui ne se superposent pas nécessairement, mais qui ne se séparent pas aisément. Or cette contingence est doublement niée, tant par une revendication d’une autonomie des savoirs des juristes, que par une confusion des juristes et de leur objet.
Pour reprendre une idée assez fondée, on peut parler de droit dès lors qu’apparaît un corps professionnalisé (les juristes) qui développe une méthode spécialisée (un savoir-faire, qui est aussi un discours : une forme d’argumentation, de justification et de décision notamment) avec une certaine effectivité (voir notamment Aldo Schiavone, Ius : L’invention du droit en Occident, Belin, 2009). Le droit est une pratique sociale, et toute autre conception ontologique de l’objet me paraît devoir être repoussée.
Les juristes sont donc, dans ce sens le plus commun, ceux qui participent à cette pratique, qui la mettent en œuvre avec des effets symboliques et des effets matériellement très concrets ; ceux donc qui la produisent, mais également la reproduisent : très simplement les professions que l’on dit juridiques (avocats, juges, consultants, etc.). Bien : il est clair qu’il y a ici une autonomie du savoir (comme savoir-faire méthodologique) comme condition même de la constitution de la pratique, et en même temps une superposition totale entre les juristes et le droit. Connaître le droit, c’est connaître les activités des juristes, qui ne sont pas quant à elles des activités de connaissance.
Mais dans un second sens largement aussi commun, on appelle juristes ceux qui fréquentent les lieux universitaires, au sens large, d’enseignement du droit et de recherche (étudiants – futurs juristes – mais aussi enseignants et chercheurs – qui peuvent aussi être juristes dans le premier sens, praticiens). A l’évidence, l’autonomie universitaire du droit se justifie d’abord par l’idée de formation à cette pratique des juristes, donc à l’acquisition des savoirs-faire méthodologiques ; et participe de la reproduction/légitimation de celle-ci (ce qui n’exclut pas une auto-critique et des propositions d’évolution). Cependant, la logique de cette autonomie comme transmission du savoir-faire n’est que rarement assumée totalement. Il y a le plus souvent une revendication supplémentaire ou concurrente à la constitution d’un savoir comme connaissance, qui constituerait la science juridique ou la science du droit comme discipline doublement autonome : à l’égard d’un objet dont elle se séparerait, et à l’égard d’autres formes de connaissance existantes de la pratique sociale appelée droit (sociologie, histoire, etc.). Il demeure toutefois que cette revendication est rarement totale, et qu’il s’agit davantage de l’idée d’un recul critique sur un savoir-faire (une forme de regard interne critique) que d’une réelle revendication d’externalité, ce que l’auto-qualification des juristes universitaires comme juristes démontre en partie. Il demeure encore que les conditions de possibilité de constitution d’un savoir connaissance ne sont guère partagées, entre scientificité du raisonnement juridique lui-même (l’idée d’une science normative pratique : l’objectivisation de la pratique) et scientificité de l’étude du droit (la construction de cette pratique comme objet d’une connaissance critique, empirique, dans l’analyse logico-linguistique notamment).
Si l’on peut ainsi séparer analytiquement deux conceptions de l’autonomie universitaire du droit, aux conséquences opposées (l’assimilation dans la pratique sociale du droit, et la limitation du savoir à un savoir-faire méthodologique qu’il faut transmettre et reproduire d’un côté ; et d’un autre côté la revendication d’un savoir-connaissance qui peut aller jusqu’à la revendication d’une distinction radicale avec la pratique sociale droit), l’investigation empirique convainc qu’aucune généralisation n’est possible en faveur de l’une ou l’autre de ces revendications, ni même en faveur d’une opposition radicale de ces revendications. C’est là la contingence que je mettais en avant. L’essentiel de l’activité universitaire (enseignement et recherche) des juristes oscille entre reproduction distanciée de la pratique et distanciation limitée, dont résulte ce qu’Antoine Jeammaud nomme très justement l’activité dogmatico-doctrinale (par exemple dans La part de la recherche dans l’enseignement du droit, Jurisprudence Revue Critique, Tome 1, 2010) et Riccardo Guastini la construction juridique des juristes académiques (par exemple dans « Le réalisme juridique redéfini », Droit Prospectif, 2013-3, p. 1123 et s.).
Ecoles : là encore, le mot renvoie à des questions très différentes, d’inégale importance à mes yeux.
Au sens le plus évident, une Ecole est un processus (lieu ou groupe) de transmission de savoirs ou de méthodes, d’une certaine manière. Il ne fait aucun doute que l’enseignement du droit, au sens large, constitue une école et c’est bien pour cela qu’il participe de la construction et reproduction de la pratique sociale appelée droit. Toutefois cela est banal, et parler ici d’école ne nous apprend rien, notamment parce que cette « certaine manière » ne peut être caractérisée qu’a minima, et ne s’inscrit pas dans un processus concurrentiel : s’il peut y avoir localement quelques différences (surestimées : la place de la théorie, l’enseignement clinique, l’internationalisation, etc.), elles demeurent minimes du fait de la massification des études de droit, de l’acceptation largement majoritaire du rôle de l’enseignement du droit dans la formation des juristes (que les différences ne remettent pas en cause) et de leur localisation qui reste fondamentalement dans un cadre national malgré la prétendue autonomie des universités et la supposée globalisation du droit.
Ensuite, dans ce que je crois être le sens le plus directement attendu ici, il s’agit en parlant d’Ecole de la question des réseaux pour l’obtention d’un capital symbolique et professionnel : les carrières universitaires (Cnu, Comités de sélection, Jurys d’agrégation, etc.), l’accès aux revues, aux instances d’évaluation ou de répartition de moyens, etc. Loin de moi l’idée de dire que il n’y a pas en ce sens « d’écoles » en droit : mais le montrer et le démontrer est une démarche de sociologie du monde universitaire au sens large, et je doute qu’il y ait ici une spécificité radicale de la discipline des juristes. Et s’il y a spécificité, elle n’est peut-être pas là où l’on croit : une informalité des réseaux liée à une plus faible syndicalisation et à une moindre importance de la question épistémologique ; une relative richesse du capital disponible (postes et revues) et de moindres besoins d’une recherche encore largement dispensée de matériels lourds et de terrains. Là par exemple où en Science Politique (à l’origine de la reconnaissance institutionnelle de la discipline tout au moins) ou en Economie par exemple ont pu se générer des conflits « d’école » pour la reconnaissance d’une ligne de recherche et d’enseignement spécifique (voir en dernier lieu la revendication de l’éclatement de la section 5 du Cnu), la tentative avortée de créer une section spécifique de criminologie s’est faite à la marge, et dans un pilotage dépassant largement une éventuelle controverse d’écoles au sein des juristes universitaires (qui se sont cependant mobilisés contre cette création au-delà des pénalistes). Ce qui me paraît alors faire défaut, ou tout au moins être plus difficilement saisissable, c’est le fondement épistémologico-politique de ces écoles : en bref la systématisation des critères. Une étude de sociologie des juristes universitaires devrait donc mettre en évidence des éléments explicatifs relativisant les raisons constitutives des réseaux et ne pas présupposer sans davantage d’approfondissement qu’ils révèlent des écoles de pensée.
Car c’est ce troisième sens qui me paraît le plus intéressant. Mais il suppose que l’on envisage les écoles dans une confrontation plurielle : comme fédérant des parties dans des controverses d’un certain type. Une école unique, même non hégémonique, n’est rien d’autre qu’un paradigme, qui éventuellement se substitue à un autre paradigme. Au risque de choquer, je continue à affirmer qu’il n’y a pour moi pas (ou plus) d’écoles dans ce sens en droit : que les controverses, qui me paraissent rares au regard de la démographie de la discipline, ne construisent pas des écoles, et restent anecdotiques dans leurs conséquences de structuration intellectuelle de la discipline (même si évidemment elles agitent la discipline, au moins un moment). En prétendant cela, je ne nie pas, une fois encore, l’existence de réseaux pour l’accès au capital, et je n’entends pas faire preuve d’angélisme : la discipline n’est pas une tour de Babel, un paradis pour chercheurs protégés dans l’université. Je regrette au contraire que la controverse ne soit pas plus présente et ne produise pas davantage d’effets. Mais je constate simplement qu’il me paraît manquer les éléments nécessaires à la généralisation de la controverse : une communauté épistémologique prête à s’accorder et se structurer sur des désaccords, que la prégnance de l’exercice dogmatique interdit. Bien entendu, ce qui précède vaut dès lors que l’on se situe au niveau de la communauté des juristes académiques ; il est vraisemblable qu’à des niveaux plus spécialisés, comme la théorie du droit, ou le droit international privé, puissent apparaître des controverses du type envisagé, et donc des Ecoles. Par exemple en théorie du droit entre le normativisme (l’Ecole française kelsénienne si l’on préfère) et le réalisme (l’Ecole nanterroise). Mais ce niveau présuppose une méta-représentation du droit commune, qui demeure alors extrêmement minoritaire (le positivisme épistémologique et l’affirmation que la science du droit n’est pas le droit) et qui ne s’inscrit pas elle-même dans une controverse d’Ecole : plus on monte en généralité, plus la controverse se dilue au point de ne pas pouvoir constituer un élément structurant de la discipline académique juridique.
Dès lors, les controverses, lorsqu’elles se produisent, révèlent en réalité des enjeux extra-épistémologiques. Je veux pour illustrer en donner quelques exemples, en m’appuyant sur des épiphénomènes qui ont été je crois surestimés (sur le plan épistémologique tout au moins).
La controverse sur la constitutionnalisation du droit me semble être celle qui aurait pu avoir les effets structurants les plus évidents.
A partir des années 1980, un nombre important de spécialistes de droit constitutionnel en s’appuyant sur la montée en puissance du contrôle de constitutionnalité, vont se réunir autour de l’idée que le droit constitutionnel (affaibli par la scission de la science politique) doit être la systématisation dogmatico-doctrinale (donc la description et la systématisation) des décisions du conseil constitutionnel (improprement appelée jurisprudence constitutionnelle voire contentieux constitutionnel). La création d’une association disciplinaire (Association française de droit constitutionnel), l’émergence de plusieurs centres de recherche dont à Aix-en-Provence le Groupe d’Etudes et de Recherches Comparées sur la Justice Constitutionnelle (Gerc, devenu Institut Louis Favoreu du nom de son fondateur), une stratégie de visibilité impressionnante (création de nouvelles revues, et de rubriques dans des revues existantes, relais auprès de l’institution étudiée, prix de thèses, présence au Cnu et dans les jurys d’agrégation de droit public) va permettre la diffusion de cette conception du droit constitutionnel, et (ré-)ancrer cette discipline au cœur de la pratique des juristes universitaires (transformant l’objet institutionnel et politique classique du droit constitutionnel, à la marge de la pratique des juristes, en objet premier des juristes, marqué par le différend juridique).
L’ambition n’est donc pas simplement de constituer une ou des écoles réseaux (ce qui a été immédiatement perçu par les analystes critiques, et nié – sans vraiment convaincre – par les animateurs de cette école – je n’insiste pas sur ce point qui est bien connu et étudié), mais une véritable école de pensée, affichant certains fondements théoriques et épistémologiques (une certaine version simplifiée du positivisme normativiste kelsénien).
Mais la dualité de l’ambition va conduire certains tenants de cette école à pousser au-delà la revendication, notamment en affirmant l’hypothèse d’une constitutionnalisation des branches du droit du fait de cette montée en puissance de la « jurisprudence constitutionnelle » : pour le dire brièvement, l’existence de décisions de constitutionnalité sur des lois régissant des disciplines académiques non constitutionnelles, comme le droit du travail ou le droit civil, aurait « constitutionnalisé » ces disciplines (voir notamment la thèse de Marc Frangi : Constitution et droit privé: les droits individuels et les droits économiques, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1992, avec pour sous-titre : Contribution à l’étude de la constitutionnalisation du droit privé).
La démarche était critiquable d’un point de vue théorique. La jurisprudence constitutionnelle, sur la base même d’un normativisme même relatif, ne constitutionnalise pas des disciplines académiques, ou si l’on préfère ne substitue pas une discipline académique (par exemple le droit constitutionnel social) à une autre (les sources constitutionnelles et la jurisprudence constitutionnelle en droit social) dans sa prétention à rendre compte de l’unité d’un ordre juridique constitué.
Derrière le débat, comme l’ont compris ceux qui sont entrés dans celui-ci, cristallisant la controverse (dès avant la publication de la thèse : voir notamment Christian Attias, « La civilisation du droit constitutionnel », Journal des Economistes et Etudes Humaines, 1990-1-4 et Jean-Yves Chérot, « Les rapports du droit civil et du droit constitutionnel. A propos de la « civilisation du droit constitutionnel », Journal des Economistes et Etudes Humaines, 1990-1-4), il y a une question d’influence disciplinaire académique : au sein des universités (dans la formation des futurs juristes, comme dans la répartition des moyens), et dans la constitution de méthodes (argumentatives, interprétatives, etc.) dans la pratique sociale qu’est le droit. Pas donc une controverse scientifique, même au sens le plus léger qui soit, mais bel et bien directement des enjeux de pouvoirs. Il n’est d’ailleurs pas neutre que la controverse ne s’est guère située au sein de la communauté disciplinaire du droit constitutionnel (les critiques, présentes et fortes dans ce cadre, comme dans l’association disciplinaire constituée, ne proposant pas une alternative fédérative autour d’une idée concurrente du droit constitutionnel, mais refusant pour des raisons diverses ce qui était devenu le paradigme de la discipline), mais entre tenants de disciplines académiques se voulant autonomes, dans une revendication d’autonomie et de préséance.
Pourtant, il y avait là matière, dans la formalisation des arguments, à dégager une controverse structurante : sur la place du droit constitutionnel et son identité, sur la construction unitaire d’un objet droit ou sur les revendications d’autonomie des disciplines académiques, sur les effets d’une pensée unitaire/divisée de la pratique sociale des juristes notamment. On a désormais largement oublié cette controverse, comme nombre de celles qui avaient précédé (Vedel et Eisenmann sur les bases constitutionnelles du droit administratif par exemple) : elles n’ont ni entraîné l’apparition d’écoles qui s’opposeraient théoriquement (entre droit constitutionnel et autres branches académiques du droit, ou au sein de la discipline académique du droit constitutionnel), ni ne se sont dissoutes dans des résolutions communément acceptées (ce qui aurait supposé une communauté théorique) ; simplement les arguments ont passé de mode, et ne sont ni plus affirmés (s’ils sont utilisés), ni discutés. D’ailleurs, là où les tenants de la constitutionnalisation auraient pu réamorcer la polémique, avec l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, il n’y eu guère de candidats, et c’est assez heureux ; d’un autre côté, l’européanisation du droit français, depuis une vingtaine d’année, a eu pour effet non un accroissement de la place des publicistes (longtemps en situation de monopole dans l’enseignement du droit européen conçu comme institutionnel), mais la captation du droit communautaire matériel par l’ensemble des disciplines académiques concernées par cette européanisation, et au premier chef les disciplines de droit privé (concurrence, liberté de circulation, etc.). Voilà qui peut inciter à de la prudence dans la manière de vouloir fonder une école sur l’hégémonie disciplinaire.
Toutes choses égales par ailleurs, le même type d’opposition peut se développer à un niveau plus restreint de la discipline (par exemple sur la question du droit international, public et privé unifiés, par opposition au droit interne) ; ou à un niveau plus général, comme dans l’affrontement autour de la question de l’enseignement du droit en dehors des universités (écoles et Iep de Paris principalement), et de la remise en cause de certains monopoles historiques d’accès aux professions juridiques (même si sur ces derniers points l’opposition, qui existe, ne trahit pas des positions uniformes, au moins au sein des universités). Ces affrontements ne transforment pas le débat en controverses d’écoles, car la question épistémologique de l’objet enseigné, si elle est parfois mobilisée formellement, ne se distingue jamais d’un enjeu de protection/conquête de la maîtrise des débouchés professionnels, et donc de l’attractivité des institutions pour les futurs juristes. Même si ces questions pourraient ne pas être sans effet sur des ruptures épistémologiques et pédagogiques (davantage liées par ailleurs à des différences criantes de moyens et de sélection), elles ne se superposent pas, notamment dans le cas de l’opposition entre juristes des universités et juristes de l’Iep de Paris avec une différenciation entre juristes et politistes, telle qu’elle a pu se construire dans les quarante dernières années.
A côté de la logique disciplinaire, un autre type de prétendue controverse est relativement fréquent, qui ne se traduit pas non plus en constitution d’écoles, à partir de positionnements politiques et moraux.
Deux exemples dans les dernières années l’ont montré. Le premier concerne le statut du droit européen et son enseignement dans les cursus juridiques français, le second l’adoption de la loi dite du mariage pour tous.
Ces deux exemples peuvent être regroupés car ils traduisent la même démarche. D’une part une pétition lancée par des universitaires juristes qui arguent de leur statut de juristes universitaires pour s’opposer à des évolutions du droit positif, directement (avant l’adoption de la loi) ou indirectement (en refusant d’enseigner ces évolutions), au moyen d’un texte collectif publié soit dans une revue juridique, soit dans des médias plus larges. La structure de l’argument est dans les deux cas identique, s’appuyant sur le statut et le nombre, à l’adresse d’autorités institutionnelles (Lettre ouverte au président de la République dénonçant l’excès de pouvoir entachant la proposition de règlement communautaire sur la loi applicable aux obligations contractuelles, Jcp G 2006, act. 586 et Lettre ouverte à toutes les sénatrices et tous les sénateurs de la République française afin de les alerter sur les conséquences réelles pour les enfants du projet de loi sur le mariage des personnes de même sexe, notamment dans Libération, 18/03/2013), et reposant sur l’affirmation d’une connaissance a priori du droit ou de ce qu’il doit être (au nom de cette connaissance).
La démarche sur l’excès de pouvoir du droit européen commençait par une affirmation qui à elle seule aurait pu fournir une posture d’école : « Dans une démocratie organisée selon les principes de l’Etat de droit, une règle n’est légitime que si elle émane d’une autorité investie du pouvoir de l’édicter. Comme on l’enseigne aux étudiants de première année des facultés de droit, sinon déjà aux collégiens dans leurs cours d’instruction civique, ce n’est qu’à cette condition qu’elle est une règle de droit et mérite donc obéissance… » ; c’est là le credo du cognitivisme éthique. Elleavait suscité une réaction sur le même plan : une contre pétition dans la même revue (Jcp G ; 2007, act. 18), dans laquelle les signataires (dont je faisais partie) affirmaient de leur côté qu’ : « ils ne considèrent pas qu’ils se déshonorent en enseignant, oralement ou par écrit, le droit communautaire et en le tenant pour du Droit [… et que…] quelles que soient les opinions que l’on peut avoir sur la construction de l’Europe, les problèmes difficiles posés par la transformation de la convention de Rome en règlement appellent des réponses plus constructives que le très excessif procès d’intention intenté par les auteurs de la lettre ». Par la suite, l’un des promoteurs de la première lettre, sous le titre révélateur de L’honneur des professeurs de droit. – Explication d’une lettre ouverte sur l’Union européenne, la démocratie et l’Etat de droit (V. Heuzé, Jcp G ; 2007, I 116), fournissait une explication de la démarche dans laquelle on trouve les affirmations suivantes : « Les auteurs de la lettre ouverte sont tous des professeurs en exercice. Et ils sont tous spécialisés dans les matières qu’affectent les excès de pouvoir qu’ils dénoncent. En tant qu’ils défendent les conditions d’exercice de leur profession, ils ne sont donc guère exposés aux justes observations de Pierre Bourdieu à propos de « ce que parler veut dire » […et…] Enseignant-chercheur, le professeur de droit est aussi un juriste. Ce n’est pas un politologue, un sociologue ou un psychologue qui observe la comédie du pouvoir et cherche à en découvrir les ressorts. Il est au service du droit, en tant que produit d’expériences multiséculaires et instrument de l’organisation sociale, mais non pas des puissants ». Face à cette double affirmation ontologique du droit (ce n’est qu’à cette condition qu’elle est une règle de droit et mérite donc obéissance) et du professeur de droit (au service du droit), il n’y eut pourtant pas de réponse clairement ontologique et épistémologique, seule susceptible de porter l’affrontement du terrain directement politique sur un terrain d’écoles.
C’est en revanche ce que avec Stéphanie Hennette-Vauchez, Véronique Champeil-Desplats et Pierre Brunet nous avons tenté de faire en répondant à laLettre ouverte à toutes les sénatrices et tous les sénateurs de la République française afin de les alerter sur les conséquences réelles pour les enfants du projet de loi sur le mariage des personnes de même sexe non sous forme de pétition mais par une présentation (nécessairement rapide) d’arguments de nature épistémologique, d’abord dans une revue en ligne de philosophie (http://www.raison-publique.fr/article601.html, et il faut ici dire que le texte proposé à des quotidiens, pour demeurer dans le même circuit de communication que la pétition discutée, n’avait pas été accepté, montrant que laquestion épistémologique importait assez peu dans le débat politique naturel ; le titre s’en ressent, Mariage pour tous : juristes, taisons-nous !, tout en se référant tant aux débats dans d’autres communautés de praticiens qu’à des articles essentiels de la réflexion sur la critique des juristes, v. infra), puis repris dans une revue juridique (sous un titre plus adapté à la démarche :« Mariage pour tous: les juristes peuvent-ils parler « au nom du Droit » ? », Recueil Dalloz, 2013, p. 784). A cette prise de position épistémologique, destinée à dessiner des oppositions d’écoles, une réponse fut proposée par quatre des signataires de la première lettre ouverte, qui dut néanmoins pour être acceptée à la publication recourir aux dispositifs juridiques relatifs au droit de réponse (B. Daugeron, A.-M. Le Pourhiet, J. Roux, P. Stoffel-Munck, « Droit de réponse. Mariage pour tous, silence pour quelques-uns », D. 2013, p. 784). Ni la réponse, ni les réactions à cette confrontation (davantage sur les blogs et les réseaux sociaux de juristes, ou non, que dans les écrits universitaires ; mais voir cependant parmi les rares exceptions A. Supiot, « Ontologie et déontologie de la doctrine», Dalloz 2013 p. 1421 ; M. Troper, « Les topographes du droit. A propos de l’argumentation anti-mariage gay : que savent les professeurs de droit ? », Grief ; 2014 n°1) n’ont entendu cependant se situer sur ce terrain. Il y a une véritable réticence semble-t-il à accepter ce recentrement, qui est pourtant le seul moyen de clarifier les fondements d’éventuelles écoles.
Un des points ironiques alors, dans ce minestrone politico-épistémologique, réside dans l’instrumentalisation du débat entre Danièle Lochak et Michel Troper sur le positivisme (voir Curapp, Les usages sociaux du droit, 1989) et plus particulièrement dans l’utilisation de la position prétendument défendue par Danièle Lochak, en défense du cognitivisme éthique et de la dévalorisation de la question épistémologique. Vincent Heuzé, dans son explication écrivait : « Or, comme le rappelle fort opportunément Danièle Lochak dans une étude très récente, « la description « neutre et objective » du droit positif produit des effets de naturalisation et de légitimation », alors que « le juriste est souvent le mieux placé pour démontrer et dénoncer le caractère dangereux ou pervers de certains textes ». Et ces justes remarques, qui concernent le « droit positif », sont l’expression d’un véritable devoir pour les juristes lorsque sont en cause des règles dont les conditions d’élaboration contredisent cette qualification ». Anne-Marie Le Pourhiet, Bruno Daugeron, Jérôme Roux et Philippe Stoffel-Munck achevaient quant à eux leur droit de réponse par ce paragraphe : « Il n’est pourtant jamais venu à l’esprit des 170 signataires de la lettre aux sénateurs d’enjoindre aux collègues de Paris-Ouest de se taire, ni de les accuser de « méthodes fallacieuses », ni encore de leur reprocher de « parler au nom du droit », comme ceux-ci viennent de le faire, en s’abritant derrière un paravent méthodologique et déontologique qui cache très mal leur évident soutien au projet de loi Taubira. D’une part parce que les 170 sont des universitaires tolérants et que certains d’entre eux auraient d’ailleurs fort bien pu signer quelques pétitions des collègues de Nanterre, d’autre part parce que c’est précisément de Nanterre qu’est un jour venue une opportune piqûre de rappel contre « les mésaventures du positivisme ». Outre dans cette dernière réponse la manœuvre stratégique, qui aurait pu être de bonne guerre, de souligner des contradictions ou des incohérences au sein d’une supposée Ecole nanterroise (qui pour exister supposerait une unité qui existe sans doute en partie, mais qu’il convient de ne pas exagérer, et surtout une controverse d’autres Ecoles se situant sur le même terrain pour justifier des postures différentes), il demeure que l’énoncé de prises de position épistémologique suppose qu’on aille un peu au-delà des titres, pour mobiliser des arguments. Danièle Lochak écrivait pourtant (il est vrai dans un texte un peu postérieur : « Ecrire, se taire…, Réflexions sur la doctrine antisémite de Vichy», Le Genre Humain no 30-31, 1996) : « Qu’on m’entende bien : je ne plaide pas pour le mélange des genres. Il est facile d’objecter que prendre parti, c’est tuer la science, et je sais tout ce que la rigueur juridique a à perdre d’y voir mêler sans cesse des jugements de valeur. Il faut savoir distinguer, dans sa propre pratique, ce qui relève respectivement du rôle du juriste, du rôle de l’intellectuel, du rôle du citoyen. Il faut être capable de dire clairement, lorsqu’on s’exprime, « d’où l’on parle », ne pas cultiver la confusion. Mais, pour autant, le juriste ne doit pas ignorer qu’il est aussi un intellectuel et un citoyen, et qu’il a à cet égard des responsabilités ».
Assumer rigueur épistémologique et engagement intellectuel, capacité à dire clairement « d’où l’on parle » ; deux principes d’une épistémologie minimale visiblement non perçue, comme le démontre sa récusation dans la dénonciation d’« un paravent méthodologique et déontologique qui cache très mal [un] évident soutien au projet de loi Taubira ». Je dois avouer que j’ignore encore à l’heure actuelle la position exacte de mes ami-e-s cosignataires sur ce point (qui n’importe en rien dans le recentrage que nous défendions). Pour ma part, m’entendre qualifier de soutien au projet de loi Taubira m’a simplement fait sourire, tant je n’avais pas caché ma position à propos des décisions Qpc antérieures à la loi :
« Si par exemple le conseil constitutionnel avait considéré que l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe posait dans son application un problème de discrimination, contraire à la constitution, cela ne revenait pas à admettre de facto la nécessité de décider, juridictionnellement ou législativement, la consécration juridique du mariage entre personnes de même sexe. Mais cela aurait montré qu’un problème de discrimination existe réellement dans le système, qui pourrait être surmonté de différente manière, c’est-à-dire par différentes possibilités de faire évoluer le système : l’évolution de l’interprétation de la loi existante par la Cour de cassation sur les mots « mari » et « femme » aux fins de ne pas y voir un obstacle au mariage qui n’est pas composé d’un « homme » et d’une « femme » au sens biologique ; la modification de l’énoncé du code civil par le législateur pour admettre le mariage entre personnes de même sexe ; mais aussi l’intervention du législateur ou du juge pour gommer les discriminations qui auraient été constatées entre personnes (hétérosexuelles) mariées et personnes non mariées, sans admettre le mariage homosexuel ; voire l’intervention du législateur pour considérer que le mariage, compris comme une institution produisant une discrimination entre couples de même sexe et couples de sexe différent du fait de ses dimensions religieuses ou sociales, ne peut plus être une institution juridique, qui serait renvoyé ainsi à une possibilité de la sphère privée juridiquement reconnue comme objet d’une liberté individuelle sans que des effets juridiques y soient attachés (un mariage religieux sans le mariage civil) ». (« Les premières Qpc en droit civil » in X Philippe et M. Stéfanini, Questions prioritaires de constitutionnalité : premiers bilans , Les cahiers de l’Institut Louis Favoreu, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2011, p. 43 et s.) ; ou sur la question de l’analyse des unions homosexuelles du point de vue du droit des libertés :
« Il est possible qu’il existe de bonnes raisons de refuser le mariage aux personnes du même sexe ; encore faut-il que ces raisons soient publiques, compatibles avec l’affirmation des droits fondamentaux, et que ces raisons conduisent évidemment à l’exclusion. Les raisons classiquement avancées pour considérer qu’un couple homosexuel et un couple hétérosexuel ne peuvent avoir le même droit au mariage sont celles de l’article 12 de la Convention, qui lient le mariage et la fondation de la famille, donc qui dessinent derrière l’institution du mariage la capacité de reproduction. Or les organes européens de protection des droits de l’homme eux-mêmes non seulement se refusent à limiter le droit au mariage à l’exigence de possibilité ou de volonté de reproduction (Comm Edh, 13 déc. 1979, Hamer c/ Royaume Uni : D. et R., 24, p. 5), mais reconnaissent aussi que les termes de l’article 12 n’impliquent pas « que le sexe doive être déterminé selon des critères purement biologiques » (Cedh, gr. ch., 11 juill. 2002, Goodwin c/ Royaume-Uni : Gacedh 2002, n° 38, § 100). Par ailleurs il ne fait aucun doute que le nombre de familles composées de parents non mariés et d’enfants (recomposées ou non) ne peut plus être considéré depuis longtemps comme marginal, et infirme l’idée d’un lien empiriquement nécessaire entre mariage et procréation. Il n’y a rien ici qui puisse justifier l’exclusion du mariage homosexuel. En revanche, il est possible et légitime de considérer que le mariage est un sacrement, et qu’il obéit à des présupposés de type religieux ou moraux, auxquels son extension aux couples homosexuels contreviendrait. Ces raisons ne sont pas nécessairement publiques, mais bien réelles derrière la prohibition. Or ces raisons n’impliquent pas nécessairement cette prohibition. Aussi respectables qu’ils soient, ces présupposés sont relatifs au mariage religieux, et n’ont pas à être pris en compte sans précaution, notamment celles qui imposent d’assurer l’égalité devant la loi, dans la compréhension du mariage civil. Si l’on tient absolument à protéger le lien entre mariage et présupposés religieux ou moraux, la prohibition du mariage homosexuel n’est pas plus légitime que la disparition du mariage civil, qui placerait juridiquement chaque couple dans une situation d’égalité vis-à-vis du droit, et laisserait à chacun de ces couples la responsabilité de sa conscience, en recourant ou non, s’il le veut ou s’il le peut, à un mariage strictement religieux, selon ses croyances. On peut choisir de supprimer le mariage civil, ou d’étendre le mariage aux couples homosexuels : c’est un choix essentiel, et qui mérite attention et prudence. Mais il est douteux que l’on puisse indéfiniment occulter ce choix en voulant préserver une législation établissant une discrimination de moins en moins justifiable ». (« La protection de la vie familiale » in P. Wachsmann et F. Picod (dir.), Encyclopédie Libertés, LexisNexis, Paris, 2007, fascicule 1200.)
Pour qu’il puisse y avoir Ecoles, dans le sens que j’ai adopté, il est donc nécessaire d’avoir au minimum une conception méta-doctrinale commune sur les nécessités d’une épistémologie, sinon partagée, du moins en débat (et sur la nature des arguments en débat). Je ne prétends donc pas qu’il faut une même conception épistémologique (le positivisme critique pour faire court), mais qu’il faut un intérêt pour la question épistémologique. C’est là la condition pour s’accorder sur des désaccords, et permettre une controverse cohérente, constitutive d’Ecoles. Or cette question ne me paraît pas plus centrale aujourd’hui qu’au moment où le Jam la discutait dans ses cours au sein de la communauté des juristes universitaires, qui se définit toujours académiquement (disciplinairement si l’on préfère, par l’appartenance à une même discipline qui n’est pas interrogée, et repose sur l’évidence des anciennes facultés de droit), comme le montre notre capacité à nous fédérer défensivement (contre la remise en cause du monopole de ces facultés) ou offensivement (dans des débats davantage politiques et citoyens que théoriques et scientifiques).
A cet égard, le constat auquel procédait la science politique il y a quarante ans ne peut être considéré comme dépassé, quand bien même l’essor très relatif de la théorie du droit ou de la sociologie du droit offre sans doute des pistes sinon nouvelles, en tout cas possibles ; mais très marginalement empruntées. Pour l’essentiel, il n’y a pas d’Ecoles en droit, mais une Ecole du droit, assez peu discutée de l’intérieur, et fortement attaquée de l’extérieur.
Si c’est donc là que se situe l’unité de la discipline juridique, à l’inverse, celle de la science politique peut faire aussi question. Rupture évidemment disciplinaire au sens académique, la science politique reconnue (Section Cnu, département à l’intérieur des Ufr de droit – et de science politique – le plus souvent davantage qu’autonomie institutionnelle) ne me semble pas pouvoir ni devoir s’unifier sur une épistémologie commune (même si à l’évidence la prise en compte de la question y est plus présente et radicale qu’au sein de la discipline juridique) : entre sociologie critique, histoire, philosophie et autres, la science politique est en réalité plurielle, non au sens d’Ecoles (encore que…) mais au sens de ses objets et de ses méthodes ; de sciences (du politique) ou de sciences sociales. D’une certaine manière, volontiers provocatrice, l’immobilisme des juristes (et sa puissance de feu : sa masse d’enseignants-chercheurs et d’étudiants si l’on veut) continue à unifier la discipline non de manière positive (ce que doit être la science politique) mais de manière négative (ce à quoi, ou à qui, elle – continue à – s’oppose-r). Loin de tuer le père, on conserve son image comme repoussoir, évitant peut-être d’aborder de front la question de sa propre identité.
D’un autre côté, tout cela demeure très franco-français : dans nombre de pays voisins une partie des politistes et des juristes travaillent ensemble autour d’un objet commun et de méthodes partagées : Kelsen n’a pu rejoindre Berkeley qu’en devenant professeur au département de science politique (après avoir été refusé à la faculté de droit de Harvard) ; et Bobbio fonda un département de science politique ; pour des raisons très diverses, deux des grands juristes du XXe siècle, tenants d’une épistémologie du droit rigoureuse, ont travaillé (avec) la science politique sans renoncer à cette épistémologie. Et l’on pourrait multiplier les exemples.
Il y a sans doute matière à dépasser les héritages historiques des deux disciplines du droit et de la science politique, leur clivage fondateur et leurs imprécisions épistémologiques, pour constituer sur des objets communs (quand ces objets sont communs) un travail pluridisciplinaire, voire pour faire émerger sur ces objets communs une épistémologie partagée (autour de l’empirie et de la sociologie du droit en action, autour de l’analyse linguistique critique, etc.). Il est bien sûr possible que cela ne soit plus ni réellement du droit, ni réellement de la science politique : mais c’est un enjeu majeur de la recherche et de l’enseignement. Cela l’était déjà dans les enseignements du Jam ; peu de structures disposent des atouts du Laboratoire des Sciences Sociales du Politique pour proposer une telle démarche et pour ce faisant faire Ecole.
À propos de l’auteur