Voici la 37e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du premier livre de nos Editions dans la collection Histoire(s) du Droit, publiée depuis 2013 et ayant commencé par la mise en avant d’un face à face doctrinal à travers deux maîtres du droit public : Léon Duguit & Maurice Hauriou.
L’extrait choisi est celui du commentaire par Mme Julia Schmitz (avec la complicité du prof. Sorbara) de La théorie de l’Institution & de la Fondation – essai de vitalisme social- par le doyen Maurice Hauriou.

Volume I :
Miscellanées Maurice Hauriou
Ouvrage collectif
(Direction Mathieu Touzeil-Divina)
– Nombre de pages : 388
– Sortie : décembre 2013
– Prix : 59 €
- ISBN / EAN : 978-2-9541188-5-7 / 9782954118857
- ISSN : 2272-2963

La théorie de l’Institution
& de la Fondation
– essai de vitalisme social-
par Maurice HAURIOU
in 4e des Cahiers de la Nouvelle journée
(La cité moderne et les transformations du droit), 1925 (p. 02 et s.).
Les institutions représentent dans le droit, comme dans l’histoire, la catégorie de la durée, de la continuité et du réel ; l’opération de leur fondation constitue le fondement juridique de la société et de l’Etat. La théorie juridique de l’institution, qui serre de près la réalité historique, a été lente à s’organiser. Elle n’a trouvé sa véritable assiette que lorsque le terrain a été déblayé par la querelle du contrat social et par celle de l’objectif et du subjectif. La querelle du contrat social et de l’institution est maintenant jugée. Rousseau avait imaginé que les institutions sociales existantes étaient viciées parce que fondées sur la force pure et qu’il fallait les renouveler par le contrat social instrument d’un libre consentement. Il avait confondu la force avec le pouvoir. Les institutions sont fondées grâce au pouvoir, mais celui-ci laisse place à une forme du consentement ; si la pression qu’il exerce ne va pas jusqu’à la violence, l’assentiment donné par le sujet est valable juridiquement : coactus voluit, sed voluit. Tout le monde est d’accord aujourd’hui que le lien social étant naturel et nécessaire, ne saurait être analysé qu’en un coactus volui.
L’institution est donc sortie triomphante de cette première épreuve, mais une autre l’attendait : la querelle de l’objectif et du subjectif. Le premier débat avait servi à préciser le degré de consentement qui subsiste dans les institutions, le second allait servir à déterminer le degré d’objectivité, c’est-à-dire d’existence propre, qu’il y a en elles.
Autant il nous serait inutile de revenir sur la querelle du contrat social, autant il sera utile, au contraire, d’exposer celle de l’objectif, qui n’est pas complètement vidée, et laquelle la théorie de l’institution, qui s’est achevée pendant le débat, vient peut-être apporter une solution. Cet exposé nous tiendra lieu d’introduction.
Des définitions préalables sont nécessaires.
Les juristes entendent par droit subjectif tout ce qui, dans le droit, se maintient par la volonté consciente de sujets déterminés, par exemple, les situations contractuelles, les dispositions testamentaires dites de dernière volonté : ils entendent, au contraire, par droit objectif tout ce qui, dans le droit, se maintient sans le secours de la volonté consciente de sujets déterminés et qui, ainsi, semble se maintenir par soi-même, par exemple une règle de droit coutumière.
Si l’on va au fond des choses, les situations juridiques qui semblent se maintenir par elles-mêmes sont, en réalité, liées à des idées qui persistent d’une façon subconsciente dans les esprits d’un nombre indéterminé d’individus. Les idées subconscientes sont celles qui vivent dans les cadres de notre mémoire sans être actuellement, pour nous, des volontés conscientes ; ce sont des idées que nous avons perçues, que nous avons emmagasinées, puis que nous avons perdues de vue ; elles vivent cependant en nous et même elles influent à notre insu sur nos jugements et sur nos actes, de la même façon que peut agir l’ambiance des objets familiers. Ce sont des objets qui habitent en nous.
Ainsi, le subjectif se maintient par nos volontés conscientes et l’objectif par nos idées subconscientes. Cela dit, abordons l’exposé de la querelle du droit subjectif et du droit objectif.
Depuis toujours, et instinctivement, les juristes avaient admis, dans le système juridique, la coexistence d’éléments subjectifs et d’éléments objectifs : la personnalité juridique, les droits subjectifs, les actes juridiques constituaient le premier groupe ; l’ordre public et ce qu’on appelait la « réglementation », c’est-à-dire, la masse des lois, des règlements et des coutumes, constituaient le second. Ce dualisme, correspondant à celui de la volonté consciente et de l’idée subconsciente, constituait un sage compromis.
Vers le milieu du dix-neuvième siècle, ce compromis fut dénoncé par l’organisation d’un système ultra-subjectiviste qui, cinquante ans plus tard, provoqua la formation d’un système ultra-objectiviste et c’est ainsi que s’engagea la querelle.
Le système subjectiviste s’édifia sur la base de la personnalité juridique, en annexant aux personnes individuelles les personnes morales corporatives et, la plus notable de toutes, la personne Etat. On eut la prétention de faire de ces personnes et de leurs volontés subjectives le support de toutes les situations juridiques durables et même des normes des règles du Droit. Des auteurs allemands, Gerber, Laband, Jellinek, pour faire entrer de force la « réglementation » dans le système du droit subjectif, imaginèrent de ramener les règles du droit à des volontés subjectives de la personne Etat.
En ce qui concernait les règles légales, la conception n’était pas nouvelle : Rousseau avait déjà défini la loi comme étant l’expression de la volonté générale, laquelle paraît bien, dans sa pensée, avoir signifié la volonté de la personne Etat. Mais cette conception était restée dans le domaine de la philosophie politique et c’était une imprudence à des juristes de la transporter dans le domaine du droit en la généralisant. Si les lois et les règlements élaborés par des organes de l’Etat pouvaient, à la rigueur, être considérés comme des volontés conscientes de celui-ci, ou, tout au moins, comme des volontés du législateur ou du gouvernement, en revanche, il était bien impossible de rattacher à la volonté de l’Etat les règles coutumières, qui ne sont l’œuvre d’aucun organe étatique, et dont beaucoup sont antérieures à l’âge de l’Etat moderne. Sans doute, au milieu du dix-neuvième siècle, l’âge de la coutume pouvait sembler révolu ; en France, elle avait été abolie comme source du droit par le code civil, en Allemagne, elle paraissait condamnée, mais c’était une illusion, en Allemagne même elle allait faire un retour offensif lors de la rédaction du nouveau code civil et, dans tous les pays Anglo-Saxons, sous le nom de common-law, la coutume générale demeurait extrêmement vivante. La tentative d’accaparement de toute la réglementation par le droit subjectif devait donc échouer.
Il y avait un autre écueil. L’Etat n’a pas toujours existé, c’est une formation politique de fin de civilisation ; les sociétés humaines ont vécu bien plus longtemps sous le régime des clans, des tribus, des seigneuries féodales que sous le régime d’Etat. Avec ces formations primaires, ou bien le droit était coutumier, ou bien il émanait du pouvoir du chef, en aucun cas, il n’était l’expression de la volonté de personnes morales qui n’existaient pas. Fallait-il aller jusqu’à dire que le droit du clan ou le droit tribal ou le droit seigneurial n’étaient pas du droit véritable ou, plus simplement, qu’avant l’avènement de l’Etat la règle de droit n’existait sous aucune forme ?
C’est même jusqu’à l’avènement
de la personnalité morale de l’Etat que la règle de droit n’eût pas existé,
puisqu’elle devait être une volonté subjective de celle-ci. Or, les Etats
passent généralement par une longue période de formation politique avant que n’apparaisse
leur personnalité juridique ; pendant cette longue période, le droit de l’Etat
lui-même n’eût pas existé. Cette conséquence ne fit pas reculer Jellinek qui déclara :
« la naissance, la vie et la mort des
Etats ne relèvent que de l’histoire », c’est-à-dire, tout ce qui n’est pas
manifestation de volonté de la personne morale Etat ne relève pas du Droit.
L’offensive dirigée contre la réglementation devait d’autant plus se retourner contre le système subjectiviste que celui-ci cachait plus d’une faiblesse. Il prétendait assurer la continuité des situations juridiques en les faisant soutenir par les personnes juridiques, or il n’avait pas une bonne théorie de la personnalité. Il faisait un effort pour échapper à la doctrine de la fiction en ce qui concernait les personnes corporatives, mais, en donnant à toute personnalité le substratum de la puissance de volonté (Willensmacht), d’abord, il n’en expliquait pas d’une façon convaincante la continuité, car la puissance de volonté peut être entendue comme discontinue, ensuite, il tombait dans le piège d’une objection dirimante ; il ne pouvait justifier la personnalité reconnue à l’infans et au fou, qui n’ont pas de volonté raisonnable.
La critique avait beau jeu et une réaction était inévitable qui allait être la revanche de l’objectif. Par une sorte de logique des choses, le nouveau système allait prendre pied dans cette « réglementation » si maladroitement annexée au droit subjectif. Ce fut le système de la règle de droit objective de Léon Duguit.
La thèse nouvelle fut aussi absolue que celle à laquelle elle s’opposait. Ce fut le tout à l’objectif dressé contre le tout au subjectif. La règle de droit, considérée comme chose existant en soi, devint le support de toute existence juridique, à la place de la personne juridique niée et rejetée comme un concept sans valeur, non seulement en ce qui concerne les institutions corporatives, mais même en ce qui concerne les individus ; il n’y eut plus de centre subjectif de droits subjectifs, toute vertu juridique fut concentrée en la règle de droit ; les actes des hommes ne purent produire d’effet de droit que par leur conformité à la règle ; l’application de la règle de droit ne produit, d’ailleurs, en principe, que des situations juridiques objectives, sauf lorsqu’elle-même admet l’intervention d’actes individuels qui, avec sa permission, engendrent de brèves situations subjectives ; la masse des situations objectives, par leur nombre et par leur durée, l’emporte de beaucoup en importance sur celle des situations subjectives et des droits subjectifs qui en naissent.
Ce système du droit objectif n’était pas venu seul, il avait suivi le flot propice du système sociologique de Durkheim qui, lui aussi, plaçait l’objectif au-dessus de tout en établissant le milieu social au-dessus des consciences individuelles ; la parenté est évidente ; la règle de droit n’était elle-même qu’un produit du milieu social, une règle acceptée comme obligatoire par « la masse des consciences », la masse des consciences assumait la direction du droit à la place de la conscience individuelle.
Le système est, d’ailleurs, inacceptable parce qu’il dépasse le but. Il ne se borne pas à faire de la règle de droit un élément de continuité pour les institutions sociales, il prétend en faire l’élément formateur ; or, s’il est vrai que les règles de droit sont, pour les institutions, un élément de conservation et de durée, on ne saurait en conclure qu’elles soient l’agent de leur création. C’est là tout le problème : il s’agit de savoir où se trouve, dans la société, le pouvoir créateur ; si ce sont les règles du droit qui créent les institutions ou si ce ne sont pas plutôt les institutions qui engendrent les règles du droit, grâce au pouvoir de gouvernement qu’elles contiennent. C’est sur cette question de l’initiative et de la création que le système de la règle de droit objective vient échouer ; admettre la création des institutions sociales par la règle de droit serait admettre leur création par le milieu social, qui est censé créer la règle de droit elle-même. C’est là une contre-vérité par trop évidente ; le milieu social n’a qu’une force d’inertie qui se traduit par un pouvoir de renforcement des initiatives individuelles quand il les adopte ou, au contraire, d’inhibition et de réaction quand il les réprouve, mais il n’a par lui-même aucune initiative ni aucun pouvoir de création ; il est impossible qu’il sorte de lui une règle de droit créatrice qui, par hypothèse, serait antérieure à ce qu’il s’agirait de créer. Ajoutons, d’ailleurs, que le milieu social fût-il doué d’un pouvoir créateur, la règle de droit serait un déplorable instrument de création, parce que c’est un principe de limitation qu’il y a en elle. Les règles du droit sont des limites transactionnelles imposées aux prétentions des pouvoirs individuels et à celles des pouvoirs des institutions ; ce sont des règlements anticipés de conflits. Les définitions révolutionnaires font nettement apparaître ce caractère : « l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits, ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » (Déclaration des droits, article 4). Ainsi le rôle du législateur est celui d’un agrimentor qui pose des bornes entre des champs d’activité ; les lois organiques des libertés individuelles, la loi sur la presse, la loi sur les associations, les lois sur la liberté de l’enseignement, toutes les lois civiles sur la liberté des contrats ou sur le libre usage de la propriété individuelle, même dans celles de leurs dispositions qui paraissent constructives, ne sont en réalité que des bornes et des limites. De là, la maxime traditionnelle de l’ordre individualiste que « tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis », ou mieux, que « tout ce qui n’est pas défendu par la loi, et qui est œuvre de volonté individuelle, est valable juridiquement » (Déclaration des droits, articles 4 et 5).
Nous aurons plus loin l’occasion de revenir sur ces idées fondamentales, nous en avons assez dit pour le moment. On saisit tout ce que le système de la règle de droit contient de dangereuses contre-vérités ; il faudrait désormais poser le principe inverse de celui sur lequel a toujours reposé l’ordre individualiste et dire : « tout ce qui n’est pas permis par la règle de droit ou tout ce qui n’est pas conforme à une règle de droit préexistante est inefficace juridiquement ». Outre le caractère nettement anti-individualiste d’un pareil principe, il convient de remarquer son infécondité ; toutes les créations nouvelles de la pratique sociale resteraient en dehors du droit pendant un nombre indéterminé d’années parce que, n’étant plus conformes à la règle de droit ancienne, et n’étant pas davantage conformes à une règle de droit nouvelle qui ne naîtra que lorsque le milieu social se sera ému, elles resteraient entre deux selles.
On touche du doigt l’erreur fondamentale de toute cette construction : elle consiste à prendre la réaction pour l’action et la durée pour la création ; ce sont les éléments subjectifs qui sont les forces créatrices et qui sont l’action ; les éléments objectifs, la règle de droit, le milieu social, l’ordre public, ne sont que des éléments de réaction, de durée et de continuité ; attribuer aux uns le rôle des autres, c’est mettre la maison à l’envers.
Il faut renvoyer dos à dos le système du tout au subjectif et celui du tout à l’objectif, l’un a pris l’action pour la durée et l’autre la durée pour l’action. D’ailleurs, par une aventure assez plaisante, tous les deux ont été conduits à reléguer dans l’histoire des éléments importants qu’ils ne savaient comment faire entrer dans leur construction juridique. Le système subjectiviste a déclaré que la naissance des Etats n’appartient qu’à l’histoire, ce qui est retrancher du Droit l’opération de leur fondation ; le système objectiviste, de son côté, est conduit à admettre que la formation des règles du Droit n’appartient qu’à l’histoire, puisque la règle n’a rien de juridique jusqu’à ce qu’elle soit acceptée comme obligatoire par la masse des consciences, ce qui demande du temps. Des deux côtés, l’opération de fondation est laissée pour compte, aussi bien celle de la fondation des Etats que celle de la fondation des règles de droit ; on relègue ainsi hors du droit les fondements du Droit, car, d’une part, nous l’avons déjà observé, les fondements ne sont que des fondations continuées, et d’autre part, on admettra bien que le fondement de l’Etat et celui de la règle de Droit sont des fondements du Droit. En vertu de la logique qui gouverne les mouvements d’idées, il était naturel que la théorie de l’institution et de la fondation, qui succède historiquement aux systèmes subjectiviste et objectiviste, prît pied dans la matière de la fondation des institutions, que les deux systèmes antagonistes avaient également sacrifiée ; son objet essentiel est de démontrer que la fondation des institutions présente un caractère juridique et qu’à ce point de vue les fondements de la durée juridique sont eux-mêmes juridiques. Elle a, d’ailleurs, profité de la querelle du subjectif et de l’objectif : elle admet le dualisme de ces états, car elle voit, dans cette opposition, moins des éléments tranchés que des états différents, par lesquels peuvent passer, suivant les moments, soit une institution corporative, soit une règle de droit.
Les grandes lignes de cette nouvelle théorie sont les suivantes : une institution est une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu social ; pour la réalisation de cette idée, un pouvoir s’organise qui lui procure des organes ; d’autre part, entre les membres du groupe social intéressé à la réalisation de l’idée, il se produit des manifestations de communion dirigées par les organes du pouvoir et réglées par des procédures.
Il y a deux types d’institutions, celles qui se personnifient et celles qui ne se personnifient pas. Dans les premières, qui forment la catégorie des institutions-personnes ou des corps constitués (Etats, associations, syndicats, etc.), le pouvoir organisé et les manifestations de communion des membres du groupe s’intériorisent dans le cadre de l’idée de l’œuvre : après avoir été l’objet de l’institution corporative, l’idée devient le sujet de la personne morale qui se dégage dans le corps constitué. Dans les institutions de la seconde catégorie, qu’on peut appeler des institutions-choses, l’élément du pouvoir organisé et des manifestations de communion des membres du groupe ne sont pas intériorisés dans le cadre de l’idée de l’œuvre, ils existent cependant dans le milieu social, mais restent extérieurs à l’idée ; la règle de droit établie socialement est une institution de ce second type ; elle est une institution parce qu’en tant qu’idée elle se propage et vit dans le milieu social, mais, visiblement, elle n’engendre pas une corporation qui lui soit propre ; elle vit dans le corps social, par exemple dans l’Etat, en empruntant à celui-ci son pouvoir de sanction et en profitant des manifestations de communion qui se produisent en lui. Elle ne peut pas engendrer de corporation parce qu’elle n’est pas un principe d’action ou d’entreprise, mais, au contraire, un principe de limitation.
Les institutions naissent, vivent et meurent juridiquement ; elles naissent par des opérations de fondation qui leur fournissent leur fondement juridique en se continuant ; elles vivent d’une vie à la fois objective et subjective, grâce à des opérations juridiques de gouvernement et d’administration répétées, et, d’ailleurs, liées par des procédures ; enfin, elles meurent par des opérations juridiques de dissolution ou d’abrogation. Ainsi, elles occupent juridiquement la durée et leur chaîne solide se croise avec la trame plus légère des relations juridiques passagères. Nous étudierons, seulement, les institutions-personnes ou institutions corporatives, nous analyserons leurs éléments et observerons leur vie. On pourrait faire la même étude pour les institutions-choses, particulièrement pour les règles de droit. L’espace nous manquerait pour ce second exposé ; nous nous bornerons à signaler, chemin faisant, les différences essentielles qui les séparent des institutions corporatives.
I.
Les éléments de toute institution corporative sont, nous le savons, au nombre de trois : 1° l’idée de l’œuvre à réaliser dans un groupe social ; 2° le pouvoir organisé mis au service de cette idée pour sa réalisation ; 3° les manifestations de communion qui se produisent dans le groupe social au sujet de l’idée et de sa réalisation.
Rappelons aussi que, pour nos institutions, il se produit un phénomène d’incorporation, c’est-à-dire d’intériorisation de l’élément pouvoir organisé et de l’élément manifestations de communion des membres du groupe, dans le cadre de l’idée de l’œuvre à réaliser, et que cette incorporation conduit à la personnification. Elle y conduit d’autant plus aisément qu’en réalité le corpus, qui résulte de l’incorporation, est lui-même déjà un corps très spiritualisé ; le groupe des membres y est absorbé dans l’idée de l’œuvre, les organes y sont absorbés dans un pouvoir de réalisation, les manifestations de communion sont des manifestations psychiques. Sous cet aspect, tous ces éléments sont plus spirituels que matériels, et ce corps est de nature psycho-physique.
I.
L’élément le plus important de toute institution corporative est celui de l’idée de l’œuvre à réaliser dans un groupement social ou au profit de ce groupement. Tout corps constitué est pour la réalisation d’une œuvre ou d’une entreprise. Une société anonyme est la mise en action d’une affaire, c’est-à-dire d’une entreprise de spéculation ; un hôpital est un établissement constitué pour la réalisation d’une idée charitable ; un Etat est un corps constitué pour la réalisation d’un certain nombre d’idées, dont les plus accessibles sont ramassées dans la formule suivante : « protectorat d’une société civile nationale, par une puissance publique à ressort territorial, mais séparée de la propriété des terres, et laissant ainsi une grande marge de liberté pour les sujets ».
Il ne faut pas confondre l’idée de l’œuvre à réaliser qui mérite le nom « d’idée directrice de l’entreprise » avec la notion du but, ni avec celle de la fonction. L’idée de l’Etat, par exemple, est bien autre chose que le but de l’Etat ou la fonction de l’Etat.
Une première différence entre le but d’une entreprise et l’idée directrice de celle-ci, c’est que le but peut être considéré comme extérieur à l’entreprise, tandis que l’idée directrice est intérieure à celle-ci. Une seconde différence, liée à la première, est que, dans l’idée directrice, il y a un élément de plan d’action et d’organisation en vue de l’action qui dépasse singulièrement la notion du but. Quand on dit de l’idée de l’Etat qu’elle est celle du protectorat de la société civile nationale, l’idée du protectorat éveille celle d’une certaine organisation et d’un certain programme d’action ; si l’on parlait du but de l’Etat, on dirait qu’il est la protection de la société civile nationale, ce qui n’éveillerait plus que l’idée d’un résultat ; la différence entre le programme d’action et le résultat traduit bien celle qui existe entre l’idée directrice et le but. Il ne serait, même pas exact d’assimiler l’idée directrice avec l’idée du « but à atteindre », car la première exprime à la fois le but et les moyens à employer pour l’atteindre, tandis que la seule idée du but ne vise pas les moyens.
Il ne faut pas non plus confondre l’idée de l’œuvre à réaliser par une institution avec la fonction de cette institution. L’idée de l’Etat dépasse singulièrement la notion des fonctions de l’Etat. La fonction n’est que la part déjà réalisée ou, du moins, déjà déterminée de l’entreprise ; il subsiste dans l’idée directrice de celle-ci une part d’indéterminé et de virtuel qui porte au-delà de la fonction. La séparation des deux domaines est frappante dans l’Etat ; il y a le domaine de la fonction qui est celui de l’administration et du train déterminé des services, il y a aussi le domaine de l’idée directrice qui est celui du gouvernement politique, lequel travaille dans l’indéterminé. Et c’est un fait que le gouvernement politique passionne les citoyens bien plus que la marche de l’administration, de telle sorte que ce qu’il y a d’indéterminé dans l’idée directrice a plus d’action sur les esprits que ce qui est déterminé sous forme de fonction.
L’idée directrice des institutions corporatives autres que l’Etat ne saurait non plus être ramenée à celle de fonction déterminée. Notre droit positif a eu, pendant longtemps, l’illusion de croire possible cette réduction ; le droit administratif a essayé de parquer dans une spécialité officielle les établissements religieux et charitables en ce qui concerne l’acceptation des libéralités avec charges ; on refusait à une fabrique d’église l’autorisation d’accepter une libéralité à charge d’aumônes, à un hôpital l’autorisation d’en accepter une à charge d’ouverture d’école, etc. Le droit commercial, de son côté, professait une sorte de spécialité des sociétés de commerce déterminée par leurs statuts et l’immutabilité de ces statuts ; lorsque les compagnies des grands réseaux créèrent des hôtels Terminus dans les gares, on se demanda si elles ne sortaient pas de leur spécialité.
Des idées plus larges ont prévalu, les hôtels Terminus sont restés ouverts ; la modification des statuts des sociétés a été largement admise ; la spécialité des établissements publics a été considérée comme une pure règle de police administrative, d’ailleurs discutable. Là encore, le caractère indéterminé de l’idée directrice l’a emporté sur la spécialité de la fonction déterminée. Les Anglais, quant à eux, ont complètement écarté la spécialité fonctionnelle pour leurs sociétés de commerce, toute société a vocation pour entreprendre n’importe quelle espèce de spéculation commerciale, parce que son idée directrice est la spéculation.
L’idée directrice de l’œuvre, qui dépasse ainsi les notions de but et de fonction, serait plus justement identifiée avec la notion d’objet. L’idée de l’entreprise est l’objet de l’entreprise, car l’entreprise a pour objet de réaliser l’idée. Elle est si bien l’objet de l’entreprise que c’est par elle et en elle que l’entreprise va s’objectiver et acquérir une individualité sociale. C’est l’idée de l’entreprise, en effet, qui, en se propageant dans les mémoires d’un nombre indéterminé d’individus, va vivre dans leur subconscient d’une vie objective, la Banque de France, la Ville de Paris, l’Etat lui-même.
L’idée se créera des adhérents plus proches dans le groupe des gens intéressés à la réalisation de l’entreprise parce qu’ils seront actionnaires ou sujets ; même dans ce groupe plus immédiat des intéressés, elle sera encore d’ordinaire à l’état objectif dans le subconscient. Sans doute, elle passera par intervalles à l’état subjectif dans des manifestations de volonté conscientes, mais ce sera, en apparence du moins, d’une façon discontinue, tandis que la hantise de l’idée objective, dans le subconscient de la mémoire, sera continue.
Il n’est pas douteux que l’idée objective ne sera pas classée dans toutes les mémoires avec la même interprétation. Il faut distinguer soigneusement l’idée, envisagée en elle-même, et les concepts subjectifs par l’intermédiaire desquels elle est perçue par les esprits. Chaque esprit réagit sur l’idée et s’en fait un concept. Les thèmes éternels de la passion aux prises avec le devoir ou la raison ne sont pas traités par Racine comme ils l’avaient été par Sophocle ou Euripide ; une tragédie de Racine n’est ni jouée ni comprise au vingtième siècle de la même façon qu’au dix-septième siècle. Il en est de même de l’idéal de la justice, il a été conçu de bien des façons successives. On ne peut pas dire, cependant, qu’il n’y ait rien de persistant, de réel et d’objectif dans l’idée de la justice, pas plus que dans celle du devoir ou dans celle de l’amour.
Malgré la glose subjective dont l’enveloppent les concepts de chacun des adhérents, une idée d’œuvre qui se propage dans le milieu social possède une existence objective et c’est, d’ailleurs, cette réalité-là qui lui permet de passer d’un esprit à un autre et de se réfracter différemment dans chacun sans cependant se dissoudre et s’évanouir.
On doit, se demander si cette nature objective de l’idée est originaire et foncière. Si l’idée était la création subjective de l’esprit d’un individu déterminé, on ne concevrait guère comment elle pourrait acquérir le caractère objectif qui lui permettrait de passer dans un autre esprit. Du moment que les idées passent d’un esprit à un autre, elles doivent avoir, dès le début, une nature objective. En réalité, il n’y a pas des créateurs d’idées, il y a seulement des trouveurs. Un trouvère, un poète inspiré rencontre une idée à la façon dont un mineur rencontre un diamant : les idées objectives existent d’avance dans le vaste monde, incorporées aux choses qui nous entourent ; dans des moments d’inspiration, nous les trouvons et les débarrassons de leur gangue.
Ces aperçus sur l’objectivité originaire et foncière des idées, sur lesquels nous n’insistons pas, ne doivent pas nous faire oublier l’étude du groupe humain qui, dans une institution corporative, est intéressé à la réussite de l’idée directrice de l’entreprise. Il n’y a pas d’institution corporative sans un groupe d’intéressés, dans l’Etat le groupe des sujets et des citoyens, dans le syndicat le groupe des syndiqués, dans la société anonyme le groupe des actionnaires. Ce groupement peut être déterminé en partie par la contrainte d’un pouvoir, mais l’ascendant de l’idée de l’œuvre et l’intérêt que les membres ont à sa réalisation jouent un grand rôle en ce qu’ils expliquent ce que les adhésions ont de volontaire. Il s’agit ici d’adhérents qui courent un risque personnel dans la réalisation ou la non réalisation de l’entreprise.
Ce groupe des intéressés est, avec les organes du gouvernement, le porteur de l’idée de l’entreprise. En ce sens, on doit reconnaître que le groupe des membres de l’Etat est, en même temps, celui des sujets de l’idée d’Etat et cette observation donne au mot « sujet » une grande profondeur de signification ; cela veut dire que chaque ressortissant porte en lui l’idée de l’Etat et qu’il est le sujet de cette idée, parce qu’il a les risques et la responsabilité de sa réussite. Le sujet d’un Etat est, en somme, comme un actionnaire de l’entreprise de l’Etat. Et c’est cette situation du sujet qui engendre à la longue sa qualité de citoyen, parce qu’étant exposé aux risques de l’entreprise, il est juste qu’il acquière, en retour, un droit de contrôle et de participation au gouvernement de celle-ci.
Par cette analyse des caractères du groupe des intéressés, nous rejoignons les idées qu’avait exposées Michoud dans sa Théorie de la personnalité morale, dès 1906, avec cette différence essentielle, cependant, que le groupe des intéressés n’est pas pour nous le seul porteur de l’idée de l’Etat, ou de l’idée de l’entreprise corporative, quelle qu’elle soit, qu’il y a aussi les organes de gouvernement avec leur pouvoir, ce qui, d’ailleurs, explique que l’idée de l’Etat ait à son service un pouvoir de gouvernement autonome qui s’impose aux citoyens eux-mêmes et auquel ils ne font que participer.
II.
Le second élément de toute institution corporative est, en effet, un pouvoir de gouvernement organisé qui est pour la réalisation de l’idée de l’entreprise et à son service. C’est ce qu’on appelle couramment l’organisation de l’institution, mais il est essentiel d’interpréter l’organisation en un pouvoir organisé, parce que le pouvoir étant lui-même une forme de la volonté, les organes n’étant plus envisagés que comme des pouvoirs de volonté, cela spiritualise l’élément humain de l’organisation.
Les bases de l’organisation du pouvoir de gouvernement sont elles-mêmes toutes spirituelles, elles se ramènent à deux principes, celui de la séparation des pouvoirs et celui du régime représentatif.
Toute séparation des pouvoirs est une séparation des compétences, choses spirituelles ; dans la séparation de l’Etat moderne, le pouvoir exécutif a la compétence intuitive de la décision exécutoire, le pouvoir délibérant la compétence discursive de la délibération et le pouvoir de suffrage celle de l’assentiment. Sans doute, ces compétences sont confiées à des organes humains, mais la meilleure preuve que les organes sont subordonnés aux compétences, c’est la pluralité des organes qui doivent se concerter entre eux pour exercer le même pouvoir ; pour l’exercice du pouvoir exécutif, le Président de la République et les ministres, pour l’exercice du pouvoir délibérant, les deux Chambres, pour celui du pouvoir de suffrage, les électeurs d’une circonscription.
C’est à cette séparation des pouvoirs, qui entraîne une séparation plus grande encore des organes, que le pouvoir doit de n’être pas une simple force, d’être, au contraire, un pouvoir de droit susceptible de créer du droit ; les séparations assurent la suprématie des compétences sur le pouvoir de domination vers lequel, sans cette précaution, les organes seraient portés.
Le principe du régime
représentatif répond à un autre besoin. Il faut que le pouvoir de gouvernement
d’une institution corporative agisse au nom du corps, que ses décisions
puissent être considérées comme celles du corps lui-même ; un corps n’est
rien sans ses organes et il ne veut que par eux, mais il faut que ceux-ci veuillent
pour lui et non pas pour eux-mêmes. Ce difficile problème est résolu par le
principe représentatif, qui,
lui-même, repose tout entier sur l’idée de l’œuvre à réaliser. Cette idée
directrice est supposée commune aux organes du gouvernement et aux membres du
groupe. Toute la technique de l’organisation représentative consistera à
assurer dans les faits la réalité de cette vision commune, d’une façon continue
si c’est possible, tout au moins d’une façon périodique.
La subordination de la volonté dirigeante à l’idée de l’œuvre à réaliser peut se produire spontanément dans la conscience hautaine d’un prince absolu, comme dans la conscience assouplie d’un ministre soumis à l’élection populaire ; l’élection n’est pas de l’essence du régime représentatif, mais elle est un élément naturel de sa technique, parce qu’elle paraît une garantie de la communauté de vue entre les gouvernants et les membres du corps.
Le pouvoir de gouvernement
d’une institution n’observe pas toujours l’attitude de docilité et de conformisme
que nous venons d’esquisser ; l’histoire des Etats et même de quelques
institutions privées enseigne que trop souvent les pouvoirs dirigeants se
détournent de la préoccupation du bien commun pour obéir à des mobiles égoïstes ;
mais, à l’envisager de haut, cette histoire prouve deux choses : d’abord,
que le pouvoir de gouvernement est une force d’action spontanée et non pas
seulement l’appel d’une fonction à remplir, puisque trop souvent cette force d’action
s’insurge contre sa
fonction ; ensuite, cette histoire révèle la puissance d’ascendant de l’idée
de l’œuvre à réaliser, puisque lentement, mais sûrement et progressivement,
même dans l’Etat, les passions fougueuses des gouvernants ont fini par s’assujettir
à son service ; sans doute, les mécanismes constitutionnels y ont aidé,
mais ces mécanismes eux-mêmes, ou bien n’auraient pas été créés, ou bien n’auraient
servi de rien, s’ils n’avaient pas été soutenus par un esprit public pénétré de
l’idée de l’Etat.
La soumission volontaire à certaines idées directrices de la part des gouvernants ne saurait être mieux illustrée que par l’exemple de la soumission des chefs militaires au pouvoir civil dans les Etats modernes. Cette subordination de la force armée, si contraire à la nature des choses, n’aurait jamais pu être obtenue par de simples mécanismes constitutionnels. Elle est le résultat d’une mentalité créée par l’ascendant d’une idée, celle du régime civil liée à celle de la paix, considérée comme constituant l’état normal. Déjà en 1896, dans un chapitre de notre Science Sociale Traditionnelle, nous signalions cet ascendant pris par l’idée directrice sur le pouvoir, nous l’appelions le phénomène de l’institution et nous insistions sur le caractère de bonification morale des organisations fondées sur le pouvoir, que cette notion présente.
III.
Il nous reste à mettre en ligne un dernier élément de l’institution corporative qui est la manifestation de communion des membres du groupe et aussi des organes de gouvernement, soit en l’idée de l’œuvre à réaliser, soit en celle des moyens à employer. Ce phénomène de communion, auquel nous avons fait allusion déjà et grâce auquel l’idée directrice de l’œuvre passe momentanément à l’état subjectif, doit être étudié dans sa réalité phénoménale.
Là où il est le plus saisissable, c’est dans les grands mouvements populaires, qui accompagnent la fondation d’institutions politiques et sociales nouvelles ; la fondation des communes au moyen âge a été accompagnée de grandes crises morales qui soulevaient les populations au cri de « communion, communion »; la formation des syndicats, à la fin du dix-neuvième siècle, a provoqué dans la classe ouvrière le même mouvement d’union ; il n’est pas douteux que la formation des Etats, à l’époque où elle a pris le caractère d’une contagion, par exemple, vers l’an mille avant Jésus-Christ, n’ait provoqué un mouvement analogue ; nous en avons un écho dans le livre de Samuel, au passage où les Israélites « demandent un roi ».
Avec moins d’envergure, les mouvements de communion se manifestent au moment de la fondation des institutions particulières ; reproduisant un type connu, presque toujours la fondation est précédée de réunions dans lesquelles, d’une façon plus ou moins chaleureuse, elle est acclamée en principe.
Le fonctionnement des institutions entraîne des communions de même espèce, surtout avec le régime des assemblées. Sans doute, toutes les séances d’assemblées ne présentent pas des scènes aussi émouvantes que le serment du jeu de paume ou la nuit du 4 août, toutes ne voient pas non plus se réaliser l’union sacrée, mais, d’une façon plus froide, la formation d’une majorité dans un vote demande toujours un état d’union des volontés.
Ces mouvements de communion ne s’analysent pas du tout en des manifestations d’une conscience collective ; ce sont les consciences individuelles qui s’émeuvent au contact d’une idée commune et qui, par un phénomène d’interpsychologie, ont le sentiment de leur émotion commune. Le centre de ce mouvement c’est l’idée qui se réfracte en des concepts similaires en des milliers de consciences et y provoque des tendances à l’action. L’idée passe momentanément à l’état subjectif en des milliers de consciences individuelles qui s’unissent en elle ; les consciences individuelles invoquent son nom et elle descend au milieu d’elles, appropriée par elles à l’état subjectif. Voilà l’exacte réalité.
Analyser le phénomène en l’apparition d’une conscience collective, ainsi que le fait l’école de Durkheim, c’est rabaisser cette réalité, car la conscience collective serait liée à la formation d’une opinion moyenne dans le milieu social, c’est-à-dire dans la masse des esprits. Au contraire, la réfraction d’une même idée directrice dans une pluralité de consciences individuelles réserve le rôle dirigeant des consciences les plus hautes dans les conséquences à tirer pour l’action. Entre les deux analyses, il y a la différence qui sépare l’explication des progrès de la civilisation par l’action des élites et l’explication par la seule évolution du milieu. La communion en l’idée, c’est Ariel, la conscience collective, c’est Caliban.
La communion en l’idée entraîne l’entente des volontés sous la direction d’un chef ; elle ne comporte pas seulement l’assentiment intellectuel, mais la volonté d’agir et le commencement de geste qui, par un risque couru, engage tout l’être dans la cause commune ; en un mot, c’est une communion d’action.
Ces ententes prennent l’importance d’une opération juridique spéciale que nous étudierons au paragraphe suivant et qui est l’opération de fondation.
IV.
Les institutions corporatives subissent le phénomène de l’incorporation, qui les conduit à celui de la personnification. Ces deux phénomènes sont, eux-mêmes, sous la dépendance d’un mouvement d’intériorisation qui fait passer dans le cadre de l’idée directive de l’entreprise, d’abord, les organes de gouvernement avec leur pouvoir de volonté, ensuite, les manifestations de communion des membres du groupe. Ce triple mouvement d’intériorisation, d’incorporation et de personnification est d’une importance capitale pour la théorie de la personnalité. Si sa réalité est constatée, elle entraînera la réalité de la personnalité morale, base de la personnalité juridique, car il sera établi que la tendance à la personnification est naturelle. Cela sera établi aussi bien pour les personnes individuelles que pour les personnes corporatives, car, il ne faut pas se le dissimuler, actuellement, la personnalité morale individuelle est aussi contestée que la corporative.
Cet état de la question nous autorisera à user d’une méthode comparative nouvelle, c’est-à-dire à confronter la psychologie corporative et la psychologie individuelle, à tirer argument de ce que nous révèle l’introspection dans la psychologie individuelle pour aider notre analyse de la psychologie corporative, et, inversement, à utiliser les constatations de la psychologie corporative pour éclairer les résultats de l’introspection individuelle.
La justification de cette méthode comparative repose sur le postulat que la société est œuvre psychologique, que dans cette œuvre psychologique il y a action et réaction réciproques de l’esprit humain et de certaines idées objectives, bases des institutions ; que la personnalité corporative est une création sociale faite, dans une large mesure, à l’image de la personnalité humaine, mais que, comme elle s’est faite d’une façon subconsciente, elle peut révéler des ressorts de la personnalité humaine que l’introspection consciente ne révèle pas ; que, d’ailleurs, dans la personnalité corporative, les détails d’organisation étant fortement agrandis et comme projetés sur un écran, l’observation en est rendue plus aisée.
A.
Nous établirons, d’abord, à l’aide de notre méthode comparative, la réalité du triple mouvement de l’intériorisation, de l’incorporation et de la personnification, par conséquent, la réalité de la personnalité morale au point de vue de sa formation naturelle. Puis nous aborderons un autre aspect de la question, à savoir jusqu’à quel point et de quelle façon l’institution incorporée et personnifiée assure sa propre durée et sa propre continuité : car, sans doute, l’incorporation et la personnification sont pour obtenir ces résultats.
Mais une observation préalable s’impose : la psychologie comparée de la personnalité corporative et de la personnalité humaine ne peut être établie que si la personnalité humaine peut elle-même, dans une certaine mesure, être assimilée à une institution corporative. Cette condition préalable, pour surprenante qu’elle paraisse au premier abord, répond à des réalités assez nombreuses et assez importantes pour être admise après réflexion.
Il se peut que l’être humain consiste essentiellement en « une idée d’œuvre à réaliser, servie par un pouvoir de gouvernement et provoquant des manifestations de communion dans un groupement d’êtres élémentaires ».
Que l’être humain, comme d’ailleurs tout être créé, soit essentiellement une idée d’œuvre à réaliser, cela est en correspondance directe avec le problème de la destinée, et, si ce problème se trouve actuellement dans le plan religieux et moral plutôt que dans le plan philosophique ou scientifique, cela n’enlève rien à son importance pour l’homme. Dans le même ordre de considérations, si c’est l’âme humaine que l’idée de l’œuvre à réaliser doit signifier, cette traduction exprime bien le principe formateur qu’il y a dans l’âme, ainsi que le caractère éthique de ce principe. Enfin, l’âme humaine apparaît ainsi comme une réalité objective, ayant la même existence positive qu’a l’idée de l’œuvre à réaliser dans une institution corporative.
Que l’âme humaine, interprétée en une idée d’œuvre à réaliser, possède à son service un pouvoir de volonté qui soit pour elle un organe de gouvernement pour la réalisation de sa destinée, c’est ce que la psychologie positive et la psycho-physique seraient mal venues à contester, elles pour qui le corps humain, avec son appareil nerveux et cérébral, constitue un organisme psycho-physique.
Sans doute, la psychologie positive n’en est pas encore à placer les manifestations psychiques du cerveau sous la dépendance d’une idée directrice qui serait une âme objective ; elle s’attarde à la conception purement verbale d’une synthèse mentale d’états de conscience élémentaires ; mais, d’une part, cette conception d’une synthèse mentale qui ne serait constituée autour d’aucun axe permanent est bien incapable d’expliquer la continuité de la personnalité humaine, d’autre part, c’est ici le lieu d’invoquer l’analogie tirée de la personnalité corporative dans laquelle se retrouve une idée directrice objective et réelle.
Sans doute, c’est interpréter en un sens vitaliste la célèbre « idée directrice » de Claude Bernard, et cela retentit jusque sur la biologie, mais, justement, le vitalisme a encore en biologie des partisans et puis le fait est là : projetée dans le plan social, dans la réalité du phénomène corporatif, l’idée directrice apparaît objective, c’est elle qui agit sur les adhérents, c’est sa mystique qui entraîne les foules.
Le plus difficile à admettre sera, sans doute, le troisième point, à savoir que l’être humain, étant une institution corporative et par conséquent contenant un groupe d’individualités élémentaires, des manifestations de communion se produiront en lui, dans le cadre de l’idée directrice, et que ces manifestations de communion correspondront à ce que nous appelons les états de conscience.
Observons, d’abord, le fait du groupement des psychismes élémentaires dans l’être humain, nous verrons ensuite si les états de conscience peuvent s’analyser en des crises de communion de ces psychismes élémentaires en une idée directrice.
Si nous limitons l’âme humaine, en tant que distincte du corps, à l’élément de l’idée directrice, si nous concédons que le corps est une organisation psycho-physique et, par conséquent, que les manifestations psychiques phénoménales relèvent de lui, rien n’empêche d’admettre que le système de ces manifestations psychiques soit de la nature des groupements. Cela est d’accord avec la donnée biologique de l’association des cellules nerveuses, qui, remarquons-le, dans l’être vivant sont toutes filles de la même mère ; cela est d’accord aussi avec la donnée psycho-physique de la pluralité des états de conscience et de leur synthèse, réserve faite du principe vitaliste de l’idée directrice. Comme la conduite des groupements ne va pas sans des tiraillements, et sans des manifestations contradictoires, l’hypothèse concorde aussi avec les constatations de l’introspection psychologique en ce qui concerne les conflits de la conscience, les luttes intérieures contre les instincts et les passions, les délibérations internes dans lesquelles il semble se dessiner une majorité et une minorité opposante, les revirements de la conscience, les conversions, etc. La psychologie avait d’abord situé ces mouvements contradictoires dans une âme qui, par ailleurs, semblait dénuée de complexité ; il paraît certes plus naturel de les situer dans les organes psycho-physiques de cette même âme.
Sans doute, l’âme, idée directrice, n’y reste pas étrangère, elle en subit les contrecoups, c’est au milieu de ces rumeurs qu’elle passe à l’état subjectif et réalise sa destinée, mais il n’est pas indifférent de savoir que son champ d’épreuve est psycho-physique et sous la dépendance du corps auquel elle est liée.
Ce corps étant essentiellement un groupement de psychismes élémentaires organisé autour d’une idée directrice, nous admettons que le fait de conscience consiste en une crise de communion entre tous les psychismes élémentaires du corps, au cours de laquelle l’idée directrice elle-même passe à l’état subjectif.
Cette hypothèse présente à la vérité un danger, elle semblerait lier l’existence du moi à celle de la communion des psychismes élémentaires du corps ; mais le danger n’est qu’apparent, ce lien n’est pas rigoureux puisque le sommeil interrompt des états de conscience sans interrompre la continuité du moi.
Nous retrouverons, d’ailleurs, plus loin le problème de la continuité subjective (B).
Ainsi, la personnalité individuelle peut être équipée en personnalité corporative et il nous est loisible de suivre, dans les deux à la fois, grâce à notre méthode comparative, les progrès du phénomène de l’intériorisation dans ses deux stades de l’incorporation et de la personnification.
Comme type de personnalité corporative nous prendrons celle de l’Etat.
L’Etat est incorporé lorsqu’il est parvenu au stade du gouvernement représentatif ; alors, un premier travail d’intériorisation est accompli en ce sens que les organes du gouvernement, avec leurs pouvoirs de volonté, agissent pour le bien commun dans le cadre de l’idée directrice de l’Etat. A ce stade, l’Etat possède une individualité objective, il devient pour le droit international une Puissance d’autant plus caractérisée que la nation fait corps avec son gouvernement ; non pas qu’elle manifeste de communion active avec lui, mais elle se laisse passivement conduire par lui. Un gouvernement représentatif de cette espèce peut ne comporter aucune liberté politique, c’est-à-dire aucune participation des citoyens au gouvernement par le mode électoral ou autrement, il peut être aristocratique, il sera représentatif, pourvu qu’il se tienne dans les directives de l’idée de l’Etat.
L’Etat est personnifié lorsqu’il est parvenu au stade de la liberté politique avec participation des citoyens au gouvernement ; alors, un second travail d’intériorisation s’est accompli en ce sens que, dans le cadre de l’idée directrice, se produisent maintenant des manifestations de communion des membres du groupe qui se mêlent aux décisions des organes du gouvernement représentatif (élections, délibérations d’assemblées, referendums, etc.). La personnification se produit parce que les manifestations de communion des membres du groupe sont des crises subjectives dans lesquelles l’idée directrice de l’Etat passe elle-même à l’état subjectif dans les consciences des sujets (Cf. mon travail Liberté politique et personnalité morale de l’Etat. Précis de droit constitutionnel, 2e appendice, 1923).
Il convient de noter que le stade de la personnification ne détruit pas les résultats de celui de l’incorporation ; la personnalité morale se surajoute à l’individualité objective du corps, mais celle-ci ne disparaît pas. Par exemple, le pouvoir de gouvernement, au stade de l’incorporation est minoritaire, celui du stade de la personnification est majoritaire, le premier est fortement exécutif, le second est fortement délibérant ; mais, en réalité, le pouvoir majoritaire et délibérant, qui marque à la fois l’avènement de la liberté politique et de la personnalité morale, se combinera avec le pouvoir minoritaire et exécutif qui reste l’apanage de l’individualité corporative.
Transportée dans la psychologie individuelle, la distinction des deux stades, des deux états et des deux modes de gouvernement que nous venons d’analyser n’est pas sans projeter quelque lumière sur notre vie intérieure. Il y a, de toute évidence, en nous, un gouvernement de conscience discursive et un gouvernement de conscience intuitive ; le gouvernement discursif nous dirige avec tout le fracas de la publicité dans l’état de veille, le gouvernement intuitif nous dirige sans bruit pendant notre sommeil et, d’une façon souterraine, dans l’état de veille lui-même.
Notre gouvernement discursif est celui de la personne morale, il est délibérant et majoritaire, il admet de la liberté politique interne, c’est-à-dire la participation des psychismes élémentaires au gouvernement. Cela sans doute dans une pensée d’équilibre et de contrôle d’un autre pouvoir de gouvernement. Quel est donc cet autre pouvoir de gouvernement ayant besoin d’être contrôlé ?
C’est ici que l’analogie corporative va devenir précieuse. Ce pouvoir intuitif qu’il s’agit de contrôler n’est pas d’ordre inférieur, ce n’est pas celui de l’instinct ; c’est, au contraire, un pouvoir supérieur et très noble, d’une très grande compétence et d’une très haute raison ; c’est le pouvoir minoritaire des meilleurs éléments psychiques de l’organisme, seulement ce conseil des Dix doit être contrôlé par la grande publicité de la conscience délibérante, parce que la raison elle-même a besoin d’être contrôlée, l’exécutif a besoin d’être empêché par un parlement, parfois les parlementaires ont besoin d’être empêchés par les huissiers de la Chambre.
C’est ce contrôle de la raison de l’élite par les psychismes élémentaires de la masse qui apporte la dernière touche à la responsabilité morale, suprême caractéristique de la personnalité.
B.
La réalité du développement historique de l’Etat dans son mouvement d’incorporation et de personnification, avec les analogies que cette évolution révèle dans la structure des personnalités individuelles et des corporatives, suffiront sans doute à persuader que la personnification des groupements est un phénomène naturel et spontané ; mais le problème de la réalité des personnes morales n’est pas l’objet direct de nos préoccupations, cet objet direct est l’explication de la durée et de la continuité réalisées dans les institutions par les phénomènes d’incorporation et de groupement ; il est par là même l’explication de la formation des institutions elles-mêmes, car, en somme, pourquoi une idée d’œuvre ou d’entreprise, pour mieux se réaliser et se perpétuer, a-t-elle besoin de s’incarner dans une institution corporative plutôt que de rester à l’état libre dans un milieu social donné ?
La solution de ce problème fondamental ne peut être dégagée qu’en distinguant le stade de l’incorporation et celui de la personnification et en observant, dans chacun d’eux, la façon dont la continuité de l’action de l’idée directrice est obtenue.
1° Dans le stade de l’incorporation, il ne peut s’agir que d’une continuité purement objective de l’idée et de son action parce que, par hypothèse, nous admettons qu’il ne se produit encore aucune manifestation de communion intéressant tous les membres du groupe. De l’histoire si instructive de la formation coutumière de l’Etat, où nous voyons la période de l’incorporation se prolonger pendant des siècles avant que n’apparaisse une personnalité morale, il résulte que la continuité qui s’établit d’abord est celle d’un pouvoir minoritaire et qu’elle est très précaire. En France, le pouvoir des premiers Capétiens était viager, les privilèges que le roi régnant avait consentis, c’est-à-dire les situations juridiques qu’il avait créées autour de son trône et qui ne demandaient qu’à durer, pouvaient être révoqués par son successeur et avaient besoin d’être confirmés par lui ; la pratique de l’association au trône, suivie pendant deux siècles, avait apporté un premier palliatif en ce que le prince associé du vivant de son père était obligé de confirmer les privilèges, tout au moins au profit des bénéficiaires qui avaient approuvé son association ; lorsque le principe de l’hérédité fut acquis et assura la transmission régulière du pouvoir, la continuité juridique des situations établies sur ce pouvoir ne fut pas pour cela assurée ; des confirmations restèrent nécessaires, aux changements de règne, et ne furent pas toujours accordées parce que le prince héritier se considérait comme absolument maître.
C’est alors que les légistes imaginèrent le principe de la légitimité, c’est-à-dire accréditèrent l’idée que la dévolution du pouvoir à la mort du roi ne s’opérait pas jure successionis, mais en vertu d’une loi fondamentale du royaume ; ainsi le prince accédant au trône recevait son pouvoir de la loi avec toutes les charges dont il était régulièrement grevé et il ne pouvait se conduire envers les situations établies avec la même liberté que s’il avait été une sorte d’héritier propriétaire. Cette lex regia n’est ici qu’une forme prise par l’idée directrice de l’Etat, qui sert ainsi d’appui extérieur au pouvoir, mais inversement, ce long et persévérant travail des légistes pour obtenir la continuité du pouvoir et de l’action du pouvoir, à l’intérieur de l’institution du royaume, révèle assez l’importance de cette action du pouvoir organisé pour la réalisation de l’idée directrice de l’Etat et pour la continuité dans cette réalisation. C’est le pouvoir organisé seul qui peut créer des situations juridiques et lui seul peut les maintenir ; or, la réalisation sociale d’une idée d’œuvre ou d’entreprise ne peut être obtenue sans que soient créées et maintenues des situations juridiques en elle et autour d’elle. L’incorporation de l’idée directrice dans une institution lui assure donc, grâce à la continuité d’action du pouvoir organisé qui en découle, l’établissement et le maintien d’un ensemble de situations juridiques au milieu desquelles il lui est extrêmement avantageux de se mouvoir.
2° Le stade de la personnification ouvre de nouvelles perspectives en ce qui concerne la continuité de l’action de l’idée directrice, parce que cette idée passe à l’état subjectif à l’intérieur de l’institution. D’abord on peut se demander comment s’établit la continuité d’une action subjective de l’idée directrice, ensuite, quels sont les résultats de cette activité.
La continuité d’une action subjective de l’idée directrice à l’intérieur de l’institution corporative ne saurait être établie qu’en partant de la donnée des manifestations de communion des membres du groupe, que nous avons reconnu être des crises dans lesquelles l’idée directrice passait à l’état subjectif dans les volontés conscientes des membres ; mais, tout de suite, se dresse une objection qui paraît dirimante, les manifestations de communion des membres d’un groupement corporatif s’affirment très discontinues.
C’est un chapelet de manifestations sporadiques, périodiques tout au plus, une succession de consultations électorales, de délibérations d’assemblées, de réunions publiques. Ces moments, très brefs, sont séparés par de longs intervalles, éclairs rapides qui s’éteignent dans la nuit.
Il faudrait, cependant, pour que l’idée directrice devînt le sujet de la corporation personne morale, qu’elle pût être considérée comme étant à l’état subjectif d’une façon continue. Le sujet moral nous apparaît comme continu dans la personne individuelle, malgré que la psychologie positive analyse les états de conscience en unités discontinues, malgré aussi les interruptions de la conscience occasionnées par le sommeil et les syncopes. Il y a à trouver une explication qui permette de passer du phénoménisme discontinu des états de conscience à une continuité du sujet affirmée par notre sens intime.
Cette explication ne peut pas être tirée du fait que la série mobiliforme des états de conscience serait liée par l’idée directrice en tant qu’objective, car ce ne serait pas une continuité dans le subjectif. Mais elle peut être tirée de l’action du pouvoir inclus dans tous les actes de volonté consciente où l’idée directrice est passée à l’état subjectif ; rétroagissant dans le passé comme il anticipe sur l’avenir, le pouvoir jette des ponts entre chacun des états de conscience, à la façon de ces soufflets qui, jetés entre les voitures, rétablissent la continuité trépidante d’un rapide.
Dans tout acte de volonté consciente, il y a un pouvoir inclus. En tout cas, il y en a dans les manifestations de communion des membres d’un groupement corporatif, soit que le pouvoir exécutif y intervienne, soit qu’un pouvoir délibérant majoritaire s’y dégage. L’action de ce pouvoir peut rétroagir en ce sens qu’elle peut régler les conséquences actuelles de situations créées dans le passé, elle peut anticiper sur l’avenir en ce sens qu’elle peut régler des situations qui se créeront dans le futur. La loi, œuvre subjective d’un pouvoir délibérant majoritaire, se définit une règle générale, en ce sens qu’elle règle l’avenir à perpétuité jusqu’à ce qu’elle soit abrogée ou modifiée.
A envisager cette élasticité du pouvoir qui prolonge l’effet d’une manifestation subjective de volonté jusqu’à ce qu’il rejoigne la manifestation suivante et qui, par-là, réalise une continuité subjective, on conçoit que les Allemands aient tenté de faire de la Puissance de volonté (Willensmacht) le sujet de la personne morale. Cependant leur thèse est erronée par ce que la Puissance de volonté malgré son élasticité n’assurerait pas la soudure des manifestations de volonté si elle n’était au service d’une idée directrice, car dans quelle direction assurerait-elle la continuité ? Il s’agit de la continuité d’une trajectoire et l’idée directrice seule peut, en se déterminant elle-même comme subjective, afin de s’insérer dans les actes de volonté, déterminer, par son propre dynamisme, la courbe de cette trajectoire. Le véritable sujet de la personne morale reste donc bien l’idée directrice de l’œuvre, dont le passage à l’état subjectif dans les consciences des membres du groupe est assuré, tant par les manifestations de communion, que par les projections des tentacules du pouvoir qui relient celles-ci entre elles, pouvoir dont une part est dans la volonté des organes, mais dont une part aussi est dans l’idée directrice elle-même[1] [2].
Ainsi, au stade de la personnification, l’institution corporative surajoute à la continuité de l’idée à l’état objectif, déjà réalisée au stade de l’incorporation, la continuité de la même idée à l’état subjectif. Quel bénéfice l’idée directrice va-t-elle retirer de cette nouvelle forme de continuité ? Elle en retire, ce nous semble, un triple bénéfice : celui de pouvoir s’exprimer, celui de pouvoir s’obliger, celui de pouvoir être responsable.
a) L’idée directrice de toute entreprise tend à s’exprimer subjectivement ; elle s’exprime d’abord dans toute institution par des règles de droit disciplinaire ou statutaire que, pour ainsi dire, elle sécrète. Sans doute, ces règles de droit s’objectivent rapidement, mais, au moment de leur émission, elles sont bien réellement des volontés subjectives du législateur qui parle au nom de l’institution. Sans doute, aussi, et cela est plus grave, les règles de droit n’ont point pour objet direct d’exprimer le contenu positif de l’idée directrice de l’institution. Quelles sont les lois de l’Etat qui expriment de façon directe le contenu positif de l’idée de l’Etat ? Ainsi que nous l’avons déjà observé, les règles de droit sont essentiellement des limites, elles ne dessinent que les contours des choses, mais il arrive qu’indirectement, par le dessin des contours, le contenu positif soit cependant, dans une certaine mesure, déterminé. Cette conséquence se produit surtout en ce qui concerne les règles statutaires et constitutionnelles.
Mais les formes les plus hautes selon lesquelles l’idée directrice d’une institution tend à s’exprimer subjectivement en celle-ci ne sont pas proprement juridiques ; elles sont morales ou intellectuelles, ou, si elles deviennent juridiques, c’est en qualité de principes supérieurs du droit.
C’est ainsi, par exemple, que dans la crise révolutionnaire de la fin du dix-huitième siècle ont jailli en Amérique, puis en France, les déclarations des droits qui expriment le tréfonds de l’idée de l’Etat moderne en ce qui concerne l’ordre individualiste que l’Etat a mission de protéger dans la société, et qui sont restées « les principes du droit public des Français ». Ainsi se définit progressivement l’essence en grande partie indéterminée de l’idée directrice de l’Etat.
Un exemple plus significatif encore peut être tiré de l’histoire de l’Eglise. L’idée chrétienne, lancée dans le monde pour le renouveler par la rédemption, contenait, même après le message du Christ, une grande part d’indétermination. Il est fort instructif d’examiner, dans l’œuvre de détermination progressive du contenu de l’idée et surtout dans le maintien de la continuité de l’idée au travers des déterminations successives, la part qui revient au fait que l’idée chrétienne s’est incorporée dans l’institution de l’Eglise chrétienne. C’est l’histoire de l’Eglise et du dogme ; ici, l’idée religieuse se détermine et s’exprime en des symboles, parce que le fond de toute idée religieuse est la foi. En quoi la continuité corporative de l’Eglise a-t-elle pu faciliter la continuité du développement du dogme dans le sens véritable de l’idée directrice ?
L’idée chrétienne, une fois lancée dans le monde, ne pouvait-elle pas y cheminer seule en liberté et à l’état de vérité objective ? Le malheur est que les idées objectives ne sont perçues par les hommes qu’au travers de concepts subjectifs, si bien que la Révélation, abandonnée à elle-même, menaçait de sombrer dans l’océan des interprétations subjectives et des hérésies. L’institution de l’Eglise, et les manifestations de communion qui se produisent de mille manières dans le sein de l’institution et qui sont réglées par le gouvernement de celle-ci, ont permis la détermination d’une interprétation subjective commune et officielle de la vérité révélée. C’est cette interprétation subjective officielle qui constitue le dogme et le symbole, elle n’épuise pas le contenu de l’idée objective puisqu’il subsiste des mystères, mais elle renferme la plus forte garantie de l’exacte approximation de ce contenu en même temps que de la continuité de son action.
Cela revient à dire qu’une action gouvernementale équilibrée par une communion de fidèles est une garantie de continuité, dans l’interprétation subjective de l’idée directrice, très supérieure à ce que serait celle de la libre interprétation individuelle.
b) En second lieu, la continuité subjective de l’idée permet à l’institution de s’obliger. Il serait hors de propos d’entrer ici dans des développements juridiques sur les conséquences de la capacité de s’obliger. Bornons-nous à constater que la personnalité subjective de l’Etat s’est affirmée à l’occasion de la dette publique et que la continuité de cette dette a pu ainsi être étendue jusqu’à la perpétuité, permettant d’établir, entre les générations successives, une impressionnante solidarité. Constatons aussi qu’à cette capacité de s’obliger a correspondu la faculté, pour l’Etat, d’utiliser les ressources énormes du crédit. Les mêmes bienfaits de la capacité de s’obliger se font sentir pour toutes les institutions corporatives personnifiées.
c) Enfin, la continuité subjective de l’idée et la personnalité morale font entrer l’institution corporative dans le domaine de la responsabilité subjective, qui est la contrepartie de la liberté. Il y aurait, là aussi, des développements juridiques à fournir, particulièrement sur l’application à l’Etat et aux institutions corporatives des principes de la responsabilité pour faute. Malgré l’intérêt de ces développements, nous nous bornons à marquer le point, c’est-à-dire à constater que cette application existe.
Au total, la continuité subjective de la personnalité morale complète et enrichit singulièrement les effets de la continuité objective du corps constitué ; la personnification parachève l’incorporation ; l’une et l’autre assurent d’une façon puissante la réalisation de l’idée objective dans le milieu social.
II.
Après l’anatomie des institutions corporatives, abordons leur physiologie, voyons-les vivre, observons leur naissance, leur existence et leur mort, et mettons en évidence leur réalité juridique en tous les moments.
I. La naissance des institutions corporatives se produit dans une opération de fondation.
Il y a lieu de distinguer les fondations par opération formelle et celles par opération coutumière ; comme les éléments des opérations formelles sont plus apparents, mieux vaut s’attacher à celles-ci. Il y en a deux modalités, celle par volonté isolée d’un seul individu et celle par volonté commune de plusieurs individus ; la première engendre des institutions de la catégorie des établissements (hôpitaux, hospices, etc.), dans lesquelles il n’y a point de groupe permanent de membres qui puissent perpétuer la fondation, et où cet élément est remplacé par celui d’un patrimoine affecté ; la seconde engendre, d’ordinaire, des institutions de la catégorie des corporations ou universitates, dans lesquelles subsiste un groupe permanent de membres perpétuant la fondation.
Nous n’aurons à nous occuper que des fondations par volonté commune, engendrant des institutions corporatives.
Le champ d’action des
opérations de fondation est plus étendu qu’on ne le croit généralement, parce
qu’il y a beaucoup de fondations masquées par d’autres opérations auxquelles
elles sont mêlées. C’est ainsi que, toutes les fois que d’un contrat, d’un
pacte, d’un traité, résulte la création d’un corps constitué quelconque, il
convient d’admettre qu’une opération de fondation s’est mêlée à l’opération
contractuelle. Si la société de commerce par actions donne naissance à un corps
constitué, c’est que ses statuts, malgré leur apparence contractuelle,
contiennent une fondation, car le contrat par
lui-même ne saurait engendrer que des obligations entre les associés, ainsi qu’il
en est dans la société civile. Lorsque Waldeck-Rousseau
déposa son projet de loi sur les associations, celles-ci devaient être de pures
sociétés contractuelles sans aucun caractère corporatif, mais ce projet, en
devenant la loi du 1er juillet 1901, fut transformé en ce qu’il se
glissa dans le contrat une opération de fondation. En matière internationale,
des Etats sont créés par des traités, bien que ceux-ci soient des contrats,
pour la même raison, parce qu’il se glisse dans le contrat une opération
fondative de la part des Etats fondateurs. (Etats créés par les traités de paix
de 1919 et 1920 par la volonté fondative des grandes puissances alliées.)
L’opération de fondation
par volonté commune se compose des éléments suivants :
1° la manifestation de volonté commune avec intention de fonder ; 2° la
rédaction des statuts ; 3° l’organisation de fait de l’institution
corporative ; 4° la reconnaissance de sa personnalité juridique.
La manifestation de volonté commune avec intention de fonder constitue, de beaucoup, l’élément le plus important, elle est le facteur consensuel et, par conséquent, le fondement juridique, non seulement de l’opération de fondation, mais de l’existence même du corps constitué, puisque celle-ci s’explique par la fondation continuée. Comme nous ne prétendons point ici à des explications juridiques complètes, nous ne traiterons que de cet élément.
La manifestation de
volonté commune, avec intention de fonder, suppose des déclarations de volonté
multiples émanant de chacun des membres du groupe
fondateur ; elles peuvent être émises simultanément, comme aussi elles
peuvent l’être séparément, par intervalles ; elles contiennent une volonté
commune, qui est celle de fonder une certaine œuvre ou entreprise dont l’idée directrice
est connue des fondateurs. Ces manifestations de volonté, ainsi faites en
communion, forment un faisceau consensuel qui produit l’effet juridique voulu,
c’est-à-dire qui opère juridiquement la fondation. Il y a deux choses à
expliquer : l’effet juridique de fondation et la formation du faisceau
consensuel.
L’effet juridique de fondation demande explication, aussi bien dans la fondation par volonté isolée que dans celle par volonté commune : comment des volontés individuelles peuvent-elles engendrer un corps social ? Il y a ici une disproportion entre la cause et l’effet qui surprend : la durée de l’institution dépassera de beaucoup la longévité des fondateurs et de leurs volontés. Il faut réfléchir que l’organisation en un corps social et la durée de l’institution ne sont pas uniquement imputables à la volonté des fondateurs primitifs, ils le sont aussi à la vertu propre de l’idée directrice de l’institution fondée ; elle ne cessera d’attirer à soi de nouveaux adhérents qui seront de nouveaux fondateurs en ce qu’ils continueront la fondation, à mesure qu’elle s’objectivera dans le milieu social. Les fondateurs primitifs semblent avoir fait plus qu’ils ne pouvaient parce qu’ils ont planté dans le milieu social une idée vivante qui, une fois plantée, s’y développe par elle-même. Ils n’ont pas fait autre chose que ce que font tous les jours les propriétaires planteurs de vignes ou de forêts qui certainement leur survivront et dont la valeur, grâce à la collaboration de la terre, deviendra singulièrement disproportionnée à leur effort. La justification de la liberté individuelle de fondation est du même ordre que celle du droit de propriété : on a le droit d’utiliser la collaboration spontanée du milieu social comme on a celui d’utiliser la collaboration de la terre. C’est pour des raisons politiques que l’Etat se montre trop souvent hostile à la liberté de fondation, il redoute la concurrence des corps spontanés ; nous n’avons pas le loisir d’entrer dans cet ordre de considérations.
La formation du faisceau des consentements dans la fondation par volonté commune, qui assure l’unité consensuelle de l’opération, demandera de plus longs développements. Trois facteurs concourent à la formation de ce faisceau : 1° l’unité dans l’objet des consentements ; 2° l’action d’un pouvoir ; 3° le lien d’une procédure.
L’unité dans l’objet des consentements est réalisée par l’idée de l’œuvre, puisque c’est elle qui est l’objet et qu’elle est une ; nous avons assez insisté sur la force d’attraction de cet objet. Il ne faudrait pas croire, cependant, que cette attraction soit suffisante et qu’ainsi les manifestations de volonté, avec intention de fonder, soient entièrement volontaires. C’est l’erreur dans laquelle tombent les auteurs allemands quand ils analysent la Vereinbarung, qui n’est pas autre chose que ce que nous appellerons volontiers la communion fondative, en un faisceau de consentements parallèles déterminés par la seule identité d’objet.
C’est toujours l’erreur contrat social et, en ce sens, le contrat social de Rousseau était déjà une Vereinbarung, car les contractants n’échangeaient point des consentements différents, mais émettaient des consentements parallèles ayant tous le même objet.
La vérité est que la formation du faisceau des consentements parallèles est pour partie l’œuvre d’un pouvoir et que le liber volui y est fortement nuancé de coactus volui.
Dans la fondation de l’Etat, qui se répète sous nos yeux à chaque révision de la constitution, l’action du pouvoir politique est évidente : d’abord, ce sont, de plus en plus, des organes gouvernementaux qui procèdent à la révision, de plus, ils y obéissent à une majorité politique. Dans la fondation des corporations particulières, associations, syndicats, sociétés anonymes, interviennent des délibérations d’assemblée générale des membres qui sont prises à une majorité déterminée et non pas à l’unanimité ; sans doute, les dissidents peuvent se retirer de l’entreprise, mais mille considérations les en empêchent en fait, et ces considérations signifient qu’une contrainte morale pèse sur eux. D’ailleurs, c’est un fait que, lors de la fondation d’une institution particulière, l’initiative est prise par un ou plusieurs meneurs qui s’emploient à faire jouer toutes sortes d’influences et qu’il est beaucoup de personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas refuser leur adhésion. L’intervention de l’élément pouvoir produit ici un double effet.
D’abord, il unifie les consentements ; même lorsque le pouvoir se manifeste par un vote majoritaire d’assemblée, on voit la minorité opposante accepter, contrainte et forcée, la décision de la majorité par le seul fait que ses membres ne se retirent pas de l’institution ensuite, les décisions prises présentent ce caractère de valoir par elles-mêmes juridiquement, ce qui est la marque des actes du pouvoir. Il en faut tirer cette conclusion que la « communion fondative » est une opération du pouvoir autant qu’une opération consensuelle, et que les fondateurs exercent un pouvoir. D’ailleurs, la fondation par volonté isolée est très nettement l’opération d’un pouvoir individuel analogue à celui du testateur, la liberté de fondation est un pouvoir privé, ce qui explique un peu les hésitations avec lesquelles l’Etat en admet l’existence.
A l’unité d’objet, à l’action d’un pouvoir, vient s’ajouter le lien d’une procédure. Ceci est l’élément formel extérieur nécessaire pour que l’opération fondative, malgré sa complexité et la succession de ses moments, obtienne l’unité d’un acte juridique. Les éléments internes de l’unité d’objet et de l’action du pouvoir n’y suffiraient pas. Du moment que les adhésions peuvent être successives, que des formalités variées peuvent s’échelonner, comme, par exemple, le versement du quart du capital souscrit, comme la vérification des apports, dans les sociétés anonymes, comme les réunions répétées d’assemblées, il faut que ces événements multipliés soient reliés par une procédure. Pour la période fondative des sociétés anonymes, cette procédure est prévue par la loi. Dans une brochure de 1906 intitulée « L’institution et le droit statutaire », d’ailleurs fort imparfaite, j’avais insisté sur le caractère « d’opération à procédure » que présente la fondation des institutions. Je n’insisterai pas davantage ici sur cet aspect du sujet.
De nouvelles précisions sollicitent maintenant notre attention. La fondation est une opération subjective ; les institutions corporatives naissent dans une crise de communion des volontés fondatives, au cours de laquelle l’idée de l’œuvre passe à l’état subjectif dans les consciences des adhérents ; aux développements que nous avons déjà fournis sur ce point nous avons à ajouter ceci : on peut conclure de cette crise subjective que la personnalité morale de l’institution naît en même temps que son organisation corporative, mais il serait excessif d’en conclure qu’elle précède et explique celle-ci. C’est l’erreur que commettent les partisans du système ultra subjectiviste quand ils expliquent la constitution de l’Etat par la volonté de la personne morale, et c’est aussi celle des commercialistes qui expliquent toute la procédure de fondation des sociétés anonymes par la volonté de personne morale de la société naissante.
Ces erreurs cachent une vérité, à savoir que l’idée de l’œuvre ou de l’entreprise existe dès le début et que c’est bien son levain qui fait lever la pâte, mais, dans ces débuts, elle ne peut encore être équipée en personne morale parce qu’elle n’a pas d’organes. En d’autres termes, il y a pétition de principe à croire que les organes d’une personne morale soient créés par la volonté de celle-ci, attendu que, jusqu’à ce qu’une personne morale ait des organes, elle n’a point de volonté.
La vérité est que l’organisation de la personne morale est créée du dehors par des fondateurs ; la crise de la fondation est subjective a parte condentium seulement ; lorsque la personne morale sera créée et qu’il s’agira de son gouvernement, alors les crises de communion auxquelles donnera lieu ce gouvernement seront subjectives a parte personæ conditæ.
S’il en était autrement, il n’y aurait point de différence entre le pouvoir constituant et le pouvoir gouvernemental.
II. En tout cas, la naissance des institutions corporatives résulte d’une opération juridique ; leur vie quotidienne va-t-elle donner lieu à des opérations du même ordre ?
La réponse ne fait pas doute, tous les actes par lesquels une institution corporative assure sa vie, délibérations d’assemblée, décisions de conseil d’administration, décisions du directeur, présentent un caractère juridique ; dans les institutions privées, ce caractère juridique est tiré des statuts ou du contrat d’association, et l’action en nullité de ces actes, s’il v a lieu, est statutaire ou contractuelle ; dans les institutions publiques et, notamment, dans l’Etat, le caractère juridique des décisions par lesquelles sont assurées la marche du gouvernement et celle de l’administration est tiré du pouvoir ; elles valent par le pouvoir qui les a prises et, en France, leur nullité est poursuivie par une action parfaitement adéquate, qui est le recours pour excès de pouvoir. L’analyse du droit public est ici plus exacte que celle du droit privé. Partout, même dans les corporations du droit privé, les décisions sont dues à un pouvoir ; elles mériteraient d’être isolées comme manifestations d’un pouvoir de décision et d’être soumises à la possibilité d’une sorte de recours pour excès de pouvoir.
III.
Bien que les institutions corporatives soient faites pour durer longtemps, elles sont périssables comme toutes les existences ; quelquefois leur mort est causée par des raisons internes de mauvaise organisation ou d’usure de l’idée, souvent aussi elle l’est par des accidents extérieurs, désaffection ou hostilité du milieu social. Cette mort se présente, en principe, sous forme d’acte juridique : ou bien les institutions sont supprimées par un pouvoir extérieur, tel le partage de l’Etat polonais au dix-huitième siècle, en vertu d’ententes entre la Prusse, l’Autriche et la Russie, telle encore la suppression, par des lois révolutionnaires, des corps et communautés de la France de l’ancien régime, ou la suppression et la liquidation des congrégations religieuses non autorisées en vertu de la loi du 1er juillet 1901 ; ou bien les institutions se dissolvent d’elles-mêmes par une délibération de l’assemblée générale de leurs membres.
Ces suppressions ou dissolutions entraînent des conséquences juridiques en ce qui concerne la liquidation des biens. L’idée corporative a fait de grands progrès dans ce domaine depuis un siècle ; au début du dix-neuvième siècle, on n’hésitait pas à décider que les biens d’une institution corporative supprimée appartenaient à l’Etat et ce, en vertu des articles 539 et 713 du Code civil, sur l’attribution des biens sans maître ; actuellement, on admet que les statuts de l’institution puissent régler eux-mêmes le sort des biens, en cas de dissolution ou de suppression, ou qu’ils puissent confier à une assemblée générale des membres le soin de régler cette destination. Ainsi l’institution est admise à faire une sorte de testament juridique.
Ces brèves indications suffisent à notre dessein, qui est simplement de faire toucher du doigt le caractère profondément juridique de la naissance, de la vie et de la mort des institutions et non point d’aligner des détails complets sur chacun des actes du drame.
III.
Des développements assez complexes qui précèdent, on pourrait tirer des conclusions nombreuses.
Nous nous bornerons à trois, dont l’une concernera le fondement de la continuité dans la société, dans l’Etat et dans le droit, dont la seconde concernera la réalité de la personnalité morale et de la personnalité juridique, et dont la troisième concernera le rôle secondaire de la règle de droit.
I.
C’est bien du côté des institutions corporatives, dont fait partie l’Etat, et du côté de l’opération de fondation de ces institutions, que doit être cherché le fondement de la continuité dans les choses sociales. Les institutions corporatives, tant qu’elles vivent, et qu’elles assurent en elles et autour d’elles la continuité de leur idée directrice et de son action, tant d’une façon objective que d’une façon subjective, soutiennent et maintiennent autour d’elles, par leur pouvoir, toutes les situations juridiques qui doivent durer. Comme elles-mêmes doivent l’existence à une opération de fondation qui se répète et se continue, c’est à l’amalgame des trois éléments de l’opération de fondation : l’idée directrice, le pouvoir, les manifestations de communion consensuelles, éléments qui se retrouvent dans l’institution elle-même, que sont dues la durée et la continuité. On peut établir les équations suivantes : 1° continuité égale institution et fondation ; 2° institution et fondation égalent : idée directrice, pouvoir, communion consensuelle.
II.
Chemin faisant, nous avons constaté la réalité des personnes morales en observant le caractère naturel des phénomènes d’incorporation et de personnification des institutions ; la portée de cette première observation a été renforcée par cette seconde, à savoir que, si l’incorporation réalisait pour l’idée directrice de l’institution une continuité objective, la personnification réalisait à son tour une continuité subjective de cette même idée, dont les effets venaient s’ajouter. Il paraît impossible de pousser plus loin la démonstration de la réalité de la personnalité morale et, quant à celle de la personnalité juridique, elle en découle, car elle n’est qu’une retouche et une stylisation de la personnalité morale et, par conséquent, elle repose sur le même fond de réalité.
III.
Enfin le rôle secondaire de la règle de droit dans l’ensemble du système juridique me paraît résulter de ces développements. Le fait significatif que nous avons signalé plus haut, à savoir que les règles de droit, en tant qu’idées directrices, n’ont pas assez de vie pour organiser autour d’elles une corporation qui leur soit propre et en laquelle elles s’expriment, prouve assez qu’elles sont inférieures aux idées directrices qui ont eu assez de vie pour s’incorporer.
Cette comparaison saisissante ramène notre attention vers cette vérité, vieille comme le monde, que les éléments importants, dans le système juridique, ce sont les acteurs juridiques, les individus d’une part, les institutions corporatives de l’autre, parce qu’ils sont les personnages vivants et créateurs, tant par les idées d’entreprise qu’ils représentent, que par leur pouvoir de réalisation ; quant aux règles de droit, elles ne représentent que des idées de limite au lieu d’incarner des idées d’entreprise et de création.
Dans un monde qui veut vivre et agir, tout en conciliant l’action avec la continuité et la durée, les institutions corporatives, de même que les individus, sont au premier plan, parce qu’ils représentent à la fois l’action et la continuité ; les règles de droit au second, parce que, si elles représentent de la continuité, en revanche, elles ne représentent pas de l’action.
L’erreur de Léon Duguit, quand il a édifié son système de droit objectif, a été de miser sur le droit objectif, a été de miser sur la règle de droit. Le véritable élément objectif du système juridique c’est l’institution ; il est vrai qu’elle contient un germe subjectif qui se développe par le phénomène de la personnification ; mais l’élément objectif subsiste dans le corpus de l’institution et ce seul corpus, avec son idée directrice et son pouvoir organisé, est très supérieur en vertu juridique à la règle de droit. Ce sont les institutions qui font les règles de droit, ce ne sont pas les règles de droit qui font les institutions.
Réduisons aux plus justes proportions la portée de ce mémoire. Il est intitulé « essai de vitalisme social » et c’est là toute sa prétention. Les idées directrices, d’une objectivité saisissable puisqu’elles passent d’un esprit à un autre sans perdre leur identité et par leur propre attraction, sont le principe vital des institutions sociales, elles leur communiquent une vie propre séparable de celle des individus, dans la mesure où les idées elles-mêmes sont séparables de nos esprits et réagissent sur eux.
Nous n’allons pas au-delà de la constatation de ce phénomène ; nous nous interdisons de rechercher si, à l’objectivité phénoménale des idées, correspond une réalité spirituelle substantielle ; il serait, certes, important de le savoir, car certaines idées pourraient avoir plus de réalité que les autres et être aussi plus proches de la vérité.
Cette recherche du réel substantiel est du ressort des philosophes. Depuis Georges Dumesnil, dont la thèse sur le Rôle des concepts remonte à plus de trente ans, il en est qui travaillent le problème du réalisme des idées sur de nouvelles données.
Nous attendons d’eux la
construction métaphysique de cette physique qu’est le vitalisme des institutions sociales (V. Jacques Chevalier, L’idéalisme français au dix-septième siècle,
Annales de l’Université de Grenoble, 1923).
Présentation de l’article
« La théorie de l’Institution
& de la Fondation (essai de Vitalisme social) »
Julia Schmitz
Docteure en droit public,
Université Toulouse I Capitole, Institut Maurice Hauriou
& M. le pr. Jean-Gabriel Sorbara,
Université Toulouse I Capitole,
Institut M. Hauriou
C’est par cette synthèse écrite en 1925 que le doyen Hauriou nous présente la construction théorique à laquelle il est parvenu au terme d’une longue réflexion et qui constitue l’axe central de sa pensée juridique. La théorie de l’institution constitue en effet le fil rouge de son œuvre, en maturation dès ses premiers écrits sur l’histoire du droit et la science sociale, formalisée dans un article de 1906, systématisée comme une théorie générale du droit et de l’Etat dans ses deux éditions des Principes de droit public de 1910 et 1916, parachevée dans la dernière édition de son Précis de droit constitutionnel[3]. La cohérence de nombre de ses conceptualisations, comme la gestion administrative, la décision exécutoire, la puissance publique, la souveraineté de gouvernement et de sujétion ou encore la personnalité morale, est révélée par cette théorie.
Objet d’interprétations contradictoires, elle semble relever d’une hésitation ou plutôt d’une « oscillation » théorique[4]. Elle est en effet traversée d’influences multiples et se situe dans un contexte historique particulier pour la science juridique, tiraillée, au tournant du XXe siècle, entre des paradigmes scientifiques contradictoires : le positivisme scientifique et l’idéalisme. Hauriou apparaît à la fois comme un juriste sociologue, fondant son étude du droit sur l’observation de la matière sociale, et un juriste spiritualiste analysant le droit à travers un prisme de valeurs transcendantes.
Tout en étant pénétrée de perspectives contradictoires, la théorie de l’institution offre une rupture méthodologique et une ouverture doctrinale. Elle repose sur une démarche critique que Hauriou qualifie de vitaliste, s’épanouissant dans une théorie du droit public. La théorie de l’institution peut ainsi être identifiée par ce qu’elle rejette et déconstruit en mettant en œuvre une nouvelle méthode d’analyse du phénomène juridique (I). Sa pertinence et son originalité se mesurent au regard de ce qu’elle propose pour la science juridique, à savoir une nouvelle théorie du droit et de l’Etat (II).
I. La théorie de l’institution : méthode critique de la science juridique
La théorie institutionnelle consiste en premier lieu à adopter une nouvelle méthode d’analyse, permettant d’aller « au fond des choses » [p. 147]. Méthode d’exploration du phénomène juridique, elle recherche ses fondements véritables, pour le saisir dans son intégralité et son mouvement. Elle met en œuvre une méthode particulière, à la fois plurielle, utilisant les sciences historique, sociologique ou psychologique, et temporelle, réalisant une généalogie du phénomène juridique. L’invitation à la pluridisciplinarité en fait une entreprise réaliste, à la recherche des fondements sociaux et historiques du phénomène juridique pour ne pas reléguer « hors du droit les fondements du droit » (p. 151).
Les institutions juridiques étant de la « catégorie du réel »[p. 147], elle rejette les théories du contrat social qui fondent le collectif sur un lien fictif et consensuel. Elle tient ainsi compte de l’élément du pouvoir, omniprésent dans la société, qui n’est pas la force pure nous dit Hauriou, mais un pouvoir de domination accepté. En effet, l’institution est la réalisation d’une idée d’œuvre par un pouvoir de gouvernement organisé, lequel est une énergie d’entreprise, l’élément moteur du processus institutionnel. La théorie de l’institution est aussi une démarche objectiviste, rejetant les théories subjectivistes qui enferment le droit dans les manifestations de la volonté individuelle et en font un produit de la volonté de la personnalité juridique étatique. Contre cette identification, Hauriou constate que la coutume ne peut être identifiée comme le produit de la volonté de l’Etat et rappelle que ce dernier, en tant qu’organisation collective du pouvoir, n’a pas toujours existé pour générer le droit. Mais la théorie de l’institution n’adhère pas non plus à l’objectivisme absolu de Duguit qui fait de la règle de droit objective issue du milieu social, le centre générateur du phénomène juridique. Plus précisément, la méthode institutionnelle ouvre une perspective dialectique, tenant compte de la présence simultanée du droit subjectif, composé de la personnalité juridique, des droits subjectifs et des actes juridiques, et du droit objectif composé de la « masse des lois, des règlements et des coutumes » [p. 148].
Pour parvenir à cette dialectique, Hauriou fait appel à la psychologie pour expliquer que les situations juridiques générées par le phénomène institutionnel sont des objets qui « habitent en nous » [p. 148]. La volonté consciente produit le droit subjectif, l’inconscient est le siège du maintien du droit objectif. Le phénomène juridique est donc un phénomène complexe, passant par différents états, à la fois objectifs et subjectifs. Et l’institution corporative, matrice du phénomène juridique est ainsi un corpus « psycho-physique » [p. 153], donnant lieu à des phénomènes d’incorporation et de personnification, liés à la réalisation d’une idée d’œuvre. C’est l’idée directrice de l’institution qui lui fournit une individualité et une continuité objectives lui permettant de durer dans le milieu social et les consciences individuelles. En faisant de l’idée l’objet et le sujet des institutions, Hauriou donne à sa théorie une dimension jusnaturaliste, fondée sur l’idéalisme platonicien et le dogme chrétien. Les idées ont en effet selon lui un caractère foncièrement objectif, puisqu’« il n’y a pas de créateurs d’idée, il y a seulement des trouveurs » [p. 155] et sont capables de provoquer l’action des individus. Mais il semble également initier une analyse plus réaliste de la représentation des rapports sociaux. L’idée d’œuvre, produit des représentations mentales individuelles et collectives, peut désigner ce que nous appelons aujourd’hui une idéologie ou une représentation symbolique, ce que Hauriou appelle « une mystique qui entraine les foules » (p. 160).
D’ailleurs, il entendait bien fonder une « Ecole du droit représentative », puisque le phénomène juridique, dit-il, ne nous est intelligible que par « l’intermédiaire des concepts qui se présentent à nous. Nous sommes donc bien obligés, pratiquement, de nous établir dans le représentatif »[5]. En effet, le doyen toulousain rejette le concept durkheimien de conscience collective et utilise une méthode comparative entre la psychologie sociale et la psychologie individuelle s’inspirant de Tarde[6], pour montrer que ce sont bien des volontés individuelles qui « s’émeuvent au contact d’une idée commune et qui, par un phénomène d’interpsychologie, ont le sentiment de leur émotion commune » [p. 158]. Et il précise, en conclusion de son analyse, que l’objectivité des idées ne relève pas d’une « réalité spirituelle substantielle » mais d’une objectivité purement « phénoménale ». Il s’interdit lui-même de chercher la vérité des idées et refuse de s’engager dans une perspective métaphysique qu’il laisse aux philosophes, s’en tenant à une « physique » [p. 174] du vitalisme des institutions sociales. L’analyse institutionnelle accepte ainsi le postulat de la complexité pour se saisir simultanément des trois dimensions du phénomène juridique. Celui-ci est à la fois un phénomène factuel, issu de la réalité sociale, un phénomène axiologique, véhiculant des valeurs, et un phénomène normatif, générant des règles de droit. Il est un objet pluriel, passant par différents états, saisi par des savoirs multiples.
Mais revenons à cette notion de vitalisme qui, comme l’indique le sous-titre de cet essai, caractérise la démarche générale adoptée par la théorie de l’institution. Le vitalisme renvoie tout d’abord à la théorie biologique qui appréhende le corps comme un organe physico-psychique animé par une idée directrice. Hauriou reprend cette analyse pour faire de l’idée d’œuvre le « principe vital » des institutions sociales. Le vitalisme renvoie surtout à la conception bergsonienne de l’élan vital qui dirige et organise la matière, permettant d’appréhender la complexité du phénomène vivant, en termes de durée et d’action[7]. L’idée d’œuvre est bien cet élan vital qui transforme les états de fait en états de droit et qui se réalise dans la durée, de manière indéterminée et virtuelle, comme une création continuelle. La théorie de l’institution adopte ainsi une perspective temporelle puisque « les institutions représentent dans le droit, comme dans l’histoire, la catégorie de la durée, de la continuité » [p. 147]. L’institution n’est pas une chose donnée une fois pour toutes, mais constitue un processus d’institutionnalisation qui s’inscrit dans la durée, généré par une fondation juridique, générant du droit. Pour expliquer ce processus, Hauriou distingue un principe d’action qu’il attribue aux institutions-corps qui se personnifient et possèdent une capacité instituante, et un principe de limitation qu’il attribue aux institutions-choses qui désignent les règles de droit et sont instituées. Une fois « le terrain déblayé » par la déconstruction des théories contractualistes et subjectivistes, la « véritable assiette » [p. 147] de la théorie de l’institution est mise en avant. Contre les systèmes subjectiviste et objectiviste qui prennent « l’action pour la durée » ou « la durée pour l’action » [p. 151], le processus institutionnel articule les deux termes, l’action instituante devenant durée instituée.
II. La théorie de l’institution : nouvelle théorie du droit et de l’Etat
Affirmant qu’on ne « détruit que ce qu’on remplace »[8], le doyen toulousain systématise sa propre théorie du droit et de l’Etat à travers la description du phénomène institutionnel. La théorie de l’institution constitue à la fois une approche renouvelée du droit et de l’Etat, mais également une approche modélisée de l’Etat de droit.
L’originalité de cette théorie réside dans le dépassement des thèses normativistes qui identifient le droit à la norme. Elle bouleverse en particulier les présupposés de la conception duguiste, fondant l’ordre juridique sur la seule règle de la solidarité sociale[9]. L’objectif de la théorie de l’institution est ainsi de démontrer que « la fondation des institutions présente un caractère juridique et qu’à ce point de vue les fondements de la durée juridique sont eux-mêmes juridiques ». Ainsi, la naissance, l’existence et la mort des institutions font partie du phénomène juridique. Fondée pour durer, la « fondation continuée » de l’institution-corps réalise un renversement de l’ontologie juridique. Le droit ne se résume pas à la norme, mais constitue un ensemble plus large, comprenant les institutions-corps, c’est-à-dire les groupements collectifs, et les « institutions-choses », c’est-à-dire les règles de droit. Les normes appartiennent au phénomène juridique en tant que « limites transactionnelles imposées aux prétentions des pouvoirs individuels et à celles des pouvoirs des institutions », en tant qu’« éléments de réaction, de durée et de continuité » [p. 150 et s.], permettant de faire durer les institutions corporatives. Elles n’ont pas de capacité d’action et ont besoin des institutions-corps pour être créées et mises en œuvre. Hauriou conclut en insistant sur « le rôle secondaire de la règle de droit dans l’ensemble du système juridique » [p. 172] et met au premier plan les institutions corporatives : « ce sont les institutions qui font les règles de droit, ce ne sont pas les règles de droit qui font les institutions » [p. 173]. L’institution corporative est bien cette nouvelle « figure juridique fondamentale »[10], le centre de la juridicité. Une fois saisi dans sa fondation juridique, l’ordre institutionnel sécrète des règles de droit. Mais si la production de normes n’est qu’un moment de l’institution, elle constitue un moment crucial, puisque la distinction de la norme instituée et du pouvoir instituant permet de penser la limitation de ce dernier. La théorie de l’institution accorde ainsi une place de premier plan aux phénomènes collectifs, acteurs premiers du droit, dont elle analyse l’opération de leur fondation concrète, la constitution objective de leur corpus qui tend à la personnification. Elle est ainsi une théorie du pluralisme institutionnel et juridique. En effet, par cette analyse objective et temporelle de l’Etat, Hauriou le saisit comme une institution corporative composite, dans son pluralisme fondateur et non dans son unité souveraine. A côté de l’Etat, la théorie institutionnelle reconnaît l’existence de groupes, associations, sociétés anonymes, syndicats… capables de générer du droit et en concurrence avec l’Etat. Ce faisant, il réintègre dans le droit l’ensemble des pratiques sociales qui naissent spontanément des différents corps sociaux. Cette prise en compte du droit spontané invite à une conception complexe de la normativité, capable de penser la multiplicité des sources du droit. L’institution est une source première du droit, à côté du contrat et de la loi, permettant de penser le système juridique non plus en termes d’ordre et de hiérarchie, mais en termes de désordre et de pluralisme, saisissant ensemble le public et le privé, le national et le local ou le national et l’international. Mais, l’Etat est le modèle privilégié pour élaborer la théorie de l’institution qui, en retour, le légitime.
L’idée d’œuvre, élément premier de l’institution, est définie comme un principe directeur interne aux institutions, contenant un « élément de plan d’action et d’organisation en vue de l’action », distincte du but de l’institution qui ne vise que le résultat et non les moyens, distincte de sa fonction, car contenant une part d’indéterminé. Cette conception convient parfaitement à l’analyse de l’Etat libéral, permettant d’articuler de manière dialectique le service public et la puissance publique. C’est ainsi que l’idée d’œuvre de l’Etat est pour Hauriou un « protectorat d’une société civile nationale, par une puissance publique à ressort territorial, mais séparée de la propriété des terres, et laissant ainsi une grande marge de liberté pour les sujets » [p. 153]. Le pouvoir de gouvernement, autre élément déterminant de l’institution, s’organise de deux manières ; par une séparation des pouvoirs et par la mise en place d’un régime représentatif. Hauriou distingue trois pouvoirs présents dans le régime parlementaire, « le pouvoir exécutif qui a la compétence intuitive de la décision exécutoire, le pouvoir délibérant qui a la compétence discursive de la délibération et le pouvoir de suffrage celle de l’assentiment » [p. 156]. C’est par cette séparation des pouvoirs, nous dit Hauriou, que la compétence prend le pas sur le pouvoir de domination. Ce constat le conduit à repenser l’équilibre de la Nation et du gouvernement, contre l’analyse rousseauiste. Le peuple n’est pas un pouvoir de gouvernement qui délègue son pouvoir, mais un pouvoir d’assentiment organisé en corps électoral. Il distingue ainsi l’existence d’un pouvoir minoritaire de domination, le pouvoir gouvernemental, contrôlé a posteriori par un pouvoir majoritaire d’assentiment, les électeurs. Le régime représentatif permet quant à lui de mettre au service du corps l’action du pouvoir de gouvernement, car celui-ci, en tant que force d’action, peut ne pas toujours se conformer à l’idée d’œuvre, mais l’ascendant continu assuré par celle-ci permet de le plier de le limiter. Enfin, les manifestations de communion des membres du groupe donnent à l’institution une fondation et une durée consensuelles. L’opération de fondation repose en effet sur un « faisceau consensuel » [p. 168] qui est juridique en raison de « l’unité dans l’objet des consentements », c’est-à-dire dans l’idée d’œuvre commune. Mais ce consensus, précise Hauriou, n’est pas absolu comme l’ont pensé les théories allemandes du vereinbarung et la théorie du contrat social de Rousseau. Les volontés ont besoin d’être agrégées par l’action même du pouvoir et l’institution repose sur un « liber volui fortement nuancé par un coactus volui » [p. 169]. Cette théorie permet ainsi de lire le processus de formation de la majorité parlementaire, ainsi que l’adhésion de la minorité aux règles du jeu institutionnel politique. Ces manifestations de communion étant « dirigées par les organes du pouvoir et réglées par des procédures » [p. 152], Hauriou puise des exemples dans les procédures d’assemblée et de vote du régime parlementaire. Les procédures, assurant la continuité formelle de la vie institutionnelle, permettent ainsi à cette opération fondative complexe qui repose sur la manifestation de différents actes de volonté, d’avoir « l’unité d’un acte juridique » [p. 170]. L’« élasticité du pouvoir » (p. 165) ainsi obtenue permet de prolonger les effets des manifestations subjectives de volonté et de les agréger, pour réaliser une continuité juridique. Acquérant une continuité subjective, l’institution étatique peut alors s’obliger, engager sa responsabilité et s’exprimer en sécrétant des normes de droit disciplinaire et statutaire. Ainsi, si le pouvoir de domination implique une contrainte sur les individus membres, il engendre aussi une séparation des pouvoirs et attire à lui des phénomènes de consentement, car, pour durer, toute institution doit recueillir l’adhésion des membres du groupe, gouvernés ou administrés. Hauriou prend également le modèle de l’Etat pour illustrer le triple mouvement d’élaboration du processus institutionnel. Le régime représentatif réalise un premier travail d’intériorisation et d’incorporation, par lequel les organes de gouvernement agissent dans le cadre de l’idée directrice et donne à l’institution son individualité objective. Les manifestations de communion, réalisent un second travail d’intériorisation donnant lieu à la personnification de l’institution, qui n’est autre que l’apparition de la « liberté politique » [p. 162]. L’Etat devient une institution légitimée par l’idée d’œuvre qui le soutient, l’exercice équilibré et consensuel de son pouvoir, et le droit qu’il sécrète.
La théorie de l’institution met ainsi en œuvre une
analyse vitaliste inscrivant le droit
et l’Etat dans un ordre temporel, pour comprendre leurs rapports et la
formation de l’Etat de droit. Le problème
fondamental du droit public consiste en effet pour Hauriou à savoir comment la force de domination
gouvernementale agit puis se refroidit, limitée par les situations juridiques
objectives qu’elle a elle-même créées. D’une
théorie visant à analyser l’Etat réel, la théorie de l’institution construit un
Etat légitime. Hauriou mêle ainsi
dans sa théorie le donné et le construit,
considérant qu’« à mesure que la
science sociale prend connaissance de son objet, elle le modifie »[11]. La
science juridique n’est-elle pas pour le doyen toulousain une « science de la conduite » des
mouvements sociaux[12] ?
[1] Cette analyse de la continuité subjective de la personnalité corporative m’a été suggérée par un travail remarquable de M. Jacques Chevalier, professeur de philosophie à l’université de Grenoble, sur le continu et le discontinu, que je lui suis très reconnaissant de m’avoir communiqué et qui se trouve reproduit dans les mémoires de l’Aristotelian Society, supplementary volume IV, Londres, 1924, p. 170-196.
[2] Il me parait maintenant qu’il y a un autre élément de continuité dans la conscience intuitive des membres de l’élite, conscience qui ne se produit pas par crises périodiques, mais qui est réellement continue (note de 1928).
[3] « L’histoire externe du droit », Revue critique de législation et de jurisprudence, 1884, p. 5 et s. ; Leçons de science sociale. La science sociale traditionnelle, Paris, Larose, 1896 ; Leçons sur le mouvement social, Paris, Larose, 1899 ;« L’institution et le droit statutaire », Recueil de législation de Toulouse, 1906, p. 134 et s. ; Principes de droit public, 1ère éd., Paris, Larose et Tenin, 1910, 2e éd., 1916 ; Précis de droit constitutionnel, 2e éd., Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1929.
[4] Mazeres Jean-Arnaud, « La théorie de l’Institution de Maurice Hauriou ou l’oscillation entre l’instituant et l’institué » in Mélanges Mourgeon, Bruylant, 1998, p. 244, note 12.
[5] Leçons sur le mouvement social, op. cit., p. 133 et 136.
[6] Les lois de l’imitation, étude sociologique, Paris, Alcan, 1890.
[7] Bergson Henry, L’évolution créatrice ; 1907.
[8] « Le point de vue de l’ordre et de l’équilibre », Recueil de législation de Toulouse, 1909, p. 76.
[9] Hauriou contestera également la doctrine de Kelsen, dont il redoute que « le joug soit pour le droit pire que celui de la théologie », Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 11.
[10] Principes de droit public, 2e éd., op.cit., Introduction, p. XIX.
[11] La science sociale traditionnelle, op. cit., p. 27 et s .
[12] Leçons sur le mouvement social, op. cit., p. 165.
Nota Bene : le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso. Vous pouvez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).
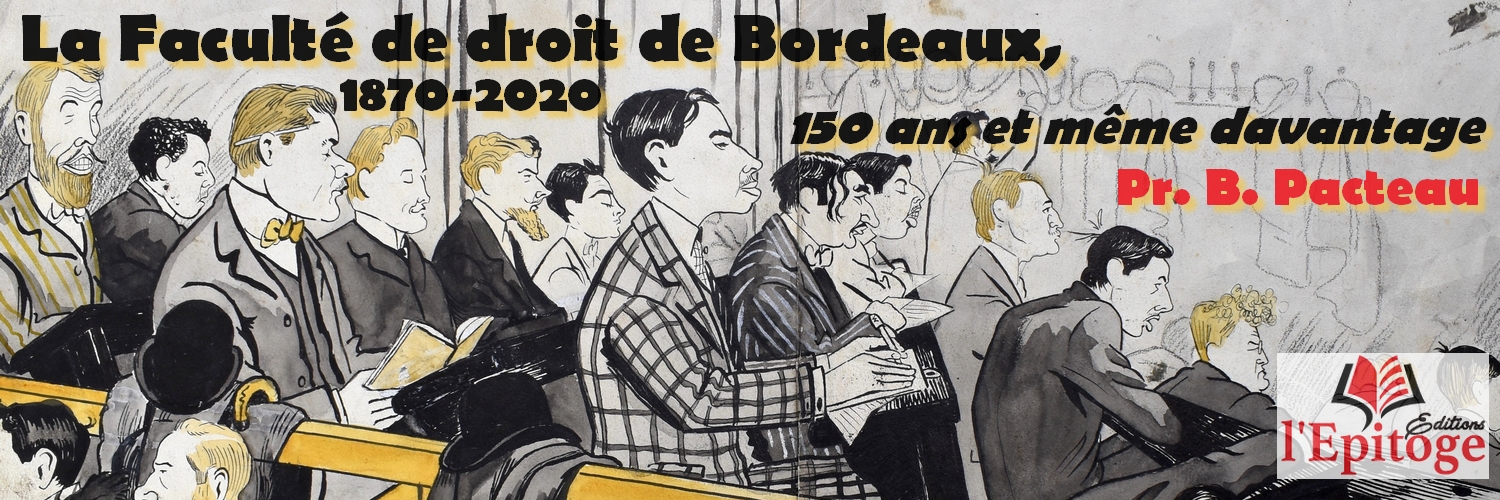
À propos de l’auteur