Voici la 65e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du quatrième livre de nos Editions dans la collection Histoire(s) du Droit, publiée depuis 2013 et ayant commencé par la mise en avant d’un face à face doctrinal à travers deux maîtres du droit public : Léon Duguit & Maurice Hauriou.
L’extrait choisi est celui de l’article de M. le professeur Patrick CHARLOT consacré à la liberté de conscience chez Jaurès et publié dans l’ouvrage Jean Jaurès & le(s) Droit(s).

Volume IV :
Jean Jaurès
& le(s) droit(s)
Ouvrage collectif sous la direction de
Mathieu Touzeil-Divina, Clothilde Combes
Delphine Espagno-Abadie & Julia Schmitz
– Nombre de pages : 232
– Sortie : mars 2020
– Prix : 33 €
– ISBN / EAN : 979-10-92684-44-5
/ 9791092684445
– ISSN : 2272-2963
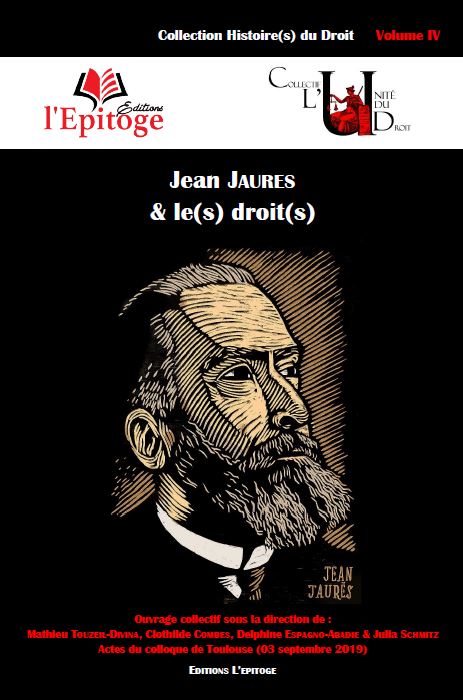
Jaurès
& la liberté de conscience
Patrick Charlot
Professeur de droit public
à l’Université Bourgogne-Franche-Comté
Question de méthode… en guise de préliminaire, il ne faut jamais oublier que, lorsque l’on traite de ce que l’on peut appeler « libertés publiques », on s’intéresse avant tout à la vision de la société que l’on souhaite et à la place que celle-ci va consacrer aux individus, dans leurs rapports entre eux mais aussi, et surtout, dans leurs rapports avec le Pouvoir. Une telle réflexion ne saurait donc s’épuiser dans la description des mécanismes juridiques, ceux-ci ne constituant que de simples moyens de mettre en place une idéologie tendant à assurer, dans la tradition libérale issue, entre autres, de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, une sphère privée dans laquelle l’Etat ne peut s’immiscer qu’avec parcimonie. Parmi les libertés publiques, il n’est guère besoin de souligner l’importance que revêt la liberté de conscience. Pour Jaurès aussi, elle est l’objet d’une attention toute particulière en ce sens où, nous le verrons, elle est une composante essentielle de sa conception du socialisme. Mais il ne faut évidemment jamais oublier que le regard qu’il porte à cette liberté n’est en aucune façon celui d’un juriste. L’appréhension qu’il a du droit, et de cette liberté, est tout à la fois (et c’est aussi ce qui fait son originalité), celle d’un philosophe, d’un historien, d’un socialiste et d’un homme politique. Et, il faut bien l’admettre, la tentative de définition et de délimitation qu’il va donner à la liberté de conscience est souvent influencée par les combats politiques qu’il mène à différentes périodes de sa vie, le plus important pour notre sujet étant évidemment celui pour la laïcité et la loi de séparation des Eglises et de l’Etat. Pour preuve, elle conduit à restreindre véritablement le champ de la liberté de conscience puisqu’elle ne consiste, selon lui, que dans « le droit pour chacun de penser et d’agir comme il lui plaît, dans les différents choses de la religion[1]». Cette liberté, selon Jaurès, semble donc être circonscrite à la liberté religieuse, ne consistant (ce qui n’est déjà pas rien) qu’en la liberté de ne pas être inquiété pour ses opinions religieuses et, évidemment, dans la liberté de ne pas adhérer à des conceptions et opinions religieuses.
On ne peut se contenter d’une conception aussi restrictive, peut-être applicable à l’époque (et encore…) qui conduirait à faire l’impasse sur de nombreux autres problèmes. Il nous semble nécessaire de retenir une définition plus large de cette liberté, inspirée par les juristes modernes, seule à même de permettre de comprendre la complexité de la pensée de Jaurès sur cette question. Pour Frédéric Sudre, par exemple, la liberté de conscience se confond quasiment avec la liberté de pensée, c’est-à-dire, garantissant à l’individu une parfaite indépendance spirituelle. Elle se décompose ainsi en deux éléments ; le droit d’avoir des convictions et le droit de manifester ses convictions. Ainsi caractérisée, elle regroupe tout à la fois la liberté d’opinion et la liberté d’expression[2]. Une telle définition nous permet donc de saisir la pensée de Jaurès sur cette question bien au-delà de la simple sphère religieuse. On ne saurait pour autant tomber dans l’anachronisme juridique. En effet, évoquer une liberté n’a guère de sens si cette dernière n’est pas garantie, opposable aux tiers ou à l’Etat, et protégée par un juge. Or il est permis de s’interroger, à l’époque de Jaurès, sur la protection accordée à cette liberté. Quel est le corpus juridique permettant d’assurer cette liberté ? Les seuls textes pouvant être visés (et notre auteur le fait régulièrement) sont bien les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi et La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Or cette Déclaration est dépourvue de toute portée juridique sous la IIIe République et ne peut donc pas être invoquée devant un juge pour protéger, par exemple, la liberté de conscience qui pourrait être mise à mal. Pour la doctrine juridique majoritaire, représentée, entre autres, par Raymond Carré de Malberg, ce texte n’est tout au plus qu’une simple déclaration morale, philosophique, mais, qui par son flou et son absence d’incorporation dans les textes constitutionnels, ne saurait produire de quelconques droits subjectifs.
A la suite de ces mises au point, comment appréhender la place de la liberté de conscience dans les écrits de Jaurès ? Telle que nous l’avons définie préalablement, elle irrigue finalement toute son œuvre, sans pour autant que nous cherchions à la trouver partout. En effet, tout le socialisme jaurésien en découle. Cette liberté apparaît ainsi, pour lui, comme un principe cardinal, si ce n’est un principe matriciel. Sa conception philosophique du socialisme, qui est relativement originale à l’époque, le conduit à voir dans la liberté de conscience une liberté absolue, sans laquelle la société nouvelle ne pourra jamais voir le jour (1ère partie). Elle paraît ainsi constituer l’alpha et l’oméga de son socialisme. Mais le lecteur nous permettra de nuancer ce propos. Qu’il n’y voit pour autant aucune volonté de malice ou de commettre un crime de « lèse-Jaurès ». Les épreuves politiques auxquelles le grand tribun a été soumis nous amènent à penser que la position philosophique est bien difficile à tenir en face de certaines circonstances. Et nous voudrions montrer, à travers quelques exemples, que le réalisme politique a conduit Jaurès à accepter des restrictions qui nous paraissent gênantes à cette conception absolue de la liberté de conscience (2e partie). Sans tomber dans une opposition facile entre l’idéal et le réel, entre la mystique et la politique, il est des épisodes que l’on ne peut passer sous silence.
I. Une liberté absolue, fondée philosophiquement
Il n’est évidemment pas question ici de revenir sur le socialisme jaurésien. Fruit d’une synthèse mêlant à la fois, entre autres les utopistes français, Marx et Benoît Malon, la culture encyclopédique de Jaurès le conduit à une approche originale où l’individu ne va pouvoir s’épanouir que dans la communauté, sans pour autant disparaître. L’individu est donc l’objet essentiel de ce socialisme, et va donc, en tant que tel, pouvoir jouir de manière absolue de cette liberté de conscience (A). De même, l’utilisation que fait Jaurès de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, assez singulière pour l’époque, lui permet de consacrer de manière indiscutable la dite-liberté.
A. Une conséquence de sa vision originale du socialisme.
Le caractère absolu de la liberté en question découle de la place de l’Individu dans la pensée jaurésienne. La communauté, la société, ne doivent en aucun l’absorber, mais, au contraire, celles-ci sont l’outil qui doit lui permettre, d’accéder, selon le titre de l’ouvrage de Benoît Malon, au « socialisme intégral ». Cette tentative de conciliation entre « l’Un » et le « Tout » est une des originalités de ce socialisme porté par Jaurès, que Georges Lefranc a si bien décrit dans son « Jaurès et le socialisme des intellectuels[3] ». Il faut insister, pour cet aspect, sur l’influence qu’a pu avoir sur Jaurès Lucien Herr. Sans insister sur le bibliothécaire de l’Ecole Normale Supérieure devenu légendaire, on sait, par Charles Andler et Léon Blum[4], quel rôle il a pu jouer dans la prise de conscience socialiste de Jaurès, alors « simple » républicain. Mais on ne peut qu’être frappé par l’analogie entre le socialisme jaurésien et les rares écrits connus de Lucien Herr, et plus particulièrement les fragments manuscrits d’un texte, rédigé sous forme d’aphorismes, intitulé « Le progrès intellectuel et l’affranchissement. Le progrès en conscience et en liberté[5] », daté de 1888. La conscience … le concept est fondamental dans cette volonté d’appliquer l’hégélianisme au socialisme, produisant finalement ce qu’on peut qualifier schématiquement de « socialisme idéaliste ». Il nous paraît nécessaire de le résumer rapidement afin de comprendre ce que Jaurès a pu en retenir, plus particulièrement pour le sujet qui nous intéresse. On peut ainsi trouver une autre définition de ce que peut être la liberté de conscience dans un des aphorismes de Herr : « l’insurrection, la révolte, c’est-à-dire en langage simple, l’examen et la critique, est un devoir non seulement dans les cas exceptionnels et graves, mais toujours[6] ». La conscience et son libre exercice semblent donc être la condition sine qua non du changement social et politique. L’esprit critique et la possibilité d’exprimer cette critique sont indissociables de l’affranchissement. Le socialisme, qui doit accomplir cette libération de l’individu, peut ainsi se résumer en trois concepts, que Jaurès n’aura de cesse de revendiquer (y compris et surtout lors des débats sur la loi de 1905) : « Immanence (négation de la vérité supra-humaine), autonomie (affranchissement à l’égard des servitudes passées et des transcendances), rationalisme (autonomie intellectuelle[7]) ». Cet appel à la raison peut certes prêter à sourire par son optimisme, mais il est consubstantiel de ce « socialisme individualiste » dont se prévaut Jaurès. C’est bien en ce sens que ce socialisme doit être intégral, en libérant l’homme de toutes ses entraves. La liberté de conscience est donc bien le fondement de cette doctrine. Seul l’Homme libéré de tous les soleils illusoires pourra produire une société autonome (au sens de Herr et, plus, tard, de Castoriadis). Il en résulte donc un primat de l’Individu qui doit être respecté en tant que tel (on peut sans doute rattacher à cette conception l’engagement de Jaurès aux côtés de Dreyfus), et bien souvent, évidemment, sans tenir compte de son appartenance sociale. Ce socialisme se résume finalement dans l’idée de Justice et le respect de la personne. Ses positions vis-à-vis de la religion peuvent aussi s’entendre et s’expliquer à travers de ce prisme. La définition qu’il donne de la liberté de conscience (cf. note 1), bien que datée de 1889, nous semble aussi pertinente lors de ses prises de positions datant du début du XXe siècle, lorsque la question de la laïcité fait rage. Même si ses combats contre l’Eglise et la religion sont très violents, il ne nous paraît pas toujours partager les postures ultra-laïcardes d’un Combes. Dans une mise au point toute en nuances, lorsqu’il doit affronter la polémique naissante sur la communion de sa fille, en 1901, il reprend finalement sa conception de 1889 : il faut avant tout respecter les convictions individuelles, y compris celle de sa femme qui finalement souhaitait pour sa fille ce sacrement. Et faire confiance en la Raison ; « La vie et la liberté, ces grandes éducatrices, auront le dernier mot. L’enfant, habitué peu à peu à se gouverner lui-même dans l’ordre de la conscience, continuera ou abandonnera la tradition religieuse (…) Le droit de l’enfant, c’est d’être mis en état, par une éducation rationnelle et libre, de juger peu à peu toutes les croyances et de dominer toutes les impressions premières reçues par lui[8] ». C’est concrètement un appel à la neutralité, qui n’est pas sans annoncer, selon nous, une certaine conception de la loi de 1905, en y voyant aussi un principe de neutralité de l’Etat, qui n’a pas à se mêler de la sphère privée, tant que celle-ci reste privée.
Cette liberté de conscience, on le voit avec cet épisode familial, ne peut s’exercer que grâce à une éducation intégrale, totale, afin de donner à tous les moyens de se forger leurs propres jugements. D’où évidemment l’importance de l’école républicaine, seule à même, selon lui, de susciter les doutes et les questions. Mais, au-delà, il y a, par exemple chez Herr, et cette conception est aussi partagée par Jaurès[9], une véritable mission qui est confiée aux intellectuels en vue justement de préparer cette libération totale. La conscience doit quelquefois être aidée afin de pouvoir s’exercer librement. Herr, par exemple, a des développements surprenants pour quelqu’un qui est socialiste : « L’homme moyen n’est qu’un immense facteur de conservatisme, de traditions subies (…) d’idées impuissantes à organiser, à transformer le contenu confus et désordonné de sa conscience et de son inconscient[10] ». C’est à l’intellectuel, celui qui applique sa pensée critique au milieu qui l’entoure, d’introduire l’idée, qui doit ensuite être assimilée par l’individu (et non par la masse). Le rôle de l’intellectuel (socialiste) consiste à doter l’individu d’une véritable « arme » intellectuelle, qui, quasiment à elle-seule, pourra renverser la vieille société et ses préjugés. Cette conception toute hégélienne traduit en fait une véritable histoire de l’« idée » comme moteur de l’Histoire, qui part d’une personne énergique, pour ensuite être assimilée par l’individu. L’exemple type de cette manière de procéder est d’ailleurs fourni par Herr : c’est l’Affaire Dreyfus, combat mené d’abord par les intellectuels tant décriés par Barrès, éveillant petit à petit les individus pour les associer à leur combat : « La vérité, c’est que dans une France rétrécie, desséchée, racornie, un petit nombre d’hommes, pour une œuvre de justice, d’humanité et d’honneur, ont pu entreprendre la lutte contre la force souveraine des brutalités liguées, des intérêts syndiqués, des haines élémentaires coalisées (…). Ces quelques hommes ont pu, dans la bataille de chaque jour, ébranler une à une les âmes, éveiller une à une les consciences, troubler les quiétudes dormantes, évoquer les énergies éteintes, faire jaillir une espérance active en un idéal de justice humaine[11] ». Mais que l’on ne s’y trompe pas. On ne peut voir dans cette conception du rôle de cette « élite » une quelconque conception babouviste ou saint simonienne, voire léniniste. Cette minorité a un devoir, et aucun droit ; celui d’éveiller. Mais elle est subordonnée au peuple et n’a en aucun cas une quelconque légitimité pour guider le mouvement ouvrier (Herr est d’ailleurs affilié aux allemanistes, qui se caractérisent par leur ouvriérisme et leur méfiance vis-à-vis des « intellectuels »). La Conscience et l’Idée ne peuvent donc naître spontanément chez les individus, mais elles sont les valeurs suprêmes nécessaires à la Révolution. Et elles figurent déjà, comme liberté, dans ce texte si particulier qu’est la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
B. Une conséquence de sa lecture originale de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen parmi les socialistes de son époque
Au-delà de la vulgate marxiste, prégnante chez les guesdistes, qui ne fait de la Déclaration qu’un instrument juridique et politique crée et utilisé par la bourgeoisie, Jaurès adopte vis-à-vis du texte révolutionnaire une toute autre attitude. Délaissant les critiques de Marx de Sur la question juive, il est persuadé que le prolétariat peut retourner ce texte contre la bourgeoisie et s’en servir à son profit. Dans une formule choc, dès lors que le classe ouvrière aura exprimé une conscience de classe (c’est-à-dire, au sens proudhonien, une vison de la réalité sociale) et une idée de classe (toujours pour rester dans la logique proudhonienne, une vision prospective de la société), « Vienne l’heure où le prolétariat saura réfléchir sur sa destinée et ses intérêts de classe, il saisira un contraste violent entre les droits naturels de tout homme, proclamés par la Révolution bourgeoise, et sa propre dépendance sociale : alors la Déclaration des droits de l’homme, changeant de sens et de contenu à mesure que se modifie l’histoire, deviendra la formule de la Révolution prolétarienne[12]». Cette lecture et cette utilisation du texte de 1789 interroge et intéresse. Elle interroge déjà dans le sens où, évidemment, Jaurès fait référence à la notion de droits naturels qui figurent dans le texte révolutionnaire, plus particulièrement dans son article 2. Ces droits naturels sont la liberté, la propriété, la sûreté et le droit de résistance à l’oppression. Or Jaurès ne s’interroge que sur le caractère naturel du droit de propriété[13]. On veut bien admettre que cette question taraude traditionnellement tous les socialistes, mais il est tout de même surprenant, même si L’Histoire socialiste est avant tout un livre historique, que le philosophe de formation qu’est Jaurès n’interroge pas le caractère naturel ou non des autres droits (dont la liberté).
Et pourtant : « L’homme a le droit primordial d’aller et venir, de travailler, de penser, de vivre, et de déployer en tous sens sa liberté sans autre limite que la liberté d’autrui[14]». Le primordial est-il le naturel ? Nulle réponse chez Jaurès. La démarche est pourtant essentielle pour le juriste ou le philosophe politique. En effet s’il s’agit de droits naturels, l’individu ne peut pas y renoncer dès lors qu’il entre dans l’état social, et l’Etat est tenu de lui en garantir l’effectivité. Alors, du droit de travailler : un droit primordial ou naturel ? On s’aperçoit ici que la question (et la réponse) emporte des conséquences extrêmement importantes, surtout pour les socialistes de cette époque. Jaurès l’élude pourtant, en y revenant de manière lyrique : « La Déclaration des Droits de l’Homme avait été aussi une affirmation de la vie, un appel à la vie. C’étaient les droits de l’homme vivant que proclamait la révolution[15]». Mais surtout, ce qui est surprenant, c’est la vision juridique que Jaurès attribue à ce texte, alors même, rappelons-le, qu’à l’époque où il écrit, la Déclaration est dépourvue de toute portée juridique et ne peut donc être invoquée devant un juge. Au-delà de l’assimilation quasi-constante qu’il fait entre son socialisme et le texte de 1789 (« C’est le socialisme seul qui donne tout son sens à la Déclaration des Droits de l’Homme et qui réalisera tout le droit humain[16]»), il est nécessaire de dépasser la volonté initiale des révolutionnaires et de doter le prolétariat d’une nouvelle arme qui est le Droit. Il fait là aussi œuvre de visionnaire, annonçant ce qu’on a pu appeler le « socialisme juridique », c’est-à-dire une école de pensée qui est persuadée que la « révolution » peut être accomplie par le Droit et les moyens légaux, au moyen d’une interprétation extensive et sociale des textes juridiques. Les lignes de Jaurès dans « le socialisme et la vie » sont sur ce point très éclairantes quant à sa vision : « Ainsi jusque dans le droit révolutionnaire bourgeois, dans la Déclaration des Droits de l’Homme et des droits de la vie, il y a une racine de communisme[17]». Pour être encore plus précis, « le socialisme surgit de la Révolution française sous l’action combinée de deux forces : la force de l’idée de droit, la force de l’action prolétarienne naissante. Il n’est donc pas une utopie abstraite[18]». Ce que Jaurès nomme les droits de l’homme vivant englobe évidemment les articles 2 et 4 de la Déclaration[19], énonçant un principe général de liberté, et les articles 10 et 11, déclinaisons du principe général de liberté, appliquées à la liberté de pensée. L’appel à la vie lancé par la Révolution de 1789 est bien aussi un appel à la liberté sous toutes ses formes, à ce combat pour l’autonomie permis par la liberté de conscience. Mais, une fois de plus, que faire de ce texte révolutionnaire s’il n’est pas garanti par l’Etat et invocable par un particulier devant un juge ? On ne trouve nulle part trace chez Jaurès d’une quelconque volonté de « juridiciser » ce texte ou de demander à des juges de l’appliquer. Dans les mêmes périodes, certains de ses collègues des facultés de droit, en particulier Duguit, doyen de la faculté de droit de Bordeaux et évidemment le « pays » de Jaurès, Hauriou, doyen de la faculté de droit de Toulouse, s’interrogent sur la valeur juridique de la Déclaration et militent, en dépit de sa non-inscription dans les lois constitutionnelles de 1875, pour lui attribuer une valeur sinon supra-constitutionnelle (Duguit), au moins constitutionnelle (Hauriou). On hésite, en lisant Jaurès, sur ce qu’il attribue vraiment comme valeur juridique à ce texte ; une actuelle mais qui serait ignorée par le droit positif et la jurisprudence (de peur, peut-être, d’avoir à lui donner une portée « socialiste), ou bien une future, qui serait finalement le texte suprême d’un futur « droit socialiste » ?
Mais ces affirmations jaurésiennes sur la portée absolue, entre autres, de la liberté de pensée et la liberté de conscience, nous paraissent cependant à nuancer, sous l’influence de certaines péripéties politiques que le leader socialiste a eu à affronter.
II. Des limitations à cette liberté, justifiées par des positions politiques
Il ne saurait évidemment être question de minimiser les combats de Jaurès pour la liberté sous toutes ses formes. Notre objectif ici est simplement de montrer que, parfois, la raison politique semble l’emporter sur des convictions profondes. On veut bien admettre que la pensée et l’action d’un auteur s’apprécient sur une période longue… Mais il y a néanmoins des positions gênantes, aussi bien lorsque l’on les analyse a posteriori en évitant tout anachronisme que lorsqu’elles suscitent immédiatement des prises de position virulentes (voire violentes) de la part de nombreux camarades qui partagent pourtant les combats de Jaurès. Pour ce faire, nous avons arbitrairement choisi deux évènements où les prises de position du socialiste peuvent susciter quelques interrogations au regard de tout ce qu’il a écrit et dit, en particulier sur la liberté de conscience (cf. la 1ère partie de notre communication) : le Congrès de Japy (qui a lieu du 3 au 8 décembre 1899) et l’affaire dite « des fiches » (de novembre 1904 à janvier 1905).
A. Le Congrès de Japy et la délicate question de la liberté de la presse.
Ce Congrès est resté célèbre en ce sens où, selon de nombreux historiens, il annonce la création de la future Section Française de l’Internationale Ouvrière[20]. C’est donc dans le gymnase parisien de Japy que se retrouvent les cinq grandes tendances socialistes d’alors : le Parti Ouvrier Français (plus souvent qualifié de « guesdiste », emmené d’une main de fer par Jules Guesde), la Fédération des Travailleurs Socialistes (ou « broussiste », du nom de leur leader Paul Brousse, ou « possibiliste »), le Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaires (ou « allemaniste », Jean Allemane, ne l’oublions pas, étant proche de Lucien Herr) ; le Parti Socialiste Révolutionnaire (ou « vaillantiste » ou « blanquiste », dirigé essentiellement par Edouard Vaillant), et la Confédération des Socialistes Indépendants (beaucoup moins structurée que les autres groupes, et dont les grandes figures sont Jaurès et Millerand). Les désaccords idéologiques sont extrêmement profonds entre toutes ces tendances, mais doivent être minorés en vue de l’arrivée au pouvoir des socialistes. En effet, depuis les années 1893, de nombreux députés socialistes sont élus à la Chambre, et les leaders, par souci d’efficacité électorale et persuadés que le pouvoir peut être pris par les moyens légaux, ont la volonté de créer enfin LE parti socialiste. L’ordre du jour de ce Congrès porte sur « la lutte des classes et la conquête des pouvoirs publics » (en filigrane se trouve ici posé le douloureux débat du « ministérialisme » suite à l’entrée de Millerand, soutenu par Jaurès, dans le gouvernement Waldeck-Rousseau, aux côtés du général Gallifet, « le massacreur de la Commune », et violemment combattu par les guesdistes et Vaillant) et sur « l’unité socialiste, ses conditions théoriques et pratiques ». On remarquera que l’ordre du jour s’ouvre sur la question la plus compliquée et que les guesdistes et vaillantistes veulent en découdre sur ce point, l’unité du parti n’étant pas pour eux un sujet prioritaire. L’art de la synthèse est alors inauguré entre toutes les factions, puisque les délégués trouvent alors le moyen de répondre NON à la question posée ; « la lutte des classes permet-elle l’entrée d’un socialiste dans un gouvernement bourgeois ? » (par 818 voix contre 643), tout en approuvant une proposition transactionnelle qui admet que « des circonstances exceptionnelles peuvent se produire dans lesquelles le parti aurait à examiner la question d’une participation socialiste à un gouvernement bourgeois » (par 1140 voix contre 240). L’essentiel est dons sauvé pour Jaurès et ses amis, et il semble persuadé que dorénavant la question de la création du Parti semble être en voie d’être réglée. Les autres points à l’ordre du jour vont donc être bâclés en une journée. Les guesdistes portent encore le fer non seulement sur la création et la direction du parti, mais surtout sur les différents moyens d’actions, de propagande et d’organisation. Ils considèrent qu’il ne peut pas y avoir d’unité si les différents journaux socialistes (entre autres, La petite République de Gérault-Richard, très proche de Jaurès) se permettent des attaques contre les différents groupes socialistes. Et Guesde va plus loin en estimant que la presse socialiste doit être placée sous le contrôle du Parti, prononçant cette phrase véritablement stupéfiante : « L’indépendance de la presse doit finir là où commence l’organisation centrale du socialisme français[21]». Et, de manière encore plus hallucinante, aucune voix ne s’élève pour protester. Surtout pas celle de Jaurès. Il n’intervient en aucune manière sur ce point, alors qu’il est omniprésent sur le premier point de l’ordre du jour et du ministérialisme. Mieux même, il vote cette motion comme tous ses camarades, puisqu’elle sera adoptée à l’unanimité du Congrès. Il semble prêt à tout accepter, y compris que les journaux socialistes ne puissent plus exercer une activité critique, afin de permettre l’unité et la création du Parti. Cela lui vaudra déjà des critiques de Péguy, alors proche de lui : « Je suis détraqué ; je me promène en sabots, par ce grand froid dans mon jardin, et je me dis comme une bête : ils ont supprimé la liberté de la presse ! ils ont supprimé la liberté de la tribune[22]» ! Le silence assourdissant de Jaurès sur cette question délicate lui sera souvent reproché. Comment vouloir la future Cité socialiste en commençant par construire un parti qui supprime toute liberté de discussion et de pensée dans ses journaux ? Quid de l’autonomie intellectuelle nécessaire ?
La fin (la création du Parti) justifie-t-elle les moyens ?
La question va se poser avec encore plus d’acuité lors des débats sur ce que l’on a nommé « l’affaire des fiches ».
B. Le refus de la liberté de conscience dans l’affaire des « fiches ».
Comme l’écrit Guy Thuillier[23], « on n’aime pas parler de l’affaire des fiches : elle paraît gênante et elle évoque des méthodes d’information (et d’avancement) peu orthodoxes (mais qui sont traditionnelles et qui ont survécu à l’affaire) ». Pour résumer cet épisode si important qu’il aboutira à la chute du ministère Combes le 19 janvier 1905, il faut comprendre que c’est le ministre de la guerre, le général André, qui avait organisé dans son ministère un vaste système de renseignement, destiné à lui permettre de connaître les opinions religieuses et politiques des officiers. Rien finalement que de très traditionnel. Mais ce qui va faire scandale c’est que ce procédé reposait sur la délation pratiquée par ce « délégué administratif », que Combes lui-même définissait comme « un notable de la commune qui était investi de la confiance des républicains et qui, à ce titre, les représentait auprès du gouvernement quand le maire est réactionnaire[24] ». Ces délégués administratifs étaient souvent des représentants des loges maçonniques. Et lorsqu’un employé du Grand-Orient vole une collection de « fiches » et les vend à l’opposition nationaliste, le scandale éclate à la Chambre[25], par l’intermédiaire de Guyot de Villeneuve qui, le 28 octobre 1904, interpelle le gouvernement en lisant publiquement les fiches individuelles fournies par le Grand-Orient sur un certain nombre d’officiers, accompagnées des demandes et réponses du ministère de la guerre. D’une affaire administrative, l’affaire des fiches devient alors politique ; la question est de savoir si le gouvernement Combes est responsable de ce système. Le génie oratoire de Jaurès s’en donne à cœur joie. Il ne faut pas oublier qu’il est alors le vice-président de la Chambre et, qu’à ce titre, il est un soutien essentiel du ministère Combes, « âme ardente et parole magnifique de la Délégation des gauches[26] », délégation qui constitue l’organe directeur de la coalition gouvernementale. Il n’est sûrement pas faux d’affirmer que si le gouvernement se maintient jusqu’au 19 janvier 1905, c’est au tribun socialiste qu’il le doit. Par trois fois, Jaurès intervient au secours du gouvernement, en justifiant le mécanisme de la délation (les 28 octobre et 4 novembre 1904 et le 14 janvier 1905), en évitant donc à Combes d’être mis en minorité à la Chambre.
Ses justifications méritent d’être relevées, afin d’abonder notre propos. Au-delà de références à l’Affaire Dreyfus toujours bienvenues (où Jaurès met en garde les députés sur l’usage de documents dont on ne saurait contrôler l’origine et la valeur[27]), il tente avant tout de se placer sur le terrain politique plutôt que sur celui de la morale ou des principes juridiques. « Sera dupe qui voudra ! Sera complice qui voudra[28] » ! Il ne faut pas tomber dans le piège tendu par l’opposition, et il ne faut surtout pas que les députés condamnent ces méthodes de renseignement. Ce qui est en jeu, selon lui, au-delà de la survie du gouvernement, c’est bien la République elle-même[29]. Et, quelques semaines plus tard, il affirme même un véritable droit de la République de se prémunir contre ses ennemis : « Oui ou non, reconnaissez-vous que la république a le droit d’exiger particulièrement des officiers non seulement les qualités professionnelles et les vertus professionnelles, mais aussi cette vertu professionnelle par excellence de l’officier sous la république, le dévouement à l’institution républicaine[30]» ? Jaurès justifie ainsi le droit du gouvernement d’établir une véritable police des esprits. Que devient la liberté de conscience et de pensée des fonctionnaires ? Quid de la morale et du droit, de cette Déclaration des droits de l’homme qu’il aime si souvent rappeler ? Ils s’effacent finalement devant la realpolitik du Bloc des gauches. Pour notre part, nous ne pensons pas que Jaurès soit, lui aussi, véritablement dupe de cette affaire de la délation. Mais toujours est-il qu’en politique, il se trouve prisonnier de sa solidarité à la majorité gouvernementale et contraint de renier beaucoup de ses principes. Il n’est d’ailleurs pas anodin de relever, preuve que le système mis en place par le général André lui répugne, qu’il soutient et fait adopter, en avril 1905, avec Marcel Sembat, un article additionnel à la loi de finances rendant automatique le droit pour tout fonctionnaire à la communication de son dossier.
Cette prise de position de Jaurès lui vaudra de très violentes critiques dans les rangs socialistes, y compris au sein de la Ligue des droits de l’homme, ses compagnons depuis les temps de l’Affaire Dreyfus. Devant le refus de Francis de Pressensé, président de la Ligue, de condamner les pratiques ministérielles, certains ligueurs, et non des moindres, prennent des positions publiques. Ainsi de Charles Rist, professeur à la faculté de droit de Montpellier, pour lequel « il s’agit d’une question de moralité politique au sujet de laquelle aucune tergiversation ne nous serait admissible. Si la Ligue laissait croire par son silence à tout le pays républicain que des procédés comme ceux mis en œuvre au ministère de la guerre ne sont pas contraires à l’esprit de la déclaration des droits de l’homme – si elle n’avertissait pas le parti républicain du danger qu’il court à employer les procédés même et les arguments contre lesquelles nous avons si souvent protesté – elle faillirait à sa mission[31]». Célestin Bouglé, professeur de sociologie à l’Université de Toulouse, vilipende la Ligue, qui, si elle avait accepté de condamner le procédé de la délation, « aurait montré une fois de plus qu’elle n’est l’esclave d’aucun parti et qu’elle entend défendre les « droits de l’homme » partout où elle les sentira blessés, et aussi bien sous la peau des catholiques que sous celles des juifs ou des francs-maçons[32]». Cette affaire ouvrira une crise très importante à la Ligue, suscitant les démissions de deux de ses membres fondateurs, pourtant proches de Jaurès, Joseph Reinach et Ludovic Trarieux, refusant de cautionner les pratiques couvertes et justifiées par Jaurès : elle ouvre finalement une fracture profonde dans le camp des anciens alliés du leader socialiste.
Peut-on en
conclure de manière péremptoire à une conception de la liberté de conscience à
géométrie variable chez Jaurès ?
Est-elle la preuve que la mystique socialiste doit plier devant la politique
socialiste ? Jaurès a
quelques fois expérimenté et inauguré ce dilemme, en tant que premier grand
socialiste français à agir sur la scène politique.
[1] J. Jaurès, « Laïcité », in La Dépêche, 16 juin 1889. In Œuvres de Jean Jaurès. Tome 1. Les années de jeunesse 1885-1889, Fayard, 2009 ; p. 287.
[2] F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme. Puf. Collection Droit fondamental. 14e édition. 2019 ; p. 785 et s.
[3] G. Lefranc, Jaurès et le socialisme des intellectuels. Paris. Editions Montaigne. 1968.
[4] « Un soir, Herr prit à partie son aîné, Jaurès ; et la discussion dura toute la nuit… En passant au socialisme, Jaurès ne se convertissait pas : il poussait à bout son républicanisme. Le pas décisif, il le fit cependant parce que Herr sut le convaincre. Cette grande recrue, c’est Herr qui l’a amenée ». C. Andler, Vie de Lucien Herr. Paris. Editions Rieder. 1932. Reprint Maspero. 1977 ; p. 122. Même si Madeleine Rebérioux tend à minimiser cette influence de Herr (entre autres dans « Jaurès et le socialisme des intellectuels », Bulletin de la Société d’Etudes jaurésiennes, n°39, oct-déc1970, p. 3 et s., où elle soutient que l’engagement socialiste de Jaurès naît de la grève de Carmaux), on peut encore se fier au témoignage de Léon Blum : « C’est Herr qui avait amené Jaurès au socialisme, ou, pour parler plus exactement, c’est Herr qui avait amené Jaurès à prendre claire conscience qu’il était socialiste. C’est lui, qui avec Lévy-Bruhl, venait de convaincre Jaurès de l’innocence de Dreyfus ». Souvenirs sur l’affaire 1935). Gallimard. Folio Histoire.1993 ; p. 44-45. Sur Lucien Herr, outre la bibliographie d’Andler, il faut se reporter à Daniel Lindenberg et Pierre-André Meyer, Lucien Herr, le socialisme et son destin. Calmann-Lévy. 1977. On peut, sur un point particulier, consulter Patrick Charlot, « Lucien Herr et la nécessaire réforme intellectuelle et morale ». La dynamique du changement politique et juridique : la réforme. Presses Universitaires d’Aix-Marseille. 2013 ; p. 369 et s.
[5] In Lucien Herr, Choix d’écrits. II. Philosophie. Histoire. Philologie. Paris. Editions Rieder ; p. 9 et s.
[6] Ibid. p. 27.
[7] Ibid. p. 12.
[8] J. Jaurès, « Mes raisons », La Petite République, 12 octobre 1901. In Œuvres de Jean Jaurès. Tome 8. Défense républicaine et participation ministérielle. Fayard. 2013 ; p. 80 et s.
[9] Toujours le livre de G. Lefranc, Jaurès et le socialisme des intellectuels. Op. cit. Il y souligne d’ailleurs l’influence considérable d’un socialiste russe, Pierre Lavrov ; p. 77 et s.
[10] L. Herr, op. cit. p. 35.
[11] L. Herr, « Isolement », La Volonté, 27 octobre 1898. In Choix d’écrits. Tome 1. Politiques. Editions Rider. 1932 ; p. 66 et s.
[12] J. Jaurès, Histoire socialiste. Livre I. Jules Rouff éditeurs. 1901 ; p. 303 et s. On retrouve le même genre de formule dans « Le socialisme et la vie ». Etudes socialistes. Cahiers de la quinzaine. 4e Cahier de la 3e série (5 décembre 1901), p. 137. « Ainsi d’emblée le droit humain proclamé par la Révolution avait un sens plus profond et plus vaste que celui que lui donnait la bourgeoisie révolutionnaire ».
[13] Ibid. p. 302-303.
[14] Ibid. p. 300.
[15] J. Jaurès, « Le socialisme et la vie ». Etudes socialistes. Op. cit. ; p.139.
[16] Ibid. p. 130.
[17] Ibid. p. 140.
[18] Ibid. p. 141.
[19] En complément de l’article 2 qui fait de la liberté un droit naturel, l’article 4 stipule que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».
[20] Pour une vision d’ensemble de ce Congrès et des oppositions violentes puis de la synthèse finale, on peut se reporter à P. Charlot, « Quand ça commence mal… le Congrès général des organisations socialistes françaises (Paris, salle Japy, 3-8 décembre 1899) » in Cahiers de la recherche sur les des droits fondamentaux. Presses Universitaires de Caen ; n°16, 2018 ; p. 11 et s. L’intégralité des débats a été publié quasi immédiatement, Congrès général des organisations socialistes françaises tenu à Paris du 3 au 8 décembre 1899. Compte rendu sténographique officiel, Paris, Société. nouvelle de librairie et d’édition. 1900.
[21] J. Guesde, Congrès général des organisations socialistes françaises tenu à Paris du 3 au 8 décembre 1899. Compte rendu sténographique officiel. Op. cit. p. 315
[22] C. Péguy, « La préparation du congrès socialiste national », Cahiers de la quinzaine, 1re série, 2e cahier, 20 janvier 1900, in Œuvres en prose complètes, R. Burac (éd.), Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1987, t. I, p. 347.
[23] Guy Thuillier, « Autour d’Anatole France : le capitaine Moulin et l’affaire des fiches en 1904 », in Revue administrative. 1986 ; p. 549. Sur cette affaire, lire aussi de Guy Thuillier : « A propos de l’affaire des « fiches » ; les mésaventures du Préfet Gaston Joliet en 1904 » in Revue administrative. 1994 ; p. 133 et s. et P. Charlot, « Péguy contre Jaurès. L’affaire des « fiches » et la délation aux droits de l’homme » in Revue française d’histoire des idées politiques ; n°17. 2003 ; p. 73 et s.
[24] Emile Combes, Journal officiel. Débats parlementaires. Chambre des députés. 19 novembre 1904 ; p. 2561.
[25] Ce qui choque, finalement, ce n’est pas le droit pour le gouvernement de se renseigner sur les fonctionnaires sensés servir la République, mais c’est bien de le faire par des sources non officielles, dont la franc-maçonnerie. « Si l’affaire des Fiches indigna la classe politique au point d’entraîner la chute du gouvernement, c’est moins parce qu’elle révélait l’importance des considérations idéologiques dans le déroulement des carrières des officiers qu’en raison de l’utilisation d’organismes non officiels : les loges maçonniques, comme canaux de l’information. C’est la délation que l’on repousse, plus que la doctrine d’une fonction publique politisée. A l’époque de la République militante, il faut donner des gages de républicanisme pour entrer dans l’Administration, et ne pas être suspect de cléricalisme pour espérer y faire carrière ». François Burdeau, Histoire de l’administration française. Montchrestien ; 2e édition. 1994 ; p. 256.
[26] Jean-Jacques Chevallier, Histoire des institutions et des régimes politiques de la France moderne. Dalloz. 3e édition revue et augmentée. 1967 ; p. 476.
[27] J. Jaurès, Journal officiel. Débats parlementaires. Chambre des députés. Séance du 28 octobre 1904 ; p. 2241.
[28] Ibid.
[29] « Les républicains diront si, à cette heure obscure et redoutable que traversent les destinées de ce monde, il convient de renverser un gouvernement qui a su maintenir la paix, et de se livrer à tous les césariens, entrepreneurs de guerre et d’aventure (…) Je dis aux républicains qui veulent se risquer dans cette aventure qu’ils en seront les dupes ». Ibid., p. 2242, en réponse à un député républicain Klotz qui affirme que « nous, républicains (…) ne devons jamais imiter les procédés que nous avons condamnés et flétris chez autrui. Je dis que la délation ne saurait faire aimer la République », ibid., p. 2240.
[30] J. Jaurès, Journal officiel. Débats parlementaires. Chambre des députés. Séance du 4 novembre 1904 ; p. 2285. Le député républicain, Georges Leygues, lui répond de manière virulente ; « L’enjeu de ce débat est l’honneur du parti républicain, et peut-être de son existence même. Il faudra que la majorité dise nettement si elle abdique sa raison et sa conscience, ou si elle a l’énergie pour flétrir publiquement les actes inadmissibles qu’elle condamne et abhorre en secret ». Ibid., p. 2289.
[31] C. Rist, « lettre au Comité central de la Ligue, 3 décembre 1904 ». Textes formant dossier. La délation aux Droits de l’homme. Cahiers de la quinzaine. 9e cahier de la 6e série (24 janvier 1905). ; p. 15 et s.
[32] C. Bouglé, « lettre à Pressensé ». ibid., p. 18.
Nota Bene : le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pourrez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).
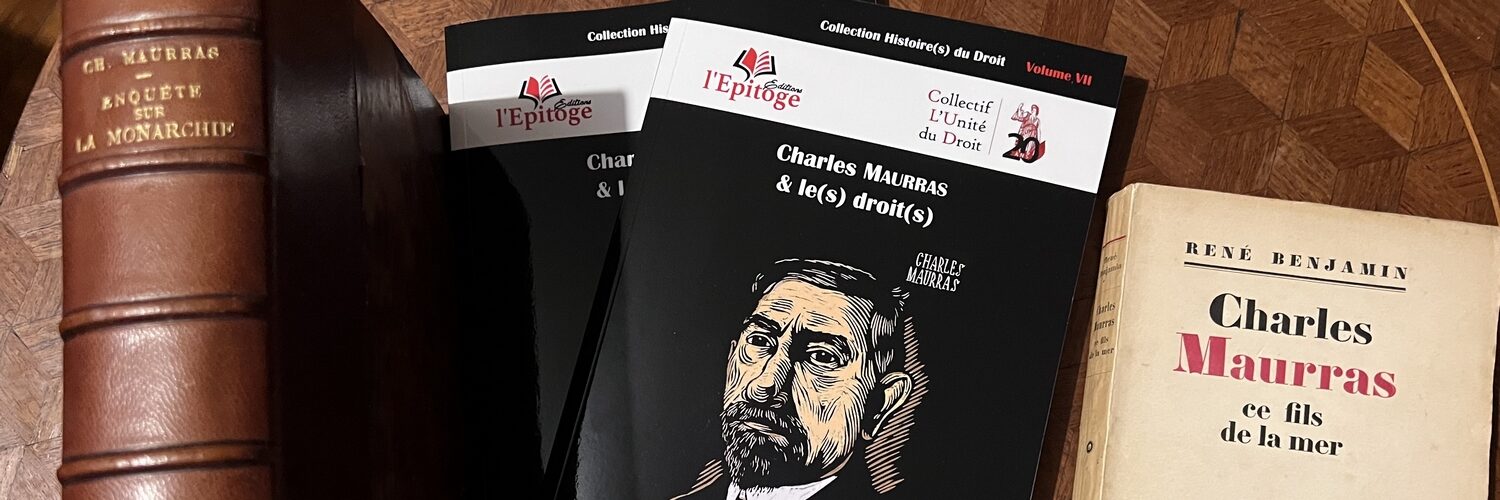
À propos de l’auteur