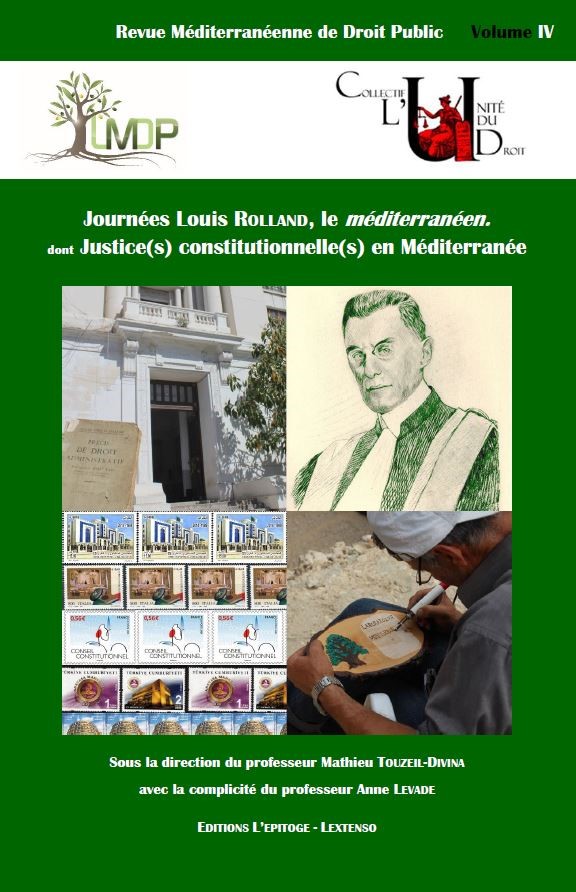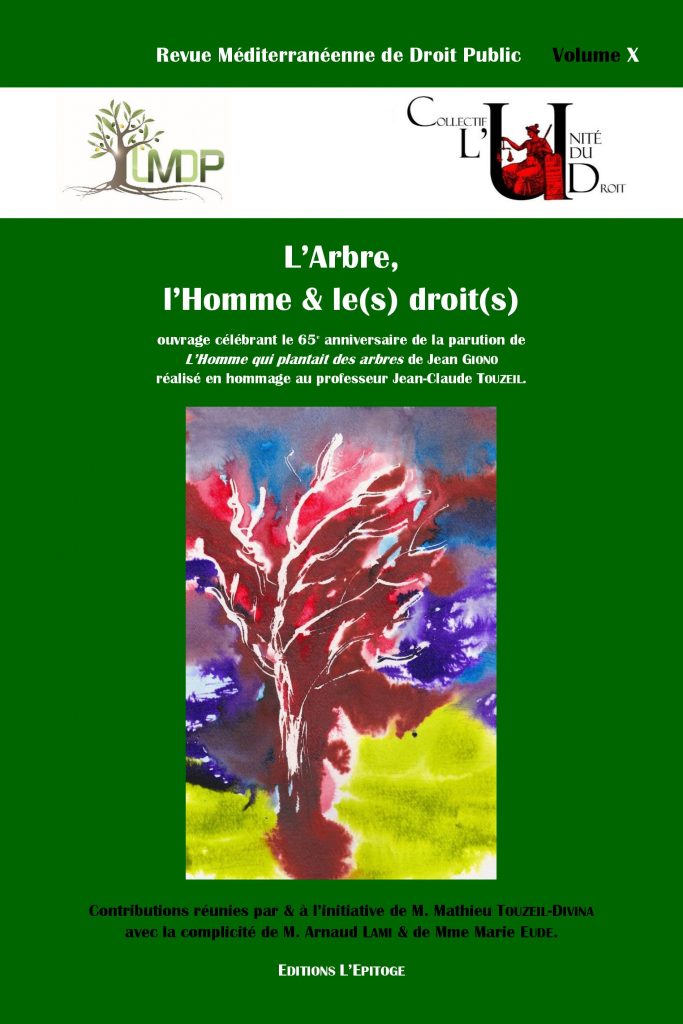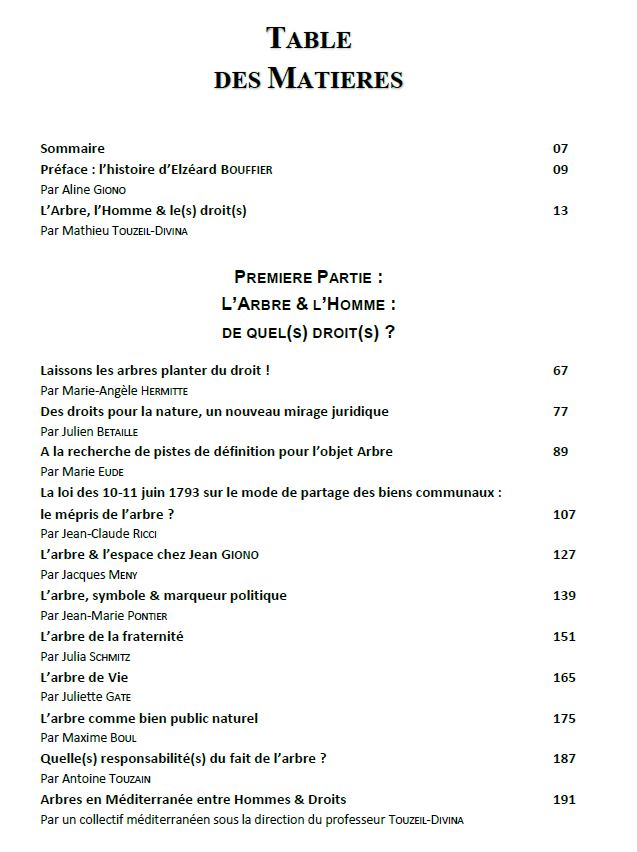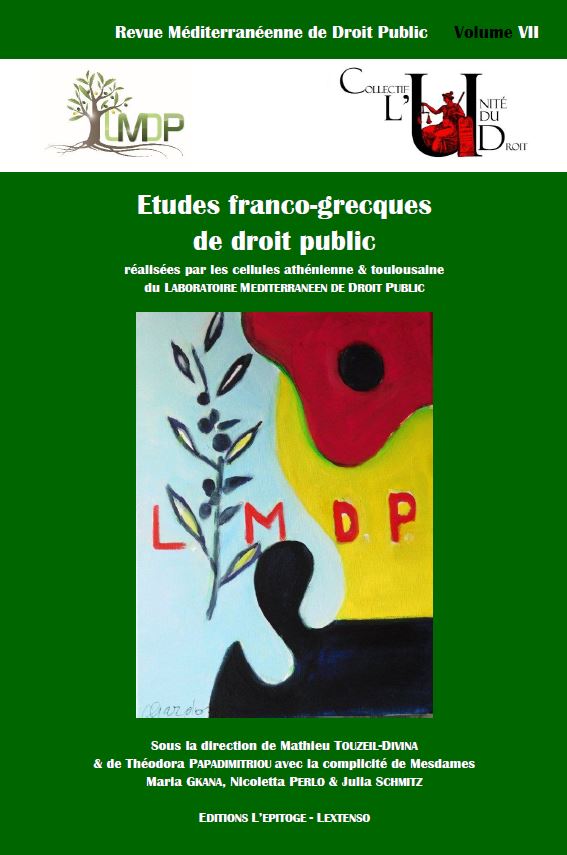Voici la 12e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 10e livre de nos Editions dans la collection dite verte de la Revue Méditerranéenne de Droit public publiée depuis 2013.
L’extrait choisi est celui de l’article de M. Raphaël Maurel dans l’ouvrage L’Arbre, l’Homme & le(s) droit(s).
Cet ouvrage est le dixième issu de la collection
« Revue Méditerranéenne de Droit Public (RM-DP) ».
Volume X :
L’Arbre, l’Homme
& le(s) droit(s)
ouvrage célébrant le 65e anniversaire
de la parution de L’Homme qui plantait des arbres
de Jean Giono & réalisé en hommage
au professeur Jean-Claude Touzeil.
Nombre de pages : 374
Sortie : avril 2019
Prix : 39 €
-ISBN / EAN :
979-10-92684-34-6 / 9791092684346
-ISSN :
2268-9893
L’eau & la forêt :
pistes pour une interaction
en droit international
Raphaël Maurel
Doctorant en droit international public,
Université Clermont Auvergne,
membre du Centre Michel de l’Hospital
(cmh – ea 4232), Collectif l’Unite du Droit[1]
La présente contribution s’insère dans une thématique
générale originale, voire provocatrice pour le juriste : « Un droit à l’eau pour les arbres ? ».
Se poser cette question semble, de prime abord, revenir à admettre l’hypothèse
selon laquelle l’arbre serait doté d’une forme de personnalité juridique,
laquelle lui permettrait de disposer en son nom-propre d’un certain nombre de
droits – ici, celui d’accéder à une eau suffisamment saine pour que son
développement soit assuré. Cette possibilité juridique n’est pas admise en
droit français, mais n’est pas exclue, s’agissant des forêts, dans d’autres
ordres juridiques[2].
Elle ne constitue néanmoins pas la seule manière d’envisager une éventuelle
interaction entre ces deux éléments dans l’ordre juridique international,
laquelle serait fondée sur le lien biologique existant entre eux.
La forêt, dont la définition ne se réduit pas à une
somme d’arbres mais évoque un écosystème complet, est regardée, dans la culture
populaire comme scientifique, comme un élément vital pour l’Homme. Certaines
croyances vont par ailleurs jusqu’à voir dans l’arbre et la forêt des objets ou
êtres vivants sacrés[3],
devant bénéficier d’une protection maximale. Outre la contribution des arbres à
la transformation du CO2 en oxygène, dont il n’est pas indispensable
de rappeler la nécessité pour l’homme, la communauté scientifique considère
tout aussi unanimement que la forêt est essentielle à la préservation d’une eau
saine[4].
Cette dernière étant également un impératif vital pour l’Homme, un dispositif
de protection s’impose logiquement – tel est le sens des actions menées, par
exemple, en faveur de la protection de la forêt de Marsabit, au Kenya[5]. Si
un lien scientifique existe donc
entre l’eau et la forêt, les liens juridiques
entre protection de la forêt et droit à une eau saine – c’est-à-dire,
principalement, non polluée[6] – ne
sont pas clairs, voire sont inexistants. Cette contribution propose ainsi d’analyser
succinctement, sous l’angle du droit international et en assumant un angle
prospectif, les liens possibles entre ces deux objets juridiques si distincts
mais si biologiquement proches, afin de déterminer si un schéma de protection
commun pourrait se dessiner et dans quelle mesure la forêt pourrait jouir d’un « droit à l’eau ».
Le droit international relatif à l’eau et le droit
international relatif à la forêt, pour autant que ce dernier existe en droit
positif[7],
relèvent tous deux de l’ensemble « droit
de l’environnement » et leurs objets sont identifiés comme des
ressources autonomes à protéger. Malgré cela, les deux domaines sont matériellement
distincts. Des liens sont donc à tout le moins envisageables en droit positif.
Mais sont-ils souhaitables ? En d’autres termes, est-il réellement utile de rechercher l’existence de tels
liens et, s’ils font défaut, est-il souhaitable de chercher à les établir ?
Nicolas Haupais souligne, à propos
de l’étude du paysage en droit international, que « ce qui peut souvent arriver de mieux à un paysage, c’est qu’on ne se
préoccupe pas de lui. Peut-être qu’une protection internationale n’aboutit en réalité
qu’à une protection platonique, ineffective[8] ». Assurément, l’étude des
interactions possible entre l’eau et la forêt est également un « tout petit sujet du droit international[9] » ;
mais l’évolution de l’humanité et ses conséquences sur son environnement
naturel et vital font qu’il devient essentiel de se préoccuper de la forêt. Si
le droit international protège de plus en plus l’eau, ou plutôt la relation de
l’Homme avec l’eau, en particulier au sein des systèmes régionaux de sauvegarde
des droits de l’Homme, il n’est pas déraisonnable d’imaginer un régime
juridique visant à garantir l’existence d’une ressource tout aussi vitale :
la forêt. Plus encore et sans verser dans un discours militant pour autant, une
telle démarche pourra apparaître utile aux yeux de ceux qui estiment, dans un
contexte de déforestation croissante et d’émergence du sujet sur la scène
médiatique internationale[10], qu’il
est urgent de mieux protéger la forêt et qui rechercheront des arguments
juridiques susceptibles d’être mobilisés à cet effet.
Pour développer ces éléments, l’on peut commencer par
analyser l’émergence parallèle de normes relatives à l’eau et à la forêt pour
en distinguer les différences structurelles et dénominateurs communs : c’est
en effet de la recherche des éventuelles interactions existantes qu’il faut
partir (I). Ce n’est qu’ensuite qu’il sera possible d’aborder quelques
options juridiques, esquissées plus haut, qui pourraient ouvrir la voie à une
interaction plus importante entre ces deux objets vitaux pour la planète – et l’Homme (II).
I. La distinction de l’eau et de la forêt en droit international
La protection de l’eau (A) et celle de la forêt (B)
constituent, en droit international, deux objectifs bien distincts dont il est
intéressant de retracer les grandes lignes. C’est en tentant de reconstituer
sur un plan historique le développement des normes internationales relatives à
ces deux éléments – au sens physique – que l’absence d’interaction entre eux
apparaît de manière évidente.
A. Le droit international relatif à l’eau,
une branche du droit des espaces à vocation économique
La recherche d’une définition de l’eau en droit
international conduira d’abord le néophyte à une surprise. L’on serait à
première vue enclin à distinguer deux « types » d’eau. L’eau de mer d’une part, dont on ne doute pas qu’elle
relève au moins en partie du droit international, en particulier au regard des
débats autour des drames en cours sur la Méditerranée qui amènent à affirmer
que « [l]a mare nostrum est
devenue mare mortum[11] ».
L’eau douce ou intérieure d’autre part, désignant les rivières, fleuves ou lacs
situés dans les terres. Pourtant, la réalité du droit international est bien
plus complexe. Le droit de la mer, largement codifié par la Convention de Montego Bay
de 1982[12],
prévoit des zones sous souveraineté nationale et diverses zones spécifiques à
côté de la « haute mer » qui, seule, jouit réellement d’un statut
international. Le régime des eaux intérieures n’est pour sa part pas uniforme ;
par exemple, certains lacs internationaux jouissent d’un statut particulier, à
l’instar de certains fleuves[13]. Le
dictionnaire de droit international dirigé par Jean Salmon ne recense ainsi pas moins de dix-sept catégories d’eaux
en droit international[14]. Si
certaines se recoupent, d’autres catégories revêtent plusieurs sens[15].
Le droit international relatif à l’eau – ou plutôt aux eaux – apparaît donc multiple et complexe. Toutefois, une unité
rassemble les règles qui le composent : au-delà du fait qu’il s’agit de
droits des espaces, ces règles ont essentiellement été dégagées dans une
perspective économique. Les grands principes juridiques régissant ces espaces s’articulent
en effet autour de la liberté de navigation, de la liberté de pêche ou encore
de l’exploitation des ressources telles que le gaz ou le pétrole. Il en ressort
que l’eau est avant tout considérée comme une route – commerciale – en droit international et en relations
internationales. Le fait que l’expression « fleuve international » ait été remplacée par celle de « voie d’eau internationale » dans la
Convention de Barcelone de 1921, pour ne prendre que cet exemple, est l’une des
manifestations de cette réalité[16].
Même la lutte contre la piraterie, source d’antiques règles coutumières en mer[17],
peut être analysée comme nécessaire au bon déroulement des relations
commerciales.
Néanmoins, les considérations modernes relatives à la
pollution des eaux ont invité les Etats à repenser cette branche de droit sous
l’angle environnemental[18], incluant
par la même occasion dans le spectre d’analyse le droit international
économique et relatif aux entreprises multinationales. Encore plus récemment et
au-delà des questions de navigation et d’environnement, un « droit international de l’eau » a
même pu être identifié comme grille d’analyse des systèmes de protection de l’eau
en tant que ressource[19]. Le
droit international relatif à l’eau a donc, ces deux derniers siècles, très
largement évolué dans un sens qui permet aujourd’hui d’envisager une relation
juridique avec la protection de la végétation, ressource naturelle elle aussi
menacée – par exemple par la pollution. Pourtant, la doctrine ne fait jusqu’ici
pas le lien entre forêt et eau.
Une évolution notable de la substance de la prise en
compte de l’eau en droit international est enfin à l’œuvre depuis quelques
décennies. D’une part, les Etats ont, dans le cadre du droit international du
patrimoine, élaboré des règles protégeant non pas l’eau (de mer)
elle-même, mais ce qu’elle contient[20]. Ensuite et surtout, l’on peut
constater le développement récent d’un « droit à l’eau », considéré comme un droit économique et social
de l’homme, fondé sur le fait que l’eau potable est un besoin vital pour l’Homme[21]. Ce droit, dont les prémices
remontent aux années 1970[22], relève pour l’instant
majoritairement du registre déclaratoire[23],
malgré sa mention anecdotique au sein de quelques conventions relatives aux
droits de l’homme[24] et,
parfois, sa consécration en droit interne – par la loi ou plus rarement en tant
que norme constitutionnelle comme en Egypte[25], en Rdc[26] ou
dans une dizaine d’autres Etats[27]. La
jurisprudence internationale est aussi, parfois, amenée à connaître de la
question. Dans une affaire portée devant le Centre international de règlement
des différends relatifs aux investissements (Cirdi), le Tribunal arbitral a ainsi ouvert la voie à une
reconnaissance du droit à l’eau en tant que principe général du droit
international[28].
Pour sa part, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a considéré en 2010
que le droit à l’eau en quantité suffisante et en qualité adéquate constituait
un élément du droit à la vie digne, protégé par la Convention américaine
relative aux droits de l’homme de 1969[29]. Ces
reconnaissances, qui se multiplient à mesure que les problématiques liées à l’accès
à l’eau s’accélèrent, laissent à penser que cet ensemble normatif prend
progressivement de l’ampleur et constituera sans doute, dans l’avenir, une
branche incontournable du droit international.
Nonobstant cette indéniable évolution récente vers un
droit à l’eau, le droit international
relatif à l’eau reste très majoritairement, quantitativement, un droit de l’eau empreint de considérations
économiques. Cela ne doit pas étonner, puisque malgré la prise en compte de l’impact
néfaste de l’Homme sur l’eau et l’action normative en découlant, environ 90%
des échanges commerciaux physiques passent aujourd’hui par la mer[30].
B. Le droit international forestier,
un projet normatif lié au droit de l’environnement
A l’inverse de l’eau, la forêt ne peut se prévaloir d’une
longue tradition de droit international la concernant.
Comme
le résume Stéphane Doumbe-Bille : « [s]chématiquement, on peut dire que jusqu’à la conférence de Rio en
1992, il n’y avait rien ; qu’après Rio il y a bien peu[31] ». S’il est vrai que la
Conférence des Nations unies pour l’environnement et le développement, tenue à
Rio en 1992, a marqué un tournant dans la conception internationale de la
forêt, ses conséquences sont relativement décevantes.
Avant 1992, plusieurs instruments mentionnaient la
forêt, d’abord en la protégeant par (lointain) ricochet comme habitat d’espèces
sauvages visées par accord[32]. Mais la forêt était toujours
évoquée ou protégée de manière accessoire, à l’occasion de l’adoption d’un
instrument dédié à une problématique spécifique différente[33]. En
d’autres termes, la forêt n’avait pas d’existence autonome en tant que notion
juridique objet d’un régime international spécifique, à la différence de la mer
ou du fleuve. Il faut néanmoins mentionner l’existence de plusieurs accords
internationaux sur les bois tropicaux[34],
dont le premier est antérieur à 1992. Ceux-ci concernent principalement le bois
sous un angle commercial et non l’écosystème général de la forêt ; un
point commun peut ici être identifié avec le droit international relatif à l’eau.
Certains auteurs analysent d’ailleurs la forêt sous un angle exclusivement
économique, rappelant que « les
forêts sont d’abord des richesses économiques et géostratégiques, en particulier
parce qu’elles produisent l’« or blanc » qu’est le papier, matière première support de l’information mondiale[35] ». Mais il serait aventureux de
se contenter d’une analyse économique de la forêt, celle-ci étant en réalité
principalement évoquée sous l’angle du développement durable.
A la suite de la Conférence de Rio, la question de la
forêt a été à l’ordre du jour d’autres Conférences internationales relatives à
l’environnement, comme celles de Kyoto en 1998 et de Johannesburg en 2002. Ces « événements, tout en n’aboutissant qu’à des
déclarations sur les forêts et non à un véritable droit international
forestier, ont influencé radicalement la perception et les pratiques
forestières, au Nord comme au Sud, au point d’entraîner des modifications sensibles
dans les législations nationales[36] ».
La doctrine s’accorde ainsi pour dire que le droit international forestier est
né en 1992 avec Rio[37],
sans toutefois s’accorder réellement sur sa valeur ni son contenu. Du point de
vue du droit positif, quand bien même elle aurait invité les Etats à adopter
des législations protectrices, la Déclaration de Rio n’est pas contraignante et
n’a pas été objectivement suivie de conventions à ce propos – malgré l’inclusion
des perspectives de développement durable dans les deux derniers accords sur
les bois tropicaux. Dans la mesure où la Déclaration n’a pas été suivie de
conventions créant des obligations claires, il faut admettre que le droit
international forestier demeure, à l’heure actuelle, un projet normatif composé
de la somme des normes – contraignantes ou non – relatives aux forêts
collectées dans d’autres traités. Comme le relève un auteur précité, ces
instruments se concentrent « sur des
aspects thématiques tels que : le commerce international du bois et des
produits forestiers, le changement climatique, l’érosion des sols, la
désertification, etc. Les aspects clés devant concourir à la protection de la
diversité biologique et forestière sont occultés. La divergence des intérêts et
le manque de volonté politique n’ont pas permis aux gouvernements d’adopter un
instrument juridique contraignant pour assurer la protection internationale des
forêts[38] ».
La Déclaration de New York sur les forêts, adoptée en 2014 en prévision de la
COP21, n’a pas fondamentalement changé la donne[39].
D’un autre côté, les forêts peuvent incidemment, en
tant que composantes de l’environnement, être protégées par certains systèmes
régionaux de protection des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de
l’homme offre ainsi une protection de l’environnement par ricochet, par l’intermédiaire
du droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la
Convention)[40].
Si cette protection a des limites, la Cour a eu l’occasion, dans l’affaire Kyrtatos
c. Grèce, de préciser qu’une violation de l’article 8 aurait pu être
retenue « si, par exemple, les
dommages à l’environnement dénoncés avaient occasionné la destruction d’une
zone forestière à proximité de la maison des requérants, situation qui aurait
pu affecter plus directement leur propre bien-être[41]». La forêt semble ainsi jouir d’une
protection plus importante qu’un marais – quand bien même celui-ci
accueillerait des espèces protégées – sous l’angle de l’article 8, ce qui ne
paraît pas, au regard de la jurisprudence de la Cour, d’une logique
incontestable[42].
Cette solution est néanmoins totalement centrée sur l’homme, et non sur la
forêt.
Il ressort de ces éléments que la forêt n’est que très
peu protégée en droit international. L’eau, quant à elle, fait d’une part l’objet
d’un nombre bien plus important de normes – dont la plupart ne la protège pas
mais régule son utilisation dans des buts économiques –, et, d’autre part
bénéficie d’une protection supérieure, bien que cette dernière soit souvent
relative à ce qui se trouve dans l’eau
et non à l’eau elle-même.
II. Pour la reconnaissance d’un lien juridique entre l’eau et la forêt en droit international
Dans ce second temps plus prospectif, il s’agit de
rechercher, sur la base des éléments dégagés jusqu’ici, si un lien entre l’eau
et la forêt serait susceptible de garantir une meilleure protection de la
forêt, et plus spécifiquement un droit à l’eau pour la forêt. Ce lien ne
saurait, à première vue, être d’emblée juridique, sans quoi il existerait
probablement déjà : il est d’abord nécessairement logique. Néanmoins, l’existence
d’un lien entre ces éléments peut entraîner des conséquences juridiques ;
ce sont celles-ci qui sont recherchées. A cet égard, il est possible de
réfléchir successivement aux conséquences de la reconnaissance d’un lien
analogique (A) puis téléologique (B) entre la protection de l’eau et
la protection de la forêt en droit international.
A. Première piste : l’analogie entre protection de l’eau
et protection de la forêt
Cette première piste repose sur une idée simple : la
forêt, comme l’eau, devrait être reconnue comme une res communis ou une res
nullius de l’humanité et être protégée à ce titre.
L’Assemblée du Conseil de l’Europe considère de longue
date que l’eau « est, juridiquement,
res communis[43] »,
c’est-à-dire un objet ou un bien ne pouvant faire l’objet d’une appropriation.
Si une telle solution a également été plaidée à l’égard des animaux[44],
dans le discours doctrinal actuel, seuls la mer, l’espace extra-atmosphérique
et l’Antarctique sont considérés comme res
communis[45].
L’eau terrestre est plutôt considérée comme res
nullius, c’est-à-dire comme une partie détachable et exploitable de la res communis, car son utilisation
implique une forme d’appropriation – via
des bassins hydrauliques par exemple –, même si cette qualification ne fait pas
l’unanimité[46]
et que la mer elle-même est parfois considérée comme une res nullius en devenir[47].
Sans entrer dans le détail de considérations techniques ou historiques quant à
ces notions, il suffit de constater que tant ce statut que celui de res nullius permet une protection – dont
l’efficacité est certes contestable, mais une protection tout de même. Il faut
cependant reconnaître qu’il est difficile, sur le plan logique, d’étendre l’une
ou l’autre qualification à la forêt par analogie : celle-ci peut en
réalité être appropriée, sur le plan physique, ce qui est plus difficile pour
la mer. La notion de patrimoine commun pourrait alors être utilement invoquée ;
celle-ci, en effet, « repose
davantage sur une volonté commune d’empêcher toute appropriation privative, que
sur une impossibilité d’appropriation de fait[48] ».
Tel est le cas des forêts classées et protégées par le Comité du patrimoine
mondial de l’Unesco[49]. Ce
régime n’empêche pas la déforestation massive par ailleurs : un régime
universel est nécessaire. Il apparaît en outre que la notion de « patrimoine » est, dans le discours
médiatique et du droit international, trop souvent associée à des éléments
importants mais non indispensables à la survie de l’espèce humaine. Or, la
forêt, au même titre que l’eau et l’air, lui est absolument vitale.
La notion de « bien
commun », inexistante en droit international, est parfois utilisée
dans un sens voisin au niveau national. Tel est par exemple le cas au Brésil,
où la forêt est considérée par la loi, depuis les années 1930, comme un « bien commun de tous les habitants du pays[50] ».
Mais ce statut semble aujourd’hui bien insuffisant : il suffit d’observer
l’accélération de la déforestation de la forêt amazonienne brésilienne pour s’en
convaincre. Le lien avec le manque d’eau potable dans le pays, rapporté par les
médias, est connu : la déforestation accélère le dégagement de CO2
et la pollution, et en conséquence, l’effet de serre, et la sécheresse[51]. La
situation, dont les prises de position du nouveau Président ne font que
suggérer qu’elle devrait empirer[52], est telle que la solution ne semble
plus être qu’internationale. En effet, au-delà d’une hypothétique ingérence
environnementale internationale voire d’une intervention armée à laquelle le
Brésil semble être préparé depuis des années, l’Etat « craint également que, sur le modèle de l’Antarctique,
l’Amazonie ne soit internationalisée, au nom de sa préservation[53] ».
La notion de bien commun propre à certains droits
internes ne semble donc pas toujours satisfaisante ni suffisante à protéger la
forêt. La notion de « bien public »
récemment utilisée en Slovénie pour constitutionnaliser le caractère non
marchandisable de l’eau ne semble, à cet égard, pas plus permettre d’éviter ces
possibles travers[54]. Par analogie avec l’eau, une
qualification de res communis ou de res nullius, bien que partiellement
insatisfaisante, ouvrirait probablement la voie à une protection plus
importante de la forêt. Une telle analogie ne semble pas inenvisageable au
niveau international, même si la démarche privilégiée par la Déclaration de Rio
est l’absence d’internationalisation[55]. Il
arrive fréquemment que les Etats associent eux-mêmes l’eau et la forêt lorsqu’il
est question de ressources à protéger. La position officielle du Canada révèle
ainsi que « [l]’eau à l’état naturel
peut se comparer à d’autres ressources naturelles comme les arbres de la forêt,
les poissons dans la mer ou les minéraux du sol. Même si toutes ces choses
peuvent être transformées en articles commerciaux par la récolte, la pêche ou l’extraction,
elles demeurent, jusqu’à ce que cette étape cruciale soit franchie, des
ressources naturelles[56] ».
Mais quand bien même le statut de ressources naturelles
serait accompagné d’un dispositif juridique suffisamment protecteur pour
garantir que les forêts – ou plutôt certaines forêts – disposent d’une eau
saine, le raisonnement par analogie a ses limites : s’il peut permettre
une protection renforcée de la forêt, il n’apparaît pas en mesure de lui
garantir un « droit à l’eau ».
B. Deuxième piste :
le lien téléologique entre la protection de l’eau et la protection de la forêt
Une deuxième piste peut être suivie à partir d’une
autre proposition, selon laquelle la finalité d’un droit peut amener à protéger
un autre objet. Alors que la consécration d’une protection par analogie ne
constitue finalement qu’une faible interaction intellectuelle entre les deux
objets « eau » et « forêt », un raisonnement
téléologique implique une interaction logique plus avancée. Ainsi peut-on
envisager l’hypothèse selon laquelle la finalité du droit à l’eau pourrait
impliquer un droit de la forêt à l’eau.
Cette perspective part du constat selon lequel la
finalité du droit à l’eau est de garantir l’existence du vivant. Or, l’arbre,
composante de la forêt, est un être vivant ; tout comme les végétaux et
les animaux qui y vivent – soit l’intégralité de ses composantes à l’exception
des minéraux. Il n’y alors qu’un pas à franchir pour admettre que la forêt
peut être considérée comme un être vivant. Dans ce cas, l’attribution d’une
personnalité juridique pourrait lui permettre…d’exiger une eau saine en son nom
propre.
Sans aller jusqu’à une personnification complète, tel
est d’ores et déjà le cas s’agissant d’autres êtres vivants. Des accords
prévoient ainsi que certains animaux ont droit – ou devraient avoir droit – à une
eau saine. Ainsi le Conseil de l’Europe a-t-il estimé dès les années 1980 que « [t]ous les animaux devraient disposer en
permanence d’eau potable non contaminée. L’eau est un vecteur de
micro-organismes, et c’est pourquoi elle devrait être fournie de façon à
minimiser les risques de contamination[57] ».
Sans refléter une bienveillance angélique excessive à l’égard des animaux,
puisqu’il s’agit d’animaux destinés à la recherche expérimentale, ces lignes
directrices fixent un cadre non contraignant qui a pu être repris et renforcé
par l’Union européenne. La directive 2010/63/EU prévoit en effet que « [t]ous les animaux doivent disposer en
permanence d’eau potable non contaminée[58] ».
Bien que ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la recherche
scientifique et visent essentiellement à garantir sa qualité, elles pourraient
être étendues à l’activité – au moins scientifique – en forêt et constituer la
base d’une obligation contraignante de ne pas polluer les eaux qui y coulent.
La seconde hypothèse, plus engageante sur le plan
philosophique, est d’accorder une personnalité juridique aux arbres – ce qui
pourrait fonder un droit propre à l’eau. Celle-ci n’est pas nouvelle. Dès 1972,
le désormais célèbre article de Christopher D. Stone
le proposait déjà[59]. Si
la proposition a été reprise en France par Jean-Pierre Marguenaud à propos des animaux[60], la
doctrine a globalement envisagé la question sous l’angle axiologique voire
politique plutôt que sous l’angle de la technique juridique[61].
Pourtant, à « la lecture des
arguments de ces deux auteurs, force est de constater qu’il ne demeure pas d’obstacle
juridique décisif à la reconnaissance de la personnalité juridique des animaux
ou de l’environnement. Le choix apparaît bien davantage moral et philosophique
que strictement juridique[62] ».
Certains Etats ne s’en sont d’ailleurs pas privés. La Constitution de l’Equateur
dispose non seulement que « [n]ature
shall be the subject of those rights that the Constitution recognizes for it[63] »,
mais prévoit en outre un chapitre 7 intitulé « droits de la nature »
selon lequel « [n]ature, or Pachamama, where life is reproduced and
occurs, has the right to integral respect for its existence and for the
maintenance and regeneration of its life cycles, structure, functions and
evolutionary processes[64] ».
La nature dispose enfin d’un droit à la « restauración », que l’on peut traduire par un droit à la
restauration ou à la régénération en cas d’atteinte[65].
Plus récemment, la Nouvelle-Zélande a légiféré pour accorder la qualité d’être
vivant et une personnalité juridique à un fleuve sacré : « Te
Awa Tupua is a legal person and has all the rights, powers,
duties, and liabilities of a legal person[66] ».
La solution s’est ensuite étendue à l’Inde, cette fois-ci par l’intermédiaire
jurisprudentiel : « [l]es
suites furent retentissantes : le Gange,
et son affluent la Yamuna, sont
dorénavant des entités juridiques vivantes qui ont « les mêmes droits que les êtres humains », tout comme les glaciers de l’Himalaya Gangotri et Yamunotri, sources de ces deux fleuves sacrés[67] ».
Même si la décision de la High Court[68] a
été suspendue par la Cour Suprême indienne en attendant une solution au fond[69], d’autres
exemples montrent que de telles solutions se répandent peu à peu à travers le
monde[70].
Techniquement, la possibilité anthropomorphique[71] d’accorder
à la forêt une person-nalité juridique lui permettant de jouir de droits n’est
donc pas iconoclaste, même si les systèmes européens ne sont pas coutumiers de
ces choix basés, au moins en partie, sur des orientations religieuses ou des
croyances. Dans les trois cas mentionnés, la nature ou le fleuve jouissaient en
effet d’un statut sacré que le droit positif est venu confirmer – ou consacrer.
Toutefois, il est loisible de se demander si l’Homme ne devrait pas plus « croire » dans la nature et admettre
que, biologiquement, il a un besoin vital qu’elle demeure saine. Une
reconnaissance d’une personnalité juridique à la forêt lui permettrait alors d’exiger,
par la voie de gardiens – peut-être les gardes champêtres en voie de
disparition depuis 1958 en France ? – une eau saine pour son
développement, et par ricochet la bonne santé de l’humanité.
[1] L’auteur remercie chaleureusement Mmes Marie Duclaux de
l’Estoille, María Lorenzo Martinez,
M. le Professeur Valère Ndior et
M. Sacha Robin pour leurs
relectures attentives et leurs suggestions.
[2] Voir infra,
II.B.
[3] Hayao Miyazaki
s’est d’ailleurs inspiré de ces croyances dans ses œuvres, en particulier pour
réaliser la forêt de Princesse Mononoké (Studio
Ghibli, 1997). Il n’est pas
anodin, à ce propos, que Miyasaki
se soit déclaré admiratif du travail de Frédéric Back…réalisateur du court-métrage oscarisé L’homme qui plantait des arbres (1987).
Voir sur ce point Fournier
Mauricette, « La forêt de Princesse Mononoké d’Hayao Miyazaki : une contribution
poétique à la prise de conscience environnementale » in Decaulne Armelle (dir.),
Arbres et Dynamiques,
Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal,
2013, p. 203 et s.
[4] La forêt permet une infiltration complète des eaux de
pluie, le stockage d’autres types de précipitations comme le brouillard ;
elle est également essentielle à la préservation et à la stabilité des sols des
bassins versants.
[5] L’Agence Française de Développement finance ainsi un
ambitieux projet visant à fournir aux habitants de la région des points d’eau
potable à l’extérieur de cette forêt, qui est la principale source d’eau, et à
les inciter à économiser ses ressources en bois. Voir l’exposé du projet sur le
site de l’organisme : https://www.afd.fr/fr/kenya-quand-la-foret-veille-sur-leau.
[6] Le choix de définir une eau « saine » comme
une « eau non polluée » peut naturellement faire débat. Par
commodité, cette équation schématique sera retenue malgré la conscience que la
question est éminemment plus complexe, notamment au regard des sciences de la
terre.
[7] Voir infra,
I.B.
[8] Haupais
Nicolas, « Le paysage du droit international public » in « Cependant, j’ai besoin d’écrire… ». Liber Amicorum en l’honneur de Serge Sur, Paris, Pedone, 2014, p. 121.
[9] Idem.
[10] En particulier, l’élection du Président brésilien Jair Bolsonaro
en 2018 suscite de vives inquiétudes quant à l’avenir des forêts brésiliennes,
dont la destruction pourrait s’accélérer. Voir infra, note 52.
[11] Miron
Alina, Taxil Bérangère, « Requiem pour l’Aquarius. Les sauvetages
en mer, entre instrumentalisation et criminalisation », La Revue des droits de l’homme, n°15,
2019, §1. Consultable en ligne à l’adresse : http://journals.openedition.org/revdh/5941.
[12] Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
Montego Bay, 10 décembre 1982, Rtnu, vol. 1834, 1994, p. 36.
[13] Voir par exemple Cazala
Julien, « Le droit international de l’eau et les différends relatifs au
Tigre et à l’Euphrate » in Boisson de chazournes Laurence, Salman Mohamed Ahmed, Les ressources en eau et le droit
international, Académie de droit international, Leiden/Boston, Martinus
Nijhoff Publishers, 2005, p. 544 et s.
[14] Salmon
Jean (dir.), Dictionnaire de droit
international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 404, entrée
« Eaux ». Par exemple : eaux adjacentes, eaux archipélagiques,
eaux de surface, eaux douces, eaux intérieures de surface, eaux neutres, eaux
surjacentes, eaux transfrontières…
[15] Par exemple, les eaux superficielles sont des eaux de
surface ; mais les eaux surjacentes peuvent revêtir plusieurs sens.
[16] Voir sur ce point Daillier
Patrick, Forteau Mathias, Pellet Alain, Droit international public (Ngyuen Quoc Dinh †), Paris, Lgdj, 8e éd., 2009,
p. 1370.
[17] La criminalisation de la piraterie en mer serait
intervenue sous l’Empire romain ; voir Sestier
Jules M., La piraterie dans l’Antiquité,
Paris, Librairie de A. Marescq
ainé, 1880, p. 276 ; Senly
André, La piraterie, Paris, Arthur Rousseau Editeur, 1902, p. 23.
[18] Aurescu Bogdan,
Pellet Alain (dir.), Actualité du droit des fleuves
internationaux, Paris, Pedone, 2010.
[19] Sfdi, L’eau en droit international. Colloque d’Orléans, Paris, Pedone, 2011 ; Brown Weiss
Edith, « The Evolution of International Water Law », Rcadi,
2007, vol. 331, p. 163 et s.
[20] Voir par exemple la Convention sur la protection du
patrimoine culturel subaquatique, Paris, 6 novembre 2001, Unesco, Conférence Générale, 31e
session, doc. 31 C/64 du 31 octobre 2001, et à son propos Scovazzi Tullio, « La Convention sur
la protection du patrimoine culturel subaquatique », AFDI, vol. 48, 2002, p. 579. La France, qui est considérée
comme un expert mondial en matière de protection du patrimoine culturel
subaquatique, ne l’a ratifiée qu’en 2013. Certaines de ses réticences, liées à
une interprétation selon laquelle certaines protections entreraient en
contradiction avec les grandes libertés garanties par la Convention de Montego
Bay, sont partagées par de nombreux Etats, puisque seuls 60 Etats sont Parties
à cet instrument en janvier 2019. Voir également BORIES Clémentine, « La
protection du patrimoine culturel subaquatique » in Forteau Mathias, Thouvenin Jean-Marc, Traité de droit international de la mer, Paris, Pedone, Cedin, 2017, p. 891.
[21] Voir en particulier Coulee
Frédérique, « Le droit à l’eau dans le contexte international. Brèves
remarques à propos d’un droit économique émergent » in Droit international et culture juridique, Mélanges offerts à Charles Leben,
Paris, Pedone, 2015, p. 57 et s.
[22] Dupont-Rachiele Jérôme, Prevost Daniel, Raymond
Sébastien, « L’eau : un droit pour tous ou un bien pour
certains », RQDI, vol. 17.1,
2004, p. 62 et s.
[23] Voir en particulier la résolution 54/175 de l’Assemblée
générale des Nations unies du 17 décembre 1999 relative au droit au
développement, et plus généralement Dubuy
Mélanie, « Le droit à l’eau potable et à l’assainissement et le droit
international », Rgdip, vol. 116, n°2, 2012,
p. 275 et s. ; spéc. p. 295 et s.
[24] Aux termes de l’article 24.2 de la Convention relative
aux droits de l’enfant, « [l]es
Etats parties […] prennent les
mesures appropriées pour : […]
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de
soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques
aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable,
compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel » (Convention
relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations
unies par la résolution 44/25 du 20 novembre 1989, Rtnu, vol. 1577, 1999,
p. 3).
[25] Constitution amendée de la République arabe d’Egypte,
15 janvier 2014, article 79 : « [t]out
citoyen a droit à une alimentation saine et suffisante et de l’eau potable ».
L’article 68 de la défunte Constitution de la Seconde République du 26 décembre
2012 prévoyait que « le droit à une
habitation convenable, une eau potable et une alimentation saine est garanti ».
[26] Constitution de la République Démocratique du Congo,
telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du
18 février 2006, article 48 : « [l]e
droit à un logement décent, le droit d’accès à l’eau potable et à l’énergie
électrique sont garantis ».
[27] Une brève analyse de ces Constitutions est présentée
par Coulee Frédérique, « Le
droit à l’eau dans le contexte international. Brèves remarques à propos d’un
droit économique émergent », op. cit.
note 21, p. 65 .
[28] Cirdi, Saur International S.A. c. République
argentine, affaire n° ARB/04/4, sentence du 6 juin 2012, §330 : « [e]n réalité, les droits de l’homme en
général, et le droit à l’eau en particulier, constituent l’une des diverses
sources que le Tribunal devra prendre en compte pour résoudre le différend car
ces droits sont élevés au sein du
système juridique argentin au rang de droits constitutionnels, et, de plus, ils
font partie des principes généraux du droit international ».
[29] Cidh, Communauté Xákmok Kásek c. Paraguay, 24 août 2010, §§ 194 et196.
[30] Forteau Mathias,
Thouvenin Jean-Marc,
« Introduction » in Forteau Mathias, Thouvenin Jean-Marc, Traité
de droit international de la mer, op. cit.
note 20, p. 24.
[31] Doumbe-Bille Stéphane, « Le cadre juridique
international relatif aux forêts – Etat de développement » in Cornu
Marie, Fromageau Jérôme, Le droit de la forêt au XXIe
siècle. Aspects internationaux, L’Harmattan, 2004, p. 124.
[32] Ainsi, la « Convention
de Paris du 19 mars 1902 relative à la protection des oiseaux pour l’agriculture
est la première Convention internationale dont l’objectif est de protéger les
espèces sauvages, leurs habitats et par ricochet la forêt » (Houedanou Sessinou Emile, La gestion transfrontalière des forêts en
Afrique de l’Ouest, Paris, L’Harmattan, Collection « Etudes africaines »,
2015, p. 39).
[33] L’auteur cité dans la note précédente dresse une liste
de ces conventions pour aboutir à cette conclusion ; voir ibid., p. 39.
[34] Accord international de 1983 sur les bois tropicaux,
Genève, 18 novembre 1983, Rtnu, vol. 1393, 1996, p. 76 ;
Accord international de 1994 sur les bois tropicaux, Genève, 26 janvier 1994, Rtnu,
vol. 1955, 2001, p. 81 ; Accord international de 2006 sur les bois
tropicaux, Genève, 27 janvier 2006, Rtnu, vol. 2797, 2011, p. 75.
[35] D’antin de
Vaillac Dominique, « La forêt comme objet de relations
internationales ? », AFRI,
2005, vol. 6, 927.
[36] Ibid.,
p. 925.
[37] De Rezende Menezes
Quênida, « Le droit international peut-il sauver les dernières forêts de
la planète ? », Paris, L’Harmattan, 2013, p. 165.
[38] Houedanou
Sessinou Emile, La gestion
transfrontalière des forêts en Afrique de l’Ouest, op. cit. note 32, p. 199. Voir également l’exposé très clair, bien qu’un peu daté
de Doumbe-Bille Stéphane, « Le cadre juridique international
relatif aux forêts – Etat de développement », op. cit. note 31, p. 121 et s.
[39] Pour un résumé de ses apports et du contexte de son
adoption, voir Mekouar Mohamed
Ali, « La Déclaration de New York sur les forêts du 23 septembre 2014 :
quelle valeur ajoutée ? », Revue
juridique de l’environnement, vol. 40, n° 2015/3, p. 463 et s.
[40] Voir en particulier Cedh,
López
Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, requête n°16798/90, §51 : « [i]l va pourtant de soi que des atteintes
graves à l’environnement peuvent affecter le bien-être d’une personne et la
priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et
familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de l’intéressée ».
[41] Cedh, Kyrtatos
c. Grèce, 22 mai 2003, requête n° 41666/98, § 53. Dans les faits, des
aménagements urbains avaient détruit le marais adjacent à la propriété des
requérants, qui arguaient notamment que le site dans lequel est situé leur
domicile avait perdu toute sa beauté et que la destruction avait causé un
dommage à l’environnement, en particulier aux oiseaux et espèces protégées
vivant dans le marais.
[42] Sur cette question, voir Michallet Isabelle, « Cour européenne des droits de l’homme
et biodiversité » in Robert Loïc (dir.), L’Environnement et la Convention européenne
des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 94 et s.
[43] Assemblée consultative du Conseil de l’Europe, Rapport sur la lutte contre la pollution des
eaux douces en Europe, 1965, IIIe partie, chapitre 1.
[44] Voir la présentation de l’idée par Camproux-Duffrene
Marie-Pierre, « Plaidoyer civiliste pour une meilleure protection
de la biodiversité. La reconnaissance d’un statut juridique protecteur de l’espèce
animale », Revue interdisciplinaire
d’études juridiques, vol. 60, n° 2018/1, p. 4 et s.
[45] Kolb
Robert, Théorie du droit international,
2e édition, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 67.
[46] Haupais
Nicolas, « Le paysage du droit international public », op. cit. note 8, p. 666.
[47] Certains auteurs considèrent en effet que « l’évolution récente montre que dès que [les
Etats côtiers] ont les capacités techniques ou l’autorité politique
nécessaires, ils s’étendent vers le large au détriment de la haute mer ;
amputée des zones économiques exclusives, des plateaux continentaux, celle-ci
semble plus proche d’une res nullius éphémère dans l’attente du partage des
océans » (Charpentier
Jean, « La communauté internationale : mythe ou réalité ? » in L’homme dans la société internationale.
Mélanges en hommage au Professeur Paul Tavernier,
Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 39, renvoyant notamment à Dupuy René-Jean, « Droit de la mer
et Communauté internationale » in Mélanges
offerts à Paul Reuter. Le droit
international : unité et diversité, Paris, Pedone, 1979, p. 221
et s.).
[48] Lambert-Habib Marie-Laure, Le commerce des espèces sauvages : entre droit international et
gestion locale. Réflexions sur la C.I.T.E.S. (Convention de Washington sur
le commerce international des espaces de faune et de flore sauvages menacés d’extinction),
Paris, L’Harmattan, 2000, p. 331.
[49] L’Unesco
s’efforce, depuis sa 25e session en 2001, d’être leader dans la protection mondiale des
forêts. En partie grâce à la création du Programme des forêts du patrimoine
mondial, le nombre de sites forestiers du patrimoine mondial est actuellement
de 107, couvrant un total de 75 millions d’hectares – soit 1,5 fois la taille
de la France. Ce chiffre apparaît néanmoins bien dérisoire dans la mesure où la
déforestation détruirait 13 millions d’hectares chaque année.
[50] Voir Leme
Machado Paulo Affonso, « Les
nouveautés dans la législation brésilienne sur la protection des forêts »,
Revue juridique de l’environnement,
vol. 40, n° 2015/1, p. 60.
[51] Par exemple, « Le manque d’eau potable, un
paradoxe au Brésil », Le Journal du
Dimanche en ligne, 29 novembre 2015, consultable à l’adresse : https://www.lejdd.fr/International/Ameriques/Le-manque-d-eau-potable-un-paradoxe-au-Bresil-761955.
[52] Selon les médias, Jair Bolsonaro
envisage la reprise des travaux de rénovation de la BR-319, une autoroute
traversant l’Amazonie, et prévoit de faciliter l’implantation d’activités
économiques dans des zones pour l’instant protégées par la loi ou les
collectivités locales. La fusion des ministères de l’Environnement et de l’Agriculture
semble aller dans ce sens. Voir Donada
Emma, « Quel est le programme de Jair Bolsonaro
pour l’Amazonie ? », Libération
en ligne, 12 octobre 2018, consultable en ligne à l’adresse : https://www.liberation.fr/checknews/2018/10/12/quel-est-le-programme-de-jair-bolsonaro-pour-l-amazonie_1684630.
[53] Geslin
Albane, « Etats et sécurité environnementale, états de l’insécurité
environnementale : de la recomposition normative des territoires à l’esquisse
d’un droit de l’anthropocène » in Tercinet Josiane (dir.), Etats et sécurité internationale,
Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 92.
[54] Naim-Gesbert Eric, « Voyage aux confins
du droit de l’environnement » in Touzeil-Divina
Mathieu, Hoepffner Hélène (dir.),
Droit(s) du Bio, Toulouse, Boulogne
et Pau, Editions l’Epitoge, coll. l’Unité du Droit, vol. XXIII, octobre 2018,
p. 169.
[55] D’Antin de Vaillac
Dominique, « La forêt comme objet de relations internationales ? »,
op. cit. note 35, p. 929.
[56] Ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international, « Les prélèvements massifs d’eau et considérations »,
Washington D.C., Ambassade du Canada, 1999, extrait cité et analysé par dupont-Rachiele
Jérôme, Prevost Daniel, Raymond Sébastien, « L’eau : un
droit pour tous ou un bien pour certains », op. cit. note 22, p. 68. Voir ibid. l’étude
de l’ambiguïté de cette position dans le cadre du Gats.
[57] Lignes directrices relatives à l’hébergement et aux
soins des animaux, annexe A à la Convention européenne sur la protection des
animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins
scientifiques du 18 mars 1986, STE,
n°123, 15 juin 2006, article 4.7.1.
[58] Directive 2010/63/EU relative à la protection des
animaux utilisés à des fins scientifiques, Annexe III. Exigences relatives aux
établissements et exigences relatives aux soins et à l’hébergement des animaux,
Joue
du 20 octobre 2010, L 276, article 3.5.a).
[59] Stone Christopher D., « Should Trees
Have Standing? Toward legal Rights for natural Objects », Southern California Law Review, vol. 45,
n° 1972/2, p. 450 et s.
[60] Marguenaud
Jean-Pierre, « La personnalité juridique des animaux », Dalloz, 1998, p. 205.
[61] Betaille
Julien, « La doctrine environnementaliste face à l’exigence de neutralité
axiologique : de l’illusion à la réflexivité », Revue juridique de l’environnement, hors-série, n° 2016/HS16,
p. 45.
[62] Betaille
Julien, Les conditions juridiques de l’effectivité
de la norme en droit public interne : illustrations en droit de l’urbanisme
et en droit de l’environnement, Thèse de droit public soutenue le 7
décembre 2012, Université de Limoges, p. 518. Voir ibid. p. 519 et s. pour une analyse des arguments des
tenants et opposants de la proposition, qu’il conclut en demi-teinte : l’institution
nécessaire de « guardians »
ou représentants capables d’exprimer la volonté de la nature – en la
personnifiant – ne serait pas très différente de la capacité contentieuse
actuelle des associations de protection de l’environnement.
[63] Constitution de la République d’Equateur, 20 octobre
2008, article 10.
[64] Ibid.,
article 71.
[65] Ibid., article
72.
[66] Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement)
Act 2017 n°7, Royal assent 20 March 2017, article 14.1.
[67] Naim-Gesbert Eric, « Etres et choses en
droit de l’environnement : l’appel du sacré », Revue juridique de l’environnement, vol. 42, n° 2017/3,
p. 406.
[68] High Court of
Uttarakhand, Mohd Salim v. State of
Uttarakhand & others, No.126 of 2014, 20 march 2017.
[69] O’Donnell Erin L, Talbot-Jones
Julia, « Creating legal rights for rivers : lessons from Australia,
New Zealand, and India », Ecology and
Society, vol. 23-7, 2018, p. 10 , spéc. l’instructif tableau
comparatif, sous l’angle juridique, des trois cas analysés p. 11. Mais cette suspension intervenue en juillet 2017 ne
semble pas impliquer en tant que telle la remise en cause de l’attribution de
la personnalité juridique au fleuve. Les « gardiens » imposés par la High
Court (l’Etat de Uttarakhand, ou plus précisément le « Chief Secretary of the State of Uttarakhand
and the Advocate General of the State of Uttarakhand » nommément désignés
par la Cour) ont en effet eu temporairement gain de cause en montrant que les
contours de leur responsabilité n’était pas claire, ces rivières s’étendant
au-delà des frontières de l’Etat (notamment au Bangladesh). Voir également O’Donnell Erin L, « At the Intersection of the Sacred and the Legal :
Rights for Nature in Uttarakhand, India », Journal of Environmental Law, Vol. 30-1, 2018, p. 135
et s.
[70] Naim-Gesbert Eric, « Voyage aux confins
du droit de l’environnement », op. cit.
note 54, p. 170.
[71] La doctrine critique ainsi une
« anthropomorphisation juridique de la nature » : Serrurier Enguerrand, La résurgence du droit au développement.
Recherche sur l’humanisation du droit international, Thèse de droit public
soutenue le 5 octobre 2018, Université Clermont Auvergne, p. 483
et s. ; l’expression est mentionnée p. 483.
Nota Bene : le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso. Vous pouvez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).