Voici la 2e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du premier livre de nos Editions dans la collection Histoire(s) du Droit, publiée depuis 2013 et ayant commencé par la mise en avant d’un face à face doctrinal à travers deux maîtres du droit public : Léon Duguit & Maurice Hauriou.
L’extrait choisi est celui du commentaire de la note – par M. le professeur Arnaud de Nanteuil – du doyen Hauriou au lendemain de l’arrêt CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage dite « Gaz de Bordeaux » ; arrêt particulièrement intéressant en ces jours de confinement.

Volume I :
Miscellanées Maurice Hauriou
Ouvrage collectif
(Direction Mathieu Touzeil-Divina)
– Nombre de pages : 388
– Sortie : décembre 2013
– Prix : 59 €
- ISBN / EAN : 978-2-9541188-5-7 / 9782954118857
- ISSN : 2272-2963

Note sous CE, 30 mars 1916,
Compagnie générale d’éclairage dite « Gaz de Bordeaux »
in Recueil Sirey ; 1916.III.17 & La Jurisprudence administrative (III ; 578).
Présentation de M. le professeur
Arnaud de Nanteuil,
Université du Maine,
Themis-Um (ea 4333),
Directeur adjoint de l’Ecole
doctorale Pierre Couvrat (ed 88)
I. Note de Maurice Hauriou,
publiée au Recueil Sirey
On a souvent loué le Conseil d’Etat d’être une juridiction d’équité, compliment dangereux, parce qu’il provoque immédiatement la riposte bien connue : « Dieu nous garde de l’équité des Parlements » ! Il serait à la fois plus exact et plus prudent de le louer d’être une jurisprudence sociale, c’est-à-dire d’orienter sa jurisprudence vers une justice élargie, toute pénétrée d’intérêt public. Jamais ce caractère social ne s’était affirmé aussi nettement que dans l’arrêt dont nous entreprenons le commentaire, dont l’importance a été immédiatement soulignée, et dont la nouveauté plus apparente que réelle a provoqué des étonnements et des critiques passionnées (V. Rev. Polit. et parl., mai 1916, p. 264, lettre de M. Duguit).
Un concessionnaire de l’éclairage au gaz est lié à une ville par un traité formel ; ce contrat prévoit des variations dans le prix des charbons, matière première de la fabrication, et admet des variations proportionnelles dans le prix du mètre cube de gaz ; cependant, il fixe un prix maximum, que le prix du gaz ne pourra dépasser en aucun cas. Survient la guerre, qui entraîne la hausse énorme que l’on sait sur les charbons ; la Compagnie du gaz déclare qu’elle ne peut plus assurer le service ; elle demande que la ville vienne à son secours ; le Conseil d’Etat lui donne en principe raison ; non seulement il ne la condamne pas à continuer la fourniture du gaz au prix maximum du contrat, mais il n’admet même pas que le contrat puisse être résilié ; la ville sera obligée de supporter la Compagnie, laquelle continuera d’assurer le service, et la ville devra une indemnité compensatrice de la hausse des charbons, dans une mesure à déterminer, à moins que les parties ne préfèrent passer, pour la durée de la guerre, une nouvelle convention, qui contiendra un relèvement du prix des abonnements à la charge des consommateurs. Voilà pour le fond de la décision.
En la forme, le Conseil d’Etat adopte une procédure de jugement qui paraît surprenante. Il est saisi de l’affaire en qualité de juge d’appel, le conseil de préfecture de la Gironde ayant statué en premier ressort. Or, il ne termine pas lui-même le procès ; il le coupe en deux ; il établit seulement le principe que la ville doit venir en aide à la Compagnie, et que, si elle ne le fait pas à l’amiable, elle devra être condamnée à une indemnité ; puis il renvoie les parties à s’entendre, ou, sinon, à recommencer un second procès devant le conseil de préfecture. Toutes ces singularités sont admirablement exposées et expliquées dans les remarquables conclusions de M. le commissaire du gouvernement Chardenet, qu’on lira plus haut. Le rôle très modeste de l’arrêtiste consistera simplement à ajouter quelques éclaircissements spécialement destinés à répondre aux objections et aux critiques qui ont déjà été formulées ou qui pourraient encore l’être. Ces éclaircissements porteront sur les points suivants : 1° la conception du contrat de concession de service public d’après la jurisprudence du Conseil d’Etat ; 2° le rôle du juge d’appel d’après la même jurisprudence ; 3° la question du partage de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction civile, à propos de la répercussion de ces événements sur les abonnés au gaz.
§ 1
Le Conseil d’Etat a élaboré, depuis un certain nombre d’années, une théorie du contrat de concession de service public qui est allée toujours s’éloignant des principes du droit civil, et qui devait le conduire tout naturellement aux mesures qu’il a prises dans l’affaire de la Compagnie du gaz de Bordeaux. Remarquons tout de suite que le Conseil d’Etat a tout simplement appliqué ici le principe général sur lequel reposent les moratoria, à savoir, d’une part, que les transactions ordinaires de la vie sont faites pour l’état de paix, que l’état de guerre n’a pas pu entrer dans les prévisions des parties, d’autre part, qu’il faut cependant que la vie sociale continue, même pendant la guerre, d’où la conséquence que des mesures spéciales, et, s’il le faut, extra-contractuelles, sont nécessaires, qu’elles doivent être imposées aux parties pendant la durée de la guerre. Dans les matières civiles, il a fallu instituer les moratoria par des mesures réglementaires ou législatives, à cause du peu de hardiesse sociale de la jurisprudence civile ; dans les matières administratives, l’intervention du législateur n’était pas utile ; la pente naturelle de la jurisprudence du Conseil d’Etat le portait à prendre les initiatives nécessaires.
Déjà, en effet, cette jurisprudence avait dégagé, dans le contrat d’entreprise ou de concession de service public, deux idées fondamentales : d’une part, la subordination de l’élément du contrat à l’élément d’entreprise de service public, et surtout à la nécessité d’assurer le service ; d’autre part, l’idée de la limitation des risques et de la responsabilité de l’entrepreneur par la notion de ce qui est ou de ce qui n’est pas dans les prévisions normales, autrement dit, la théorie de l’imprévision.
I. La subordination de l’élément contractuel à l’élément de service public provient de cette observation très simple que l’entreprise ou la concession de service public ne sont que des procédés d’institution et d’exécution de services publics, qui, à la rigueur, auraient pu être institués et exécutés par le procédé de la régie. Qu’un service d’éclairage soit organisé par le système de la concession au lieu de l’être en régie, cela n’empêche pas que ce soit un service public, et qu’une fois institué, il ne doive être assuré dans sa logique de service public, tel que l’intérêt public l’exige, même si l’on doit faire plier des clauses du contrat. Cette conception, qui se traduit par cette maxime : rigidité du service public et flexibilité du contrat, n’est pas extrêmement ancienne ; elle a succédé à une autre conception, qui était celle de la rigidité du contrat ou de la rigidité du cahier des charges.
Le changement de point de vue est lié à ce que, primitivement, on n’avait pas vu que la concession de travaux publics, par laquelle se réalisaient les entreprises administratives qui nous occupent, et que l’on prenait comme un mode d’exécution de l’opération de travaux publics, était en réalité un mode d’institution d’un service public. A mesure que cette vérité s’est fait jour, grâce à la durée de la période d’exploitation, qui, dans chaque concession, a succédé à la période de construction et d’installation, l’élément du contrat initial a perdu graduellement de son importance ; il est devenu l’accessoire du service public, révélé par la période d’exploitation. L’objet du contrat initial n’est plus que d’établir un équilibre raisonnable entre les droits et obligations du concessionnaire et les nécessités du service public ; cette économie contractuelle, d’ordre essentiellement pécuniaire, constitue une sorte de mécanisme compensateur, destiné à régulariser les relations entre l’entrepreneur et l’entreprise, mécanisme qui suppose avant tout la primauté de l’entreprise du service public (V. CE, 11 mars 1910, Min. des travaux publics, S. et P. 1911.3.1 ; Pand. pér., 1911.3.1, avec les conclusions de M. Blum et la note de M. Hauriou).
Cette primauté du service public explique que l’inexécution des conditions, imputable au concessionnaire, n’entraîne pas toujours la résolution du contrat. Le juge ne consultera pas l’intérêt passager des contractants, mais l’intérêt permanent du service, qui est que l’exploitation continue par les soins du concessionnaire. De là, en matière de concessions de travaux publics, et même en matière de marchés à l’entreprise, une jurisprudence de plus en plus restrictive, en ce qui concerne les droits des administrations publiques d’infliger par décision exécutoire des sanctions, telles que la mise en régie ou la déchéance, qui ont l’inconvénient d’interrompre le mode de gestion de l’entreprise ou du service ; de là le pouvoir que s’est arrogé le juge administratif de substituer à ces sanctions, que l’on pourrait qualifier d’interruptives, d’autres sanctions, qui ne sont pas interruptives, telles que des dommages-intérêts, alors même que le cahier des charges n’aurait pas prévu les dommages-intérêts, faisant ainsi échec à l’ancien principe de la rigidité du cahier des charges (V. CE, 31 mai 1907, Deplanque, S. et P. 1907.3.113, et la note de M. Hauriou ; adde., les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Romieu dans cette affaire, Rec. des arrêts du CE, p. 514).
C’est porté par toute cette jurisprudence que, dans notre affaire Compagnie du gaz de Bordeaux, le Conseil d’Etat a pu écarter la solution de la résiliation du contrat, qu’il a pu déclarer que la Compagnie resterait tenue d’assurer le service concédé, comme la ville serait tenue de supporter la Compagnie, parce que l’intérêt général exige la continuation du service par la Compagnie à l’aide de tous ses moyens de production. En effet, ce n’aurait pas été le moment, en pleine guerre, d’improviser une régie municipale du gaz, alors que, même en période de paix, ces régies industrielles sont pleines d’inconvénients. Et c’est toujours en vertu du même mouvement de jurisprudence que le conseil envisage la possibilité de régler la question par une indemnité ; mais, ici, pour expliquer l’idée d’une indemnité au profit de la Compagnie du gaz, il faut se référer à un autre développement de sa jurisprudence.
II. C’est ce qu’on a appelé, dans les débats de notre affaire, la théorie de l’imprévision, théorie destinée à limiter les risques et la responsabilité des contractants plus qu’elles ne sont limitées dans le droit civil, théorie qui se rattache à une notion administrative de la force majeure plus souple que n’est la notion civiliste, théorie, enfin, qui fait appel à la distinction de ce qui est normal et de ce qui est anormal, plus largement qu’on n’y fait appel dans la jurisprudence civile. On voit qu’il s’agit là d’un mouvement de jurisprudence d’une grande ampleur ; mais il se relie au précédent, en ce sens que c’est à mesure que l’ombre du service concédé s’est projetée sur le contrat de concession qu’en même temps, s’est imposée, pour l’interprétation de ce contrat, une norme de la vie administrative qui n’est pas celle de la vie civile.
La théorie civiliste du contrat est que toutes les éventualités possibles sont censées avoir été prévues par le contractant qui s’engage à une prestation ; la théorie administrative, au contraire, est que les contractants ne sont censés avoir prévu que les éventualités habituelles, d’après le droit commun de la vie, lequel s’établit avant tout dans l’état de paix, et qu’ainsi, il y a une marge pour l’imprévision ; c’est la définition que l’on peut donner de la théorie de l’imprévision ; les événements qui ne sont pas censés avoir été prévus par les parties, parce qu’ils ne sont pas habituels dans le droit commun de la vie, jouent le rôle de cas de force majeure, et alors, bien entendu, la notion de la force majeure est plus étendue en droit administratif qu’en droit civil. La Cour de cassation, interprétant l’art. 1148, C. civ., ne voit de force majeure que dans les événements qui rendent l’exécution de l’obligation impossible (V. Cass. 22 avril 1909, S. et P. 1909.1.368 ; Pand. pér., 1909.1.368, et la note ; 4 août 1915, S. 1916.1.17, et la note de M. Wahl) ; le Conseil d’Etat voit la force majeure dans les événements imprévus qui rendent l’obligation plus lourde qu’on ne pouvait le prévoir. Ainsi, la théorie de l’imprévision s’accompagne d’une conception élargie du cas de force majeure (V. à cet égard, les arrêts cités dans les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Chardenet, reproduites au cours de l’article).
Cette théorie a pris naissance dans les marchés de travaux publics et dans ceux qui, par leur nature même, auraient semblé devoir être les plus rigoureux pour l’entrepreneur. Il s’agissait généralement de travaux de terrassement ; des sondages avaient été faits, révélant la nature des roches dans lesquelles devaient être creusés des tranchées ou des souterrains ; l’entrepreneur avait pris connaissance des résultats des sondages ; le cahier des charges l’avertissait qu’il devait procéder à la pioche, au pic, à la pince, à la mine ; il avait accepté ces risques ; le prix du mètre cube avait été fixé en conséquence. Et cependant, à l’exécution, il se rencontrait des difficultés qu’il n’avait pas prévues, et le Conseil d’Etat admettait que les difficultés dépassaient ce qu’on pouvait prévoir. Des marchés de travaux publics, cette interprétation libérale s’étendait aux marchés de fournitures, et des difficultés résultant de ces marchés à celles résultant des grèves, lesquelles étaient considérées comme des événements de force majeure, à moins qu’il ne fût démontré qu’elles étaient le résultat d’une faute de l’entrepreneur (V. CE, 28 mai 1886, Perrichon, S. 1888.3.17 ; P. chr. ; et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Gauwain ; 3 févr. 1905, Ville de Paris, Rec. des arrêts du CE, p. 105, arrêt partiellement rapporté, S. et P. 1907.3.57 ; 5 mars 1909, Départ., de la Seine, S. et P. 1911.3.86 ; Pand. pér., 1911.3.86 ; 3 juill. 1912, Soc. métallurgique de l’Ariège, Rec. des arrêts du CE, p. 771 ; 1er août 1914, Comp. des messageries maritimes, Rec. des arrêts du CE, p. 997).
Il y a, pour expliquer cette jurisprudence, que l’on pourrait qualifier de latitudinaire, bien des raisons, et elles se ramènent toutes à celle-ci que la vie administrative n’est pas montée au même diapason que la vie civile, en ce qui concerne la responsabilité des risques. Il n’est même pas sûr que la vie civile d’aujourd’hui ait le même sentiment intransigeant de la responsabilité que la vie civile d’autrefois. Pour ce qui est de la vie administrative, faisons les remarques suivantes :
1° Les
administrations publiques ne conduisent pas leurs propres services publics avec
une diligentia maxima, ni avec une
prévoyance absolue ; elles auraient mauvaise grâce à être plus exigeantes
pour les entrepreneurs et concessionnaires qu’elles ne le sont pour
elles-mêmes. On pourrait objecter, il est vrai, que, si le système de la concession
est préféré à celui de la régie pour la gestion de certains services publics, c’est
justement pour que soit ainsi substituée la prévoyance des entreprises
particulières à l’imprévoyance des administrations. Cette objection a de la
portée ; mais elle n’empêche pas que l’ambiance administrative produise,
dans une certaine mesure, cet effet ; on arrive à des constatations
philosophiques comme celle faite par l’arrêt Deville-lès-Rouen du 10 janvier 1902 (S. et P. 1902. 3.17, et
la note de M. Hauriou) :
« Considérant que les deux parties sont
en faute de n’avoir pas expressément manifesté leur volonté, ce qui met le juge
dans l’obligation d’interpréter leur silence, etc. ». Imprévision réciproque, faute réciproque, c’est chose courante
admise par le juge administratif, qui en profite pour étendre son propre pouvoir.
2° Il ne faut pas considérer les entrepreneurs, concessionnaires et fournisseurs, avec lesquels l’Administration passe des marchés, comme lui étant complètement étrangers. Ce personnel constitue comme une sorte de clientèle, que l’Administration a intérêt à ménager, parce qu’il est habituellement à son service. En outre, spécialement dans les concessions de services publics faites pour une longue durée, il s’établit comme une sorte d’association entre le concessionnaire et l’Administration. Dans tous les cas, il est désirable que cette association s’établisse. Le type de concession vers lequel on s’achemine est celui de la régie intéressée, qui est une sorte de métayage, où les bénéfices sont partagés, aussi les risques. A ce point de vue, il est intéressant de remarquer que la Compagnie du gaz de Bordeaux, dont le traité date seulement de 1904, n’est pas propriétaire de l’usine, et que ce n’est pas elle qui a établi la canalisation ; elle n’est que fermière de ces diverses installations, pour lesquelles elle paye à la ville un loyer annuel ; en outre, il doit être attribué aux ouvriers et employés commissionnés 10 p. 100 des bénéfices nets de l’entreprise, c’est-à-dire que la Compagnie est déjà à moitié dans la situation d’un régisseur intéressé, à moitié associé, avec la ville.
D’ailleurs, dans cette théorie administrative du contrat d’entreprise, tout s’enchaîne ; le contrat est dominé par l’entreprise des services administratifs et la limitation des risques provient des mœurs administratives, lesquelles sont façonnées par les exigences du fonctionnement des services. Au demeurant, il y a un gros organisme objectif qui fonctionne, et devant lequel se minimise l’effet des volontés subjectives, comme s’atténuent les responsabilités subjectives ; la loi du contrat fléchit sous le même poids que le risque contractuel ; tout le contrat administratif est comme écrasé par l’importance de son objet ; le contrat a essayé d’embrasser dans ses clauses une institution vivante ; mais la tâche est au-dessus de ses forces, et l’institution déborde de tous les côtés.
§ 2
Venons maintenant à la procédure imaginée par le Conseil d’Etat pour régler le litige. Le Conseil d’Etat était saisi en appel, l’affaire ayant été jugée en premier ressort par le conseil de préfecture de la Gironde. C’était la Compagnie du gaz qui était demanderesse. Elle avait demandé à la ville de Bordeaux de lui venir en aide ; la ville avait rejeté sa demande. La Compagnie avait alors saisi le conseil de préfecture ; celui-ci avait rejeté sa demande contentieuse. Elle était venue en appel au Conseil d’Etat ; ses conclusions contenaient deux chefs ; elle demandait, d’abord, que la ville fût condamnée à lui venir en aide pour assurer le service pendant la durée de la guerre ; ensuite, elle réclamait une indemnité ferme, représentant le préjudice qu’elle avait déjà subi du fait de la hausse du charbon, depuis le début de la guerre jusqu’au jour du procès.
Or, le Conseil d’Etat, dans son arrêt, ne statue que sur le premier chef des conclusions ; il condamne en principe la ville à venir en aide à la Compagnie ; il établit en principe le droit de la Compagnie à une indemnité, et même il en pose les bases ; mais il ne condamne pas lui-même la ville à payer une somme déterminée. Il renvoie les parties à se pourvoir devant le conseil de préfecture de la Gironde pour la fixation de l’indemnité, si mieux elles n’aiment, d’ici là, s’entendre à l’amiable sur les conditions où la ville pourra venir en aide à la Compagnie.
Ainsi, voilà un juge d’appel qui ne vide pas entièrement le procès par sa décision ; il le coupe en deux ; il sépare ce qu’on pourrait appeler la tête et la queue, il statue sur la tête, et, pour ce qui est de la queue du procès, il la renvoie devant le juge de première instance, dans de telles conditions que, si elle y revient véritablement, elle donnera lieu à un second déroulement de procédure en premier ressort et en appel.
C’est contre
ce procédé que M. Duguit s’emporte
et s’indigne dans l’article précité.
« L’arrêt du Conseil d’Etat, dit-il, est en contradiction violente avec
certaines règles indiscutées et indiscutables, qui sont la sauvegarde
indispensable du justiciable ».
Nous concevons que les façons de faire du Conseil d’Etat puissent causer quelque surprise à qui n’a pas une pratique assidue de sa jurisprudence ; mais, avant d’entrer dans des explications détaillées, il convient de faire observer que, dans l’espèce, bien loin de nuire aux intérêts des justiciables, la procédure suivie ne pouvait que leur être favorable, en même temps qu’elle respectait soigneusement leur autonomie. Comment ! Voilà une affaire où s’agitait une grosse question de principe, laquelle, en réalité, avait seule été plaidée : derrière celle question de principe, il y avait le calcul d’une grosse indemnité, sur laquelle les débats n’avaient pas porté ; il y avait aussi la question d’une alternative ouverte devant la ville : ou bien payer une indemnité, ou bien consentir à un relèvement du prix du gaz à la charge des abonnés ; et l’on soutiendrait que l’intérêt des justiciables était de faire trancher les questions par le juge tout de suite, bien qu’elles eussent été mal étudiées, et bien que les parties n’eussent pas eu le loisir de les envisager, puisqu’elles ne savaient pas jusque-là si le principe de l’obligation de la ville serait posé ! Le bon sens le plus élémentaire indique, au contraire, que, pour les justiciables, il vaut mieux que les questions soient sériées, qu’elles soient plaidées successivement, que des alternatives leur soient ouvertes. Sans doute, si des règles formelles de procédure s’opposent à l’emploi de cette méthode, il faudra bien s’incliner ; mais si elles ne s’y opposent pas, et c’est ce que nous allons examiner, la méthode mérite d’être employée, parce qu’elle est bonne et avantageuse.
M. Duguit affirme que deux règles essentielles ont été violées, celle de l’effet dévolutif de l’appel et celle de l’indépendance réciproque des deux juridictions.
La question est de savoir si ces deux règles, à supposer, qu’elles soient essentielles dans la procédure civile, le sont au même degré dans la procédure administrative. On peut légitimement en douter, étant donné le principe que les textes du Code de procédure civile ne sont pas directement applicables à la procédure administrative (V. Hauriou, Précis de droit administratif, 11e éd., p. 992 et s.).
La seule idée vraiment essentielle que contienne l’institution de l’appel, et qui doive forcément passer dans toutes procédures, est celle du double degré de juridiction ; il faut que toute question soulevée par le procès soit soumise successivement à deux juges ; voilà la proposition irréductible ; tout le reste est de la réglementation accessoire ; que le juge d’appel puisse ou ne puisse pas couper en deux le procès, et en renvoyer à nouveau une partie devant le juge du premier ressort, cela n’a pas d’importance au point de vue de l’institution de l’appel, pourvu que les deux morceaux du procès passent successivement en première instance et en appel. Quant à la procédure de renvoi devant le juge de premier ressort, « et en même temps de renvoi devant l’Administration, pour ouvrir à celle-ci une alternative, elle n’a point été inventée de toutes pièces par le Conseil d’Etat, et elle se réclame de précédents fort intéressants à en rapprocher.
Il est à remarquer que notre arrêt pose le principe d’une indemnité due par la ville à la Compagnie du gaz, et qu’il renvoie devant le conseil de préfecture pour la fixation de cette indemnité, si les parties n’aiment mieux s’entendre ; or, cette procédure est connue du Code de procédure civile, sous le nom de procédure en liquidation par suite d’instance (C. proc., 128, 523 et s.) ; elle est prévue, d’abord, pour être appliquée par un même tribunal, qui, par un premier jugement, pose le principe de l’indemnité, et qui, par un second jugement, en prononce la liquidation. Mais l’art. 472, C. proc., étend cette procédure au cas d’un juge d’appel, qui, après avoir posé le principe de l’indemnité, charge un tribunal de première instance d’en prononcer la liquidation, ce qui est notre hypothèse. Sans doute, le Code de procédure civile entoure cette liquidation par suite d’instance de certaines restrictions, et, notamment, il ne permet pas le renvoi, après infirmation, devant le même juge du premier ressort qui avait déjà connu de l’affaire ; mais pourquoi le Conseil d’Etat ne se serait-il pas emparé du principe sans s’embarrasser des restrictions, puisqu’il n’est pas lié par les textes, et qu’il ne prend des institutions de la procédure civile que la substantifique moelle ?
Avec cette procédure en liquidation par suite d’instance vient se combiner la procédure de liaison du contentieux par la décision préalable, à laquelle le Conseil d’Etat s’attache énergiquement, parce qu’elle est très respectueuse de l’autonomie des administrations publiques. Il l’applique, non seulement au début des instances, mais même aux tournants des procès, lorsqu’il se découvre quelque nouvel aspect de la question sur lequel il estime que l’Administration n’a pas réellement pris parti. Une administration publique ne pense pas à tout à la fois, comme un particulier ; au contraire, elle ne pense qu’à une chose chaque fois ; elle marche à pas comptés par décisions successives ; le juge administratif se plie à cette méthode successive de décisions par une méthode successive de jugement des instances ; c’est alors qu’il estime que l’affaire n’est pas en état, et qu’il la coupe en deux. Le Conseil d’Etat a inauguré depuis longtemps cette pratique dans les affaires où il est juge de premier ressort ; dans le contentieux des pensions de retraite des fonctionnaires, lorsqu’une décision refusant la pension a été annulée par lui, au lieu de liquider la pension lui-même, il renvoie toujours l’intéressé devant le ministre pour la liquidation, sauf à revenir devant lui ; dans le contentieux des indemnités pour faute de service, lorsque l’Administration avait refusé toute indemnité, et qu’il reconnaît que c’est à tort, il applique la même procédure, non pas toujours, mais souvent.
Sans doute, dans notre affaire, le Conseil d’Etat était juge d’appel, et, en coupant l’instance en deux, il renvoyait les parties à revenir en premier ressort devant le conseil de préfecture ; mais il y était autorisé par l’institution des procédures en liquidation par suite d’instance ; et, d’ailleurs, il y avait un intérêt majeur à cause de l’alternative qu’il s’agissait d’ouvrir aux parties.
Il ne faut pas oublier cet élément du dispositif de notre arrêt, qui est essentiel : le Conseil d’Etat condamne bien en principe la ville de Bordeaux à payer une indemnité à la Compagnie du gaz ; mais il lui suggère un moyen d’éviter d’avoir à payer cette indemnité, en consentant à une nouvelle convention par laquelle le prix du gaz serait augmenté. Pratiquement, cette solution est de beaucoup la plus avantageuse et la plus désirable ; mais le Conseil d’Etat a estimé que ce prix ne peut être relevé que comme il a été établi, c’est-à-dire par une convention passée entre la ville et la Compagnie, avec stipulation pour autrui pour le compte des abonnés, et avec adhésion de ceux-ci (Cf. jugement du tribunal civil de la Seine du 10 mai 1916, avec les très intéressantes conclusions de M. le substitut Regnault, Gaz. des trib. du 29 mai) ; le Conseil d’Etat ne pouvait pas imposer ce contrat ; il est de principe que le juge administratif n’impose jamais à une administration publique une obligation de faire ; il ne pouvait que lui ouvrir une alternative entre le paiement d’une indemnité et la passation du contrat ; mais, pour ce faire, il fallait interrompre l’instance, et c’est ce que, profitant de toutes les ressources de procédure que nous avons signalées, il a résolu.
Est-ce que, par-là, il aurait attenté à l’indépendance du conseil de préfecture comme juge de premier ressort ? C’est un bien gros mot pour qualifier une simple question d’autorité de la chose jugée. Sans doute, le Conseil d’Etat affirme qu’en principe, l’indemnité est due, si la ville ne consent pas à un arrangement ; le conseil de préfecture est-il obligé de s’incliner ? Question discutée, et qui est relative à l’autorité de la chose jugée. Elle s’est posée dans les relations de la Cour d’appel et du tribunal de première instance, dans l’hypothèse de l’art. 472, C. proc. ; la Cour de cassation a estimé que le tribunal civil n’était pas lié, au moins en ce qui concerne l’existence du préjudice ; elle aurait pu juger le contraire, sans que l’indépendance du tribunal fût compromise ; l’autorité de la chose jugée est fondée sur d’autres motifs que sur le désir de respecter l’indépendance du juge (V. Cass., 28 nov. 1888, S. 1889.1.369 ; P. 1889. 908, et la note de M. Meynial ; Pand. pér., 1889.1.150. V. aussi, Tissier, Rev. crit., 1888, p. 539). En tout cas, ici, que le conseil de préfecture juge comme il voudra, cela n’a pas d’inconvénient ; l’affaire reviendra toujours devant le Conseil d’Etat, qui aura le dernier mot.
Enfin, tout
cela est si peu révolutionnaire que ce n’est même pas une nouveauté. Il y a
vingt ans déjà, dans une affaire Deshayes, du 6 avril 1895 (Rec. des arrêts du CE,
p. 345, arrêt rapporté pour partie S.
et P. 1897.3.80), le Conseil d’Etat a
appliqué exactement la même procédure. Il s’agissait d’un régisseur intéressé du
service des eaux, dont la déchéance avait été prononcée à tort par le maire de
la ville de Lorient ; on était allé au conseil de préfecture, puis au
Conseil d’Etat. Celui-ci déclare que l’arrêté de déchéance ne sera pas annulé,
mais que la ville doit une indemnité, que l’état de l’instruction ne permet pas
de statuer immédiatement, « que, dès
lors, il y a lieu de renvoyer les parties devant le conseil de préfecture pour
fixer le chiffre de l’indemnité à laquelle a droit le requérant, soit que cette
indemnité ne doive s’appliquer qu’à l’intervalle de temps écoulé depuis la
déchéance prononcée jusqu’au jour où
la ville donnerait son consentement à ce que le traité continuât à recevoir son
exécution, soit que, dans le cas contraire, cette indemnité doive comporter l’entière
réparation du préjudice ».
Tout y est, même l’alternative d’arrangement amiable ouverte à la ville. Nous ajoutons que Laferrière a mentionné cet arrêt dans la 2e édition de son Traité de la juridiction administrative, t. II, p. 131, note 1, et qu’il n’a émis aucune critique.
§ 3
Il est à remarquer que le litige engagé entre la Compagnie du gaz de Bordeaux et la ville de Bordeaux devant le Conseil d’Etat laisse complètement de côté la question des relations entre la Compagnie et les abonnés ; le commissaire du gouvernement, dès le début de ses conclusions, écarte soigneusement ce point de vue, sur lequel l’arrêt est muet. M. le commissaire du gouvernement s’appuie pour justifier cette attitude sur des raisons de compétence, les contrats d’abonnement entre la Compagnie et les particuliers relevant des tribunaux judiciaires ; mais il y a une raison plus fondamentale, à savoir qu’il ne saurait y avoir de procès entre la Compagnie et les abonnés au sujet du relèvement du prix maximum du gaz. Le prix maximum du gaz n’est pas fixé par une clause du contrat passé avec les abonnés ; il est fixé dans le cahier des charges du traité passé avec la ville, par ce que l’on appelle le tarif maximum. Le tarif maximum n’est pas une affaire entre la Compagnie et les abonnés ; il est une affaire entre la Compagnie et la ville. La ville a stipulé pour les abonnés lors du traité ; c’est elle qui doit stipuler encore, lors des modifications au traité ; les abonnés sont ici nécessairement représentés par la ville, parce que le tarif maximum pour les abonnements est nécessairement lié à l’ensemble financier, de l’opération faite par la ville. Et les abonnés sont immédiatement obligés par le relèvement de prix consenti par la ville (Trib. de la Seine, 10 mai 1916, précité).
A ce point de vue, il faut reconnaître que notre affaire avait été correctement engagée par la Compagnie du gaz de Bordeaux. Celle-ci doit être louée de s’être adressée à la ville, au lieu d’avoir essayé d’imposer aux abonnés un relèvement du prix du gaz, de sa propre autorité ; il faut songer que, tant qu’a duré le procès, pendant une année presque entière, elle a supporté à elle seule l’avance de la perte considérable résultant de la hausse du charbon.
Toutes les Compagnies n’ont pas eu la même abnégation, ni la même correction juridique. Il en est qui, procédant par décision exécutoire, comme si elles eussent été des administrations publiques, ont signifié aux abonnés, par la voie de la presse, qu’à partir de telle date, elles relèveraient le prix du gaz, et qu’aux abonnés qui ne consentiraient pas à payer le nouveau prix, elles appliqueraient la sanction de la fermeture du compteur. Un abonné s’est rencontré, qui a résisté ; son compteur a été fermé ; il est allé en référé devant le président du tribunal civil, demandant la réouverture du compteur, motifs pris de ce que, dans une question litigieuse de cette nature, la compagnie n’avait pas le droit de s’adjuger à elle-même le bénéfice du provisoire pendant la durée du procès au fond ; la Compagnie jouait le rôle de demandeur au point de vue du relèvement du prix ; elle devait, jusqu’à l’issue de ce procès au fond, conserver ce rôle, et ne faire payer que l’ancien prix ; d’ailleurs, elle n’avait pas le droit de procéder par décision exécutoire et de se faire justice elle-même, car elle n’était pas une administration publique. Cette argumentation était la raison même ; aussi le président du tribunal civil donna-t-il gain de cause à l’abonné. Mais la Compagnie du gaz fit appel, et l’ordonnance de référé fut annulée par la Cour pour incompétence, motifs pris de ce qu’il y avait connexion avec un litige administratif engagé au fond entre la compagnie et la ville devant le conseil de préfecture (V. Toulouse, 17 avril 1916, S. 1916. 2,36).
Cette règle
de l’incompétence, par connexité entre le provisoire et le fond, peut avoir du
bon, mais, dans le cas présent, son application aboutissait à un véritable déni
de justice. Si le président du tribunal civil n’était pas compétent pour
ordonner par référé la réouverture du compteur, alors aucun juge n’était compétent.
Sans doute, aux termes de l’art. 24 de la loi du 22 juillet 1889, le président
du conseil de préfecture peut, en cas d’urgence, désigner un expert pour la
constatation des faits qui seraient de nature à motiver une réclamation devant
ce conseil ; mais tout le monde s’accorde pour reconnaître que ce référé
est exceptionnel, et qu’il ne s’applique qu’à l’exécution du marché de travaux
publics, dans les relations de l’entrepreneur et de l’Administration
(V. Laferrière,
op. cit., t. I, p. 374 ; Teissier et Chapsal, Traité de la
proc. devant les cons. de préfect., p, 165).
D’ailleurs, le référé administratif se fût-il appliqué à notre hypothèse, le président du conseil de préfecture n’aurait jamais eu que le pouvoir de faire constater le fait de la fermeture du compteur et non pas celui d’en prescrire la réouverture, car il n’a pas le pouvoir d’injonction (V. Laferrière, op. et loc. cit.), c’est-à-dire qu’il n’aurait pas eu le pouvoir de solutionner la véritable question, qui était de rétablir provisoirement l’abonné en possession du gaz.
C’est pourtant un principe supérieur que toute question litigieuse doit trouver un juge, et nous croyons que le principe a plus d’importance que celui de la connexité d’affaires relevant de compétences diverses. La Cour nous paraît avoir mal jugé ; le résultat a été que les abonnés ont été contraints de payer par avance une augmentation de prix du gaz arbitrairement fixée par la seule compagnie, ce qui est consentir à une Compagnie privée un privilège inacceptable.
II. Extraits de la décision commentée
(…) Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Bordeaux :
Considérant que les conclusions de la Compagnie requérante tendaient, devant le conseil de préfecture, comme elles tendent devant le Conseil d’Etat, à faire condamner la ville de Bordeaux à supporter l’aggravation des charges résultant de la hausse du prix du charbon ; que, dès lors, s’agissant d’une difficulté relative à l’exécution du contrat, c’est à bon droit que, par application de la loi du 28 pluviôse an VIII, la Compagnie requérante a porté ses conclusions en première instance devant le conseil de préfecture, et en appel devant le Conseil d’Etat ;
Au fond :
Considérant qu’en principe, le contrat de concession règle, d’une façon définitive, jusqu’à son expiration, les obligations respectives du concessionnaire et du concédant ; que le concessionnaire est tenu d’exécuter le service prévu dans les conditions précisées au traité, et se trouve rémunéré par la perception, sur les usagers, des taxes qui y sont stipulées ; que la variation des prix des matières premières, à raison des circonstances économiques, constitue un aléa du marché, qui peut, suivant le cas, être favorable ou défavorable au concessionnaire, et démettre à ses risques et périls, chaque partie étant réputée avoir tenu compte de cet aléa dans les calculs et prévisions qu’elle a faits avant de s’engager ;
Mais considérant que, par suite de l’occupation par l’ennemi de la plus grande partie des régions productrices de charbon dans l’Europe continentale, de la difficulté de plus en plus considérable des transports par mer, à raison tant de la réquisition des navires que du caractère et de la durée de la guerre maritime, la hausse survenue au cours de la guerre actuelle dans le prix du charbon, qui est la matière première de la fabrication du gaz, s’est trouvée atteindre une proportion telle que, non seulement elle a un caractère exceptionnel, dans le sens habituellement donné à ce terme, mais qu’elle entraine dans le coût de la fabrication du gaz une augmentation, qui, dans une mesure déjouant tous les calculs, dépasse certainement les limites extrêmes des majorations ayant pu être envisagées par les parties lors de la passation du contrat de concession ; que, par suite du concours des circonstances ci-dessus indiquées, l’économie du contrat se trouve absolument bouleversée ; que la compagnie est donc fondée à soutenir qu’elle ne peut être tenue d’assurer, aux seules conditions prévues à l’origine, le fonctionnement du service, tant que durera la situation anormale ci-dessus rappelée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, si c’est à tort que la Compagnie prétend ne pouvoir être tenue de supporter aucune augmentation du prix du charbon au-delà de 28 francs la tonne, ce chiffre ayant, d’après elle, été envisagé comme correspondant au prix maximum du gaz prévu au marché, il serait tout à fait excessif d’admettre qu’il y a lieu à l’application pure et simple du cahier des charges, comme si l’on se trouvait en présence d’un aléa ordinaire de l’entreprise ; qu’il importe, au contraire, de rechercher, pour mettre fin à des difficultés temporaires, une solution qui tienne compte tout à la fois de l’intérêt général, lequel exige la continuation du service par la Compagnie à l’aide de tous les moyens de production, et des conditions spéciales qui ne permettent pas au contrat de recevoir son application normale ; qu’à cet effet, il convient de décider, d’une part, que la Compagnie est tenue d’assurer le service concédé, et, d’autre part, qu’elle doit supporter, seulement au cours de cette période transitoire, la part des conséquences onéreuses de la situation de force majeure ci-dessus rappelée que l’interprétation raisonnable du contrat permet de laisser à sa charge ; qu’il y a lieu, en conséquence, en annulant l’arrêté attaqué, de renvoyer les parties devant le conseil de préfecture, auquel il appartiendra, si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions spéciales dans lesquelles la Compagnie pourra continuer le service, de déterminer, en tenant compte de tous les faits de la cause, le montant de l’indemnité à laquelle la Compagnie a droit, à raison des circonstances extra-contractuelles dans lesquelles elle aura dû assurer le service pendant la période envisagée ; (…) – Décide :
Art. 1er. L’arrêté du conseil de, préfecture de la Gironde, en date du 30 juillet 1915, est annulé.
Art. 2. La Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux et la ville de Bordeaux sont renvoyées devant le conseil de préfecture, pour être procédé, si elles ne s’entendent pas aimablement sur les conditions spéciales auxquelles la Compagnie continuera son service, à la fixation de l’indemnité à laquelle la Compagnie a droit, à raison des circonstances extra-contractuelles dans lesquelles elle aura dû assurer le service concédé.
III. Présentation de la note[1]
En mai 2005, un tribunal arbitral international rendait une sentence dans une affaire complexe opposant une importante société américaine à l’Etat argentin. Il s’agissait d’un contentieux comme il en existe tant d’autres aujourd’hui, considérables par l’ampleur des enjeux politiques et financiers qu’ils recouvrent. Le différend était né autour d’un contrat de concession passé entre l’Etat et l’entreprise étrangère, pour la gestion et l’exploitation d’un réseau national de distribution de gaz. La sentence elle-même emprunte des chemins parfaitement classiques et balisés, jusqu’à son paragraphe 224 où est mentionné, avant d’être largement détaillé et de servir même de fondement à la décision des arbitres, l’arrêt du 30 mars 1916 rendu par le Conseil d’Etat français en l’affaire dite du « gaz de Bordeaux » (CMS Gas Transmission Company vs The Argentine Republic, ARB/01/8, sentence du 12 mai 2005, ICSID Reports vol. 14, p. 158). Fallait-il pour cela que la décision en question fût d’une importance remarquable et soulevât un enjeu qui dépasse largement les frontières françaises. C’est bien parce qu’en somme la question abordée – et la réponse proposée par le juge français – était universelle qu’un tel rayonnement peut s’expliquer[2].
L’on comprend en pareille perspective les termes employés par Hauriou au sujet de cet arrêt : tout en se gardant bien d’évoquer l’équité et rappelant le célèbre adage révolutionnaire à l’endroit des Parlements – lequel n’invoquait d’ailleurs rien moins que Dieu à cette occasion – l’illustre commentateur estime qu’« il serait plus exact et plus prudent de (…) louer [le Conseil d’Etat] d’être une juridiction sociale, c’est-à-dire, d’orienter sa jurisprudence vers une justice élargie, toute pénétrée d’intérêt public ». Il est vrai, poursuit-il, que « jamais le caractère social ne s’était affirmé aussi nettement » que dans cette décision, remarquable à plus d’un titre.
Il faut rappeler brièvement le contexte de cette affaire, rendue au sujet du contrat de concession entre la ville de Bordeaux et une compagnie privée assurant la distribution du gaz à l’ensemble de ses habitants. La première guerre mondiale ayant entraîné un accroissement considérable du prix des matières premières, l’équilibre contractuel se trouvait fortement malmené, puisque la compagnie ne pouvait raisonnablement poursuivre son activité sauf à assumer une augmentation considérable de ses frais risquant de la mener à sa perte. Ayant réclamé un soutien financier à la ville et s’étant heurté à un refus validé par le Conseil de préfecture, la Compagnie avait donc saisi le Conseil d’Etat en appel qui, en vertu de la théorie dite « de l’imprévision », décida de la poursuite de la relation contractuelle – malgré ce qu’il faut bien convenir d’appeler un bouleversement de ses conditions de conclusion – tout en imposant à la personne publique d’assumer une partie de l’accroissement des dépenses, sous la forme d’une indemnisation versée au concessionnaire. En d’autres termes, souligne Hauriou, la Haute juridiction s’intègre résolument dans une logique de service public en ne prononçant pas la résolution du contrat puisqu’en définitive « l’intérêt général exige la continuation du service par la compagnie à l’aide de tous ses moyens de production », justifiant un soutien financier de la municipalité. Le commentateur aura alors à cœur de souligner à quel point, avec cet arrêt, c’est une révolution qui parvient à son terme : révolution marquée par la naissance d’un véritable régime autonome du contrat administratif, entièrement traversé par l’intérêt général qui implique une souplesse dans la vie de la convention, inédite dans le cadre du code civil. Comme il l’indique avec une grande clarté : « la théorie civiliste du contrat est que toutes les éventualités possibles sont censées avoir été prévues par le contractant qui s’engage à une prestation ; la théorie administrative, au contraire, est que les contractants ne sont censés avoir prévu que les éventualités habituelles, d’après le droit commun de la vie, lequel s’établit avant tout dans l’état de paix, et qu’ainsi, il y a une marge de manœuvre pour l’imprévision ».
En définitive, c’est donc tout l’esprit du droit administratif qui trouve ici sa traduction en matière contractuelle. Car c’est bien l’intérêt du plus grand nombre, en l’occurrence incarné par la nécessité d’une fourniture permanente d’énergie aux habitants d’une grande ville, qui justifie les libertés prises avec l’engagement conventionnel. Au fond, écrit admirablement le dédicataire de ces lignes, « tout le contrat administratif est comme écrasé par l’importance de son objet ; le contrat a essayé d’embrasser dans ses clauses une institution vivante ; mais la tâche est au-dessus de ses forces, et l’institution déborde de tous les côtés ». A ce combat perdu d’avance entre la convention rigide et l’intérêt général qui nécessite une adaptation constante, plusieurs issues étaient possibles, mais une seule était véritablement au service du public : celle qui consistait précisément à « subordonner l’élément contractuel à l’élément service public » en dépassant franchement la lettre de l’engagement conventionnel pour l’adapter aux évolutions exceptionnelles du contexte de la relation.
Reste qu’un élément n’est nullement évoqué par Hauriou, lequel semble soutenir sans
nuance aucune la solution retenue par le Conseil d’Etat et qui tient aux
conséquences financières de la décision pour la collectivité. Car en
définitive, le prix de l’évolution imposée à la relation contractuelle sera
bien assumé principalement par la personne publique, même si la détermination
du montant exact de l’indemnisation est renvoyée à l’appréciation du Conseil de
préfecture[3].
L’on ne peut à cet égard s’empêcher de déceler d’ores et déjà l’amorce – qu’Hauriou ne pouvait identifier – d’une
tendance « assurancielle » de la jurisprudence administrative,
laquelle atteindra son point culminant avec la multiplication des cas de
« responsabilité » sans faute. Même si, dans le contexte qui était le
sien, la solution de l’affaire gaz de
Bordeaux n’est en rien choquante et doit être largement saluée, sans doute
constitue-t-elle un premier pas sur ce chemin, en ce sens qu’il appartient
désormais à l’Etat d’assumer le poids financier des évolutions que personne ne
pouvait prévoir. Mais peut-être après tout est-ce là, au fond, ce que l’on
appelle l’intérêt général qui a le droit lui aussi, et d’ailleurs même sans
doute plus que tout autre, d’avoir un prix.
[1] Par M. le professeur Arnaud de Nanteuil, Université du Maine, membre du Themis-Um (ea 4333), Directeur adjoint de l’Ecole doctorale Pierre Couvrat (ed 88).
[2] On passera ici sur la discussion qui peut – et qui doit ! – être menée du point de vue du droit international public mais qui n’a pas lieu d’être ici. Car au-delà de la surprise, le fondement juridique exact de la prise en compte d’une telle jurisprudence par un tribunal statuant en droit international public est particulièrement nébuleux.
[3] Cet aspect là fait d’ailleurs l’objet de la seconde partie du commentaire d’Hauriou, qui reproche au Conseil d’Etat d’avoir « coupé en deux » la solution, en se prononçant favorablement pour le principe d’une indemnisation mais en renvoyant la détermination de son montant au juge du fond. Il s’agit davantage d’une question procédurale, qui ne sera pas abordée ici.
Nota Bene : le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso. Vous pouvez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).
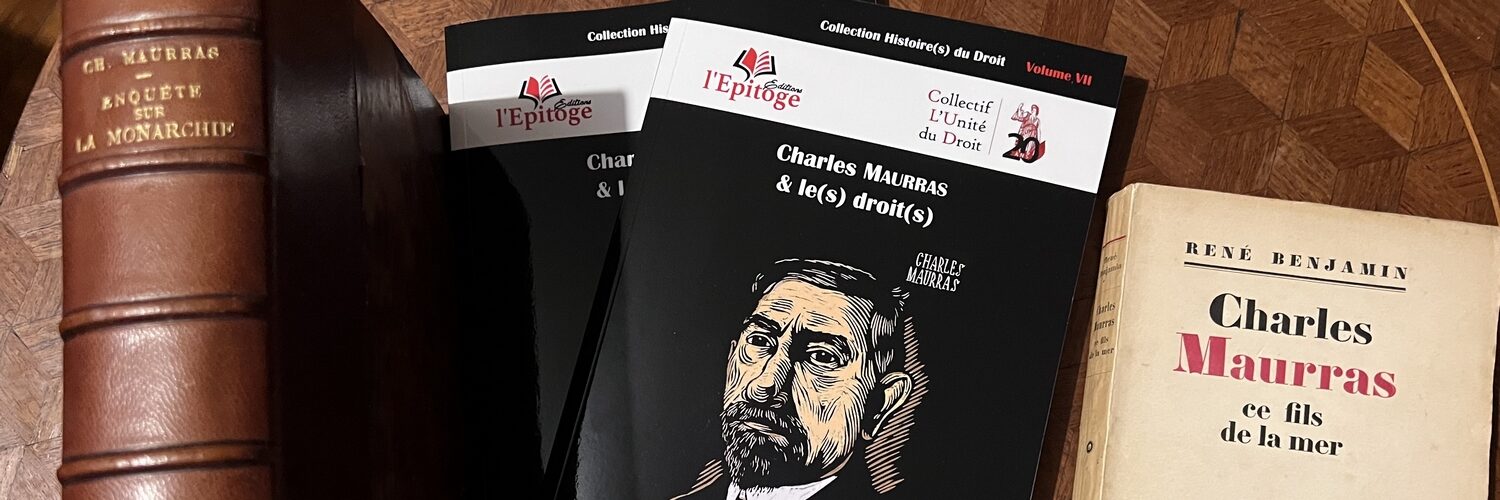
À propos de l’auteur