Voici la 31e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 3e livre de nos Editions dans la collection « Académique » : les Mélanges en l’honneur du professeur Jacques Bouveresse.
Il s’agit en l’occurrence d’un article du Dr. Xavier Braud à propos de la cris du droit de l’environnement …
Cet ouvrage est le troisième
issu de la collection « Académique ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :
Volume III :
Contributions en l’honneur du pr. Jacques Bouveresse.
Crise(s) & Droit(s)
Ouvrage collectif
(Direction Guy Quintane & Christophe Otero)
– Nombre de pages : 344
– Sortie : juillet 2015
– Prix : 69 €
- ISBN / EAN : 979-10-92684-13-1 / 9791092684131
- ISSN : 2262-8630
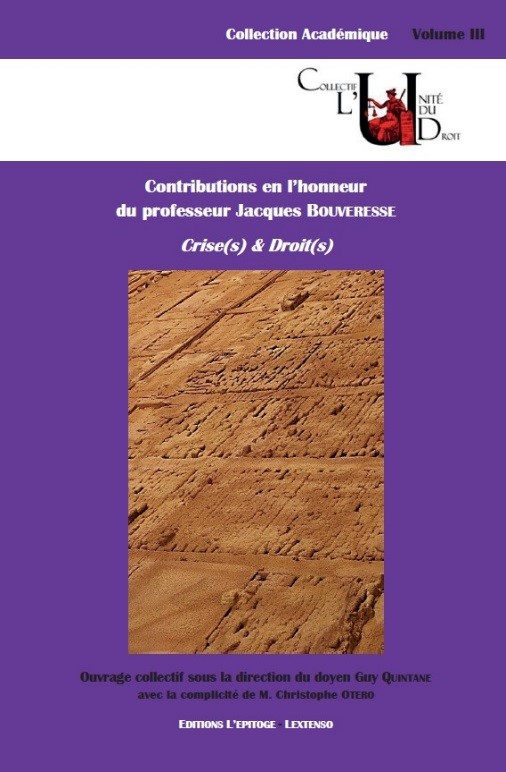
Présentation :
Les actes du présent colloque qui s’est tenu les 04 & 05 novembre 2014 à l’Université de Rouen, rassemblent, sous les thèmes fédérateurs de la crise et du droit – entendus dans leurs diverses composantes – les contributions de plusieurs universitaires en l’honneur du professeur émérite d’histoire du droit Jacques BOUVERESSE. La notion de crise, d’une grande actualité et si souvent évoquée, trouve des illustrations dans les différentes branches du droit. Néanmoins, si la crise est plurielle et que ses occurrences juridiques le sont aussi, ce n’est pas pour souligner leurs acceptions distinctes que ces contributions ont été réunies. Il ne s’agit donc pas d’identifier et de dissocier les manifestations de crise dans chacune des branches juridiques. Au contraire, en s’associant aux objectifs défendus par le COLLECTIF L’UNITE DU DROIT accueillant le présent ouvrage dans ses collections, les auteurs, qu’ils soient privatistes, publicistes ou historiens du droit montrent ici, non seulement la manière dont le droit est mobilisé pour tenter de réduire les crises qui affectent l’espace social, mais aussi les formes nouvelles qu’il prend tant il apparaît que la crise devient l’un de s traits distinctifs de ce même espace.
Les aspects traités au sein du présent volume – les leçons de l’histoire ; le droit et la crise économique et financière ; le droit, la science, le sujet ; le droit et la crise des pouvoirs ; la crise du droit – ne doivent rien au hasard. Ils font écho, d’abord, à la personnalité atypique de Jacques BOUVERESSE qui a toujours cherché à dépasser les frontières académiques, ensuite, à ses nombreux centres d’intérêt, et enfin, à sa production scientifique fournie tout au long d’une carrière d’enseignant-chercheur qui l’est tout autant. L’ouvrage est placé sous la direction scientifique du professeur Guy QUINTANE & de M. Christophe OTERO.
La crise du droit
de l’environnement
dans un contexte
de crise écologique
Xavier Braud
Maître de conférences en droit public, Université de Rouen
Pour la première fois dans l’histoire de la terre, la planète est confrontée à une crise globale, due exclusivement à l’action d’une espèce vivante, l’homo sapiens sapiens, et de nature à remettre en cause l’existence de cette même espèce, voire même de la vie dans son ensemble.
Le consensus scientifique représenté par le Giec qualifie de hautement improbable l’hypothèse consistant à limiter le réchauffement climatique à 2°C en 2100. Or les hypothèses du Giec ont presque systématiquement été démenties par leur excès d’optimisme. Nous sommes actuellement sur une trajectoire de +4 à +5°C[1], alors que le seuil de 2°C est considéré par le consensus scientifique comme à ne pas dépasser, au risque d’aboutir à une situation d’une particulière gravité et totalement incontrôlable. En effet au-delà de ce seuil (et peut-être avant), le réchauffement s’accélère, s’emballe et s’auto-entretient en dégageant des quantités phénoménales de gaz à effet de serre, notamment ceux séquestrés dans le permafrost (sols gelés). Loin de diminuer, les émissions mondiales de gaz à effet de serre n’ont jamais cru aussi vite qu’en 2013 et 2014 avec le retour en force du charbon[2]. En France, elles ne diminuent pas (+0,6% en 2013). L’année 2100 est un horizon à court terme, aucun scénario ne peut prévoir ce qui se passera au delà, un siècle ou deux plus tard. La seule certitude, c’est l’emballement du réchauffement qui peut aboutir à des situations inimaginables, accélérant encore l’écocide actuellement en cours.
L’autre volet de la crise, qui est en partie liée au premier, est l’effondrement de la biodiversité. Le langage officiel évoque une érosion de la biodiversité. Une négation de la situation quand on évalue la disparition des effectifs de vertébrés (hors homo sapiens sapiens) à 50% en l’espace de seulement 40 ans[3]. La vie animale réduite de moitié en un instant à l’échelle de l’histoire de la vie sur Terre !
Face à ces perspectives effroyables, on pourrait imaginer que le droit de l’environnement soit mis à contribution pour participer à la lutte contre la crise écologique. Or, que constate-t-on ? Une agitation des pouvoirs publics, qui culmine avec la mise en scène spectaculaire du « Grenelle environnement » et se poursuit avec les « conférences environnementales » qui trouvent notamment leur prolongement dans les Etats généraux de la modernisation du droit de l’environnement[4]. Sous le Président François Hollande, 4 ministres de l’Ecologie se sont succédés en deux ans, et la dernière s’est illustrée par son soutien systématique aux groupes d’intérêts qui s’attaquent aux modestes acquis du droit de l’environnement.
Comme on le verra, avec des illustrations qui touchent le droit de l’environnement industriel et des transports (crise climatique) et le droit de la protection de la nature (crise de la biodiversité), le droit de l’environnement se gâte. Toujours plus de gras, toujours moins de muscle.
I. Un droit qui engraisse
Un droit efficace se doit d’être constitué d’un nombre limité de normes simples, claires et précises. Tel n’a jamais été le cas du droit de l’environnement. Mais ces dernières années, la tendance au bavardage et à la complexification inutile du droit de l’environnement, s’est fortement accentuée.
A. Un droit toujours plus bavard
Loin de nous l’idée de prétendre que le droit de l’environnement ait connu un âge d’or. Mais tout de même, force est d’observer l’existence d’un fossé en vingt ans de législation environnementale.
La loi du 3 janvier 1986 relative à la protection et à la mise en valeur du littoral comporte moins de trente articles dont deux concernent l’urbanisme littoral[5]. Ces deux articles sont, illustrés par une jurisprudence abondante, d’une grande clarté, et permettent incontestablement la préservation des milieux littoraux présentant le plus grand intérêt écologique. Second exemple, la loi du 3 janvier 1991 sur la circulation motorisée dans les espaces naturels. Quatre articles seulement, qui interdisent – avec quelques exceptions –, ou encadrent des activités et comportements clairement identifiés, relatifs à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels, ou la circulation des motoneiges.
Vingt ans plus tard, c’est la loghorrée législative. La loi Grenelle 1 relève plus du discours politique que d’un texte normatif : « La présente loi, avec la volonté et l’ambition de répondre au constat partagé et préoccupant d’une urgence écologique, fixe les objectifs, et à ce titre, définit le cadre d’action, organise la gouvernance à long terme et énonce les instruments de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique et s’y adapter, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés… ». Ceci n’est pas un extrait de l’exposé des motifs, mais seulement le début du 1er alinéa de l’article 1er de la loi du 3 août 2009. L’article 2 commence ainsi « La lutte contre le changement climatique est placée au premier rang des priorités. Dans cette perspective, est confirmé l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050… ». Une déclaration d’intention, et une indication purement confirmative d’engagements internationaux.
Certes, comme la loi l’annonce, elle fixe des objectifs, mais qui restent incantatoires, tant l’absence de dispositions juridiques et financières utiles pour les atteindre est criante. Ainsi, l’article 11 de la loi Grenelle 1 énonce que « le programme d’action permettra d’atteindre une croissance de 25% de la part modale du fret non routier et non aérien d’ici à 2012 ». La part modale du fret ferroviaire était de 14% en 2009, elle atteint non pas 17,5% quatre ans plus tard, mais…9%[6] !
La loi portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2, censée mettre en œuvre juridiquement les objectifs de la loi Grenelle 1, présente un niveau normatif à peine plus élevé. Le texte comporte, lui aussi, des énoncés, pétitions de principe, ou encore des réécritures de dispositions existantes, des renumérotations, notamment au sein du code de l’urbanisme qui souffre pourtant d’instabilité chronique. Ce texte bat tous les records : 257 articles, 124 pages de journal officiel, 190 décrets à intervenir. Une agitation invraisemblable au regard des maigres évolutions du droit de l’environnement. Au mieux, certaines dispositions se contentent de transposer des directives européennes qui auraient dû l’être parfois depuis des années.
En matière de lutte contre le réchauffement climatique, c’est l’inconsistance absolue. En dehors de la détermination d’objectifs, sans précision de moyens normatifs pour les atteindre, on relèvera d’abord des leurres législatifs, comme la définition de l’autopartage à l’article 54 – au demeurant erronée car confondue avec la voiture en libre service – sans aucune conséquence juridique. Et pour évoquer des choses plus sérieuses, est introduit à l’article 65 le « péage urbain » pour les véhicules motorisés dans les agglomérations de plus de 300 000h, dans des conditions tellement restrictives qu’il n’a aucune chance d’être mis en œuvre. La seule mesure forte en la matière, la taxe kilométrique poids-lourds, qui a fait la preuve de son efficacité en Allemagne, et surtout en Suisse, ne verra jamais le jour comme on le sait.
Quatre ans plus tard est lancée à grands renforts de communication le projet de loi relatif à la transition énergétique, laquelle reste dans une logique de bavardage législatif. Des objectifs sont énoncés (ou tout simplement rappelés et repris du texte précité), sans aucun moyen normatif pour les atteindre. Tous les amendements normatifs (ex : limitation de la durée de vie d’un réacteur nucléaire) sont systématiquement rejetés.
En matière de biodiversité, ce ne sont pas moins de 88 articles que contient la loi du 12 juillet 2010, dont 78 articles consacrés…à l’agriculture. Pour une illustration hélas banale, l’article 96 de la loi modifie l’article L. 256-2 du code rural relatif aux contrôles des matériels d’application des produits phytosanitaires. L’objet de ces contrôles n’est plus de vérifier « leur bon état de fonctionnement » mais « qu’ils fonctionnent correctement ». On s’interroge sur le lien entre ce bavardage législatif et la lutte contre l’effondrement de la biodiversité.
Le droit de la protection du littoral offre une illustration parfaite de l’apparition d’un droit bavard. La loi précitée du 3 janvier 1986, intégrée pour partie au code de l’urbanisme, comporte un nombre limité de prescriptions claires et précises. Le législateur du Grenelle environnement a pourtant jugé utile de doubler ce droit de police d’un droit bavard sur la gestion intégrée des zones côtières (Gizc), c’est à dire sur le droit du littoral. L’article 35 de la loi Grenelle 1 énonce ainsi que « une vision stratégique globale, fondée sur une gestion intégrée et concertée de la mer et du littoral, sera élaborée en prenant en compte l’ensemble des activités humaines concernées, la préservation du milieu marin et la valorisation et la protection de la mer et de ses ressources dans une perspective de développement durable ». Une déclaration d’intention de nature politique qui n’a pas sa place dans un texte de nature législative. En application de ce vœu, l’article 166 de la loi Grenelle 2 (plus de 3 pages de J.O.) a créé dans le code de l’environnement un nouveau chapitre curieusement intitulé « Politiques pour les milieux marins » insérant dix articles nouveaux dans le code de l’environnement dont aucun ne fixe de prescriptions opérantes. Ainsi l’article L. 219-9 énonce-t-il que « l’autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin ».
Relevons encore l’exemple-type de la disposition législative inutile : le relèvement des sanctions en matière de destruction d’espèce protégée : un an de prison et 15 000€ d’amende. Aucune peine de prison n’est jamais prononcée en la matière, et le maximum est loin d’être atteint par les rares décisions judiciaires intervenant dans ce domaine. La priorité n’est donc pas d’augmenter de façon illusoire le maximum, mais bien d’aboutir à ce que l’institution fonctionne, c’est à dire à ce que des contrôles soient effectués, des enquêtes menées et des poursuites engagées. On en est très loin.
En matière de protection de la nature, quatre ans plus tard, intervient là encore une nouvelle étape avec le projet de loi sur la biodiversité. La mesure principale, le regroupement d’établissements publics existants en une « nouvelle » agence de la biodiversité, n’apporte rien au fond du droit de la protection de la nature. Pour le reste, le projet procède à la rénovation du vocabulaire, à d’inutiles aggravations de sanctions pénales, à la création ou modification d’outils inutilisés tel que l’aménagement foncier environnemental.
B. Un droit toujours plus complexe
Dans une société complexe, qui manie des technologies élaborées et potentiellement dangereuses, le droit ne peut qu’être complexe. Toute complexité n’est pour autant pas indispensable et devient regrettable quand il ne s’agit plus d’adapter une réglementation à une situation délicate, mais de créer des édifices juridiques alambiqués pour régir des situations relativement simples.
Des complexifications évitables apparaissent notamment avec l’élaboration de législations successives qui créent des dispositifs différenciés de même nature alors qu’une unité aurait pu être trouvée. Tel est ainsi le cas des évaluations environnementales. A partir de 1976, est créée une grande et unique catégorie d’évaluation environnementale, l’étude d’impact sur l’environnement. Un système tellement clair et simple que l’on peut ici l’exposer à grands traits en très peu de lignes. Toute opération d’aménagement dont le coût excède un seuil financier (initialement 6 millions de F., aujourd’hui 1,9 M€) est présumé avoir un impact significatif sur l’environnement (biodiversité, air, climat…) et doit être, préalablement à sa réalisation, soumis, en application du principe de prévention, à une étude d’impact. Pour affiner quelque peu ce principe, le décret liste des catégories d’opérations qui sont dispensées de ladite étude d’impacts en raison de la faiblesse présumée de ces impacts environnementaux. Il comporte enfin, au contraire, une liste d’opérations qui sont soumises à étude d’impacts quand bien même leur coût serait inférieur au seuil financier.
Puis, en 1985 est créée l’évaluation environnementale propre aux unités touristiques nouvelles, en 1992 le document d’incidence sur le milieu aquatique, en 1993, le volet paysager du permis de construire, etc… Autant de bases juridiques, de contenus et de procédures différents[7], alors qu’il était tout à fait concevable d’en rester à l’étude d’impact unique, dès lors que s’applique un principe de proportionnalité (plus l’opération est importante, plus l’évaluation doit être poussée) et même de spécialité (plus certaines composantes de l’environnement sont affectées – montagne ; milieu aquatique ; paysage…– plus les effets sur ceux-ci doivent être précisément analysés.
La transposition du droit de l’Union européenne est également souvent l’occasion d’inutiles complexifications. Reprenons le même exemple des évaluations environnementales. Pourquoi déterminer des contenus distincts de celui de la traditionnelle étude d’impact aux évaluations environnementales des plans et programmes[8] ? Pourquoi, pire encore, exiger un contenu différent selon que le plan ou programme relève du code de l’environnement ou du code de l’urbanisme[9] ? On observera au passage que, s’agissant des Plu, trois régimes d’évaluation environnementale différents leur sont imposés selon les cas : Plu « ordinaire » (R. 123-2 du Code de l’urbanisme), Plu « susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement » (évaluation, le cas échéant, après examen de l’autorité administrative) et Plu littoraux (notamment) toujours soumis à évaluation dont le contenu est déterminé à l’article R. 123-2-1 du Code de l’urbanisme.
Il est regrettable que la France n’ait pas utilisé la marge de manœuvre qui était la sienne et qui lui aurait permis d’harmoniser le contenu de ces évaluations. Transposer telle quelle la distinction entre opérations qui sont soumises dans tous les cas à évaluation, et celles qui ne sont soumises qu’au cas par cas[10], constitue là encore une complexification inutile qu’il était possible d’éviter. Plus simplement, il était possible d’exiger dans tous les cas une étude d’impact sur l’environnement, en adaptant les exigences de contenu, sur le fondement du principe de proportionnalité.
Le dispositif le plus ingénieux en termes de complexité est, sans conteste, l’évaluation à géométrie variable, transposée de la directive Habitats naturels du 21 mai 1992. Il s’applique à 28 vastes catégories d’opérations[11] dont les Plu et les opérations soumises à étude d’impact, obligeant ainsi à une combinaison de deux (au moins) catégories d’évaluations environnementales. Ces opérations doivent faire l’objet d’un « exposé sommaire des raisons pour lesquelles l’opération est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ». Si tel est le cas, le contenu de l’étude doit être renforcé, et ainsi de suite pour aboutir à 4 niveaux différents d’exigence de contenu de ladite évaluation. Ce dispositif n’est d’ailleurs guère sérieux puisqu’il aboutit à confier au maître d’ouvrage le soin de déterminer lui-même le niveau d’exigence de l’étude qui lui est demandée, au risque, s’il est scrupuleux, de mettre l’Administration en situation de compétence liée[12] pour lui refuser l’autorisation sollicitée !
Une inutile complexification se retrouve en matière de législation sur la gestion intégrée des zones côtières déjà évoquée pour son côté bavard. La loi littoral brève, claire et normative, sera doublée par les lois Grenelle de dispositions relatives à la « Gestion intégrée de la mer et du littoral » (codifiées aux articles L. 219-1 et s. C. env.), dispositions qui instituent divers documents et schémas dont la procédure d’élaboration est particulièrement lourde, et qui apportent plus de confusion que de clarifications en la matière[13].
La complexification inutile peut également apparaître sous couvert d’innovation. Tel est le cas en matière de prétendue « nouvelle gouvernance » de l’environnement instituée par le Grenelle environnement. La grande ambition initialement affichée aboutit finalement à une micro-réforme concernant le seul régime des associations agréées. Il eût été suffisant de réformer à la marge le régime de l’agrément pour déterminer un nombre plus restreint d’interlocuteurs associatifs privilégiés des pouvoirs publics, sur la base de critères objectifs. Mais le législateur[14] a décidé de créer un nouveau régime, celui des associations représentatives, aux côtés du régime existant des associations agréées. Ceci pour permettre, aux premières seulement, d’être nommées dans les instances consultatives et décisionnelles de l’Etat et de ses Etablissements publics. Ce qui ne résout aucune des difficultés posées aux associations dans ce cadre[15].
Le type de complexification le plus paradoxal est celui qui intervient masqué sous une vertueuse ambition de simplification. Le cas le plus frappant de ce mécanisme est celui de la création d’une troisième classe d’installation classée, celui de l’enregistrement, qui vise non pas à simplifier la police des installations classées, mais à alléger les exigences pesant sur les exploitants, autrement dit, qui constitue une régression du droit de l’environnement.
II. Un droit qui régresse
Le principe de « non régression »[16] du droit de l’environnement que certains auteurs appellent de leurs vœux, est loin de se concrétiser. Tout au contraire, dans le sillage du « l’environnement, ça commence à bien faire », lancé par le président Sarkozy, les régressions du droit protecteur de l’environnement se multiplient depuis quelques années.
A. Un droit toujours plus souple
L’environnement semble être l’une des principales « terre d’élection du droit souple »[17], qui remet en cause la finalité protectrice du droit de l’environnement. Ceci peut-être illustré par la protection contractuelle des espaces naturels comme par l’essor d’une planification molle.
i. Le développement des protections contractuelles
Le développement des protections contractuelles traduit un ramollissement du droit de la protection de la nature, qui n’est plus fondé, dans certains cas, comme celui des sites Natura 2000, que sur une protection facultative. Les protections contractuelles, qui présentent au demeurant un certain coût pour les finances publiques, ne permettent d’atteindre, partiellement, l’objectif de conservation, que si suffisamment de propriétaires ou exploitants se portent volontaires pour conclure des contrats et…exécutent pleinement les obligations qui en découlent. Que le propriétaire ou l’exploitant juge la contrainte trop forte, la contrepartie proposée trop faible, ou qu’il ne souhaite pas modifier ses pratiques, et la protection n’est pas mise en œuvre. Et lorsqu’elle l’est, la protection est toujours provisoire, les contrats sont conclus pour cinq ans et, en cas de vente, le nouveau propriétaire n’est pas lié par les engagements pris par le vendeur.
Une fois conclu, le contrat doit être effectivement mis en œuvre, ce qui implique des contrôles, car il serait particulièrement confortable, pour le co-contractant, de bénéficier de la contrepartie financière sans pour autant modifier ses pratiques. Or, l’Administration n’est pas en position de force pour procéder à ces contrôles. Les contrôles inopinés sont exclus (R. 414-15 C. env.) et les sanctions possibles consistent en la suspension des aides ou au plus en la résiliation du contrat. Le prononcé de sanction revient donc à prendre acte de l’absence ou de l’insuffisante protection, voire à renoncer à la protection contractuelle, ce qui est l’inverse du but recherché par l’Etat.
Dès 1999, la Cour de justice des communautés européennes a condamné la France en manquement[18], pour n’envisager la protection des zones de protection spéciale pour les oiseaux que par la voie d’engagements contractuels « en raison de leur caractère volontaire et purement incitatif à l’égard des agriculteurs ». Ce à quoi il faut ajouter que l’on ne voit pas bien comment les activités des tiers, non propriétaires ni exploitants, pourraient être encadrées par la voie contractuelle. Que l’on pense aux activités sportives et de loisir comme la chasse, les sports motorisés (Ulm, quads, motos, 4×4…) ou non (canoë-kayak, pêche à pied…).
Les corridors écologiques identifiés dans les trames vertes et bleues ne sont pas, on l’a vu, protégés par des mesures de police telles que celles applicables aux réserves naturelles, sites classés, etc… L’article L. 371-3 d) du code de l’environnement énonce que le Srce comprend « les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d’assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques », mais les dispositions réglementaires ne font plus aucune mention de ces mesures de protection contractuelle dont on ignore donc si elles verront effectivement le jour.
En ce qui concerne la protection des milieux aquatiques, il convient de mentionner les échecs successifs des plans « Bretagne eau pure », lancés à partir de 1990, qui ont certes permis de contribuer à subventionner l’élevage breton hors-sol, mais en aucun cas à améliorer la qualité de l’eau[19].
ii. Le développement de pseudo-planifications
L’assouplissement du droit de l’environnement s’observe également en ce qui concerne les outils de « planification ». Là encore, des outils relativement efficaces ont pu être créés dans les années 1990 avec notamment les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage), grâce à des exigences de conformité et de compatibilité (L. 212-1-XI C. env.). Cette exigence de compatibilité est contrôlée de façon rigoureuse par le juge administratif comme en témoigne l’abondante jurisprudence annulant des autorisations au titre de la police de l’eau pour incompatibilité avec un Sdage. Mais encore, le Sdage, schéma protecteur, s’impose à d’autres schémas y compris aménageurs, comme le schéma départemental des carrières (L. 515-3 dernier al. C. env.) par le même lien de compatibilité.
Vingt ans plus tard, le législateur n’a pas renoncé à créer de nouveaux outils, il a seulement renoncé à les doter d’une portée normative susceptible de leur faire produire des effets protecteurs. Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, créés en 2010, sur les cendres des plans régionaux pour la qualité de l’air n’ont d’autre ambition que d’afficher des objectifs généreux sans moyen juridique pour y parvenir[20]. Ce schéma comporte de nombreux inventaires et orientations. Les dispositions législatives et réglementaires sur la procédure d’élaboration et d’approbation sont particulièrement détaillées. Mais aucune disposition n’attribue d’effets juridiques à un tel schéma, aucune obligation de conformité, de compatibilité ni même de prise en compte n’est évoquée, par exemple à l’égard des décisions administratives relatives aux infrastructures routières ou relevant de la police des installations classées. Seule une obligation de compatibilité est énoncée, concernant les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux (L. 229-26 C. env.) qui doivent être élaborés par les régions, départements et groupements de communes de plus de 50 000h et les plans de protection de l’atmosphère (agglomérations de plus de 250 000h). Ces derniers définissent eux aussi des objectifs, mais ne produisent que marginalement des effets juridiques (Ppa) ou pas du tout (Pcet).
La trame verte et bleue et ses schémas régionaux de cohérence écologique constituent là encore des instruments nouveaux créés et médiatisés par le Grenelle environnement, qui relèvent d’une illusoire planification, avec une simple obligation de « prise en compte » par les documents d’urbanisme. L’inventaire Znieff[21], pourtant sans aucune portée normative par lui-même, s’avère probablement tout aussi (peu) efficace dans le cadre d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation de classement des zonages du Plu.
B. Un droit toujours moins protecteur
La finalité même du droit de l’environnement semble être parfois oubliée par le législateur et le pouvoir réglementaire, sous l’influence de groupes d’intérêts décidés à alléger les contraintes pesant sur les acteurs économiques.
i. La lettre du droit de l’environnement
Il ne saurait être ici question de dresser une liste des régressions connues par le droit de l’environnement au cours de ces dernières années, au risque d’aboutir à un catalogue excessivement long et fastidieux. Une illustration de ce mouvement régressif sera donc opérée à travers des législations majeures destinées à combattre les deux composantes de la crise écologique que sont le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité.
L’allègement, et non la simplification, des polices de l’environnement est une tendance qui s’illustre parfaitement avec la police des installations classées, qui vise notamment à maîtriser les émissions de gaz à effet de serre par les secteurs industriels et agro-industriels. La création, par ordonnance du 11 juin 2009 d’un régime d’enregistrement, ou autorisation simplifiée, vient encombrer ladite police d’un régime hybride inhabituel dans lequel sont appelées à basculer 75% des rubriques relevant alors de l’autorisation. Le passage de l’autorisation à l’enregistrement constitue une impressionnante régression : suppression de l’étude d’impact sur l’environnement et de l’enquête publique, au profit d’une simple mise à disposition du public d’un dossier considérablement allégé. Les principes de prévention et de participation connaissent un recul sans précédent. Les seuils d’autorisation des élevages industriels porcins sont considérablement élevés[22], et ce n’est qu’un début[23].
A l’inverse, les éoliennes, qui permettent d’éviter l’émission d’importantes quantités de gaz à effet, voient leur régime fortement contraint par la loi Grenelle 2[24], qui prévoit leur inclusion, dès 50 m de hauteur, dans le régime des installations classées. Le décret du 23 août 2011[25] étend même ce régime aux éoliennes de plus de 12 m, soit des aérogénérateurs de taille très modeste. Cette soumission à un régime pensé pour les installations industrielles polluantes n’est pas juridiquement justifiée, l’art. L. 512-1 du Code de l’environnement limitant le régime de l’autorisation aux installations « qui présentent de graves dangers ou inconvénients » pour les intérêts environnementaux. Le principal inconvénient, et encore est-ce subjectif, des éoliennes, est de nature paysagère, mais cet inconvénient ne justifie pas, par exemple pour les lignes à haute tension ou les zones commerciales, une telle intégration dans la nomenclature des installations classées. En outre, la loi ajoute de nouvelles contraintes, à la justification incertaine, pour l’implantation des éoliennes. Ainsi de l’interdiction de toute implantation à moins de 500 m d’une habitation, ou dans les zones Au des Plu. Ou encore de la soumission à la constitution de garanties financières[26] pour la remise en état, jusque là réservée à un très petit nombre d’installations classées les plus polluantes !
Le secteur du transport routier, avec près de 30% des émissions nationales de CO² mérite également d’être abordé[27]. La taxe kilométrique poids-lourds fut l’une des principales mesures du Grenelle environnement[28], « première mesure fiscale d’importance pour la mobilité durable »[29]. Adoptée dans le cadre d’un large consensus politique, et même économique (y compris au sein du secteur du transport routier), cette taxe populaire sera abandonnée cinq ans plus tard avant même d’avoir été mise en œuvre. Une fois de plus, un gouvernement cédait devant des actions violentes et illégales portant atteinte – sans réaction des forces de l’ordre – à des ouvrages publics, pourtant limitées à quelques manifestations et attroupements dans une seule des 22 régions françaises. L’abandon de cette taxe coûtera – entre autres – près d’un milliard d’euros au contribuable pour l’indemnisation de la société Ecomouv.
Cette fiscalité écologique devait pourtant permettre non seulement de favoriser le report modal route-rail énoncé comme objectif essentiel du Grenelle, en offrant un signal-prix clair aux chargeurs, mais encore de dégager des financements pour les infrastructures de transport alternatives à la route. Sa disparition met directement en péril 1800km de lignes fret, menacées de fermetures[30]. Au contraire, le taux de Tva sur les transports publics passe de 7 à 10% au 1er janvier 2014[31].
Régressions et allègements se traduisent aussi par la multiplication des dérogations aux protections de police. S’agissant de la loi dite montagne du 9 janvier 1985, codifiée au Code de l’urbanisme, il suffit de constater qu’en 30 ans, les exceptions, dérogations et atténuations aux deux protections principales instituées par les articles L. 145-3 et L. 145-5 se sont multipliées, notamment en 1994, 1995, 2000, 2003, 2004, 2005… La loi littoral du 3 janvier 1986 résiste un peu mieux, mais on observe également une série d’exceptions aux protections instituées par les articles L. 146-4 et L. 146-6 du même Code, notamment en 1999, 2004, 2005… Et la pression de certains parlementaires élus locaux est forte comme en témoigne l’étonnant rapport du 21 janvier 2014 sur la loi littoral qui propose de décentraliser sa mise en œuvre[32].
La police de la nature est atteinte, de son côté, en 2006, avec l’institution, à l’art. L. 411-2-4°, de nombreux cas permettant de déroger à la protection des espèces et des habitats. En outre, la compétence est déconcentrée aux préfets[33] pour délivrer plus rapidement ces dérogations. Ces motifs de dérogation sont certes admis par la directive Habitats naturels, mais le droit français a omis d’intégrer l’exigence essentielle selon laquelle les dérogations ne sauraient être mises en œuvre que dans le cas des espèces en état de conservation favorable[34], même si cette notion n’est pas des plus précises. Jusqu’alors, seules des dérogations à des fins scientifiques pouvaient être accordées. Aujourd’hui, dès qu’un projet d’aménagement public ou privé rencontre des milieux d’espèces protégées, une dérogation est sans difficulté accordée par le préfet. De sorte que l’on s’interroge sur l’intérêt du régime de protection de la faune et de la flore auquel il peut être si simplement dérogé.
La maladie de la dérogation se retrouve également en matière de fiscalité de l’environnement. C’est bien la multiplication des dérogations à la soumission à la « taxe carbone » qui a conduit en 2009 le Conseil constitutionnel à annuler purement et simplement cette mesure fiscale pour rupture d’égalité[35].
Certes, la loi de finances pour 2014[36] institue une « contribution climat-énergie » à hauteur de 7€/tonne de carbone[37] qui se traduit par une augmentation symbolique de la Ticpe de 2c./litre pour les carburants routiers, qui ne peut avoir aucun effet sur les comportements et ne compense pas l’importante baisse des carburants routiers intervenue à la fin de l’année 2014. Alors qu’une augmentation jusqu’à 20€ la tonne était alors prévue, ce signal-prix à moyen terme a été très rapidement abandonné. La contribution climat-énergie est morte née et la remise en cause de la sous-taxation du gazole[38] est une fois de plus remise à plus tard. Parmi les nombreuses mesures fiscales en faveur de la route, il faut rappeler la diminution post-électorale de la fiscalité des carburants routiers en 2012, qui a coûté 300 M€ à l’Etat[39], suivi par l’allègement de la taxe à l’essieu (comme contrepartie de la Tkpl !).
Des éco-taxes plus modestes que la Tkpl ne manquent pas non plus d’être visées, comme la taxe sur les imprimés non sollicités, supprimée par la loi de finances pour 2013[40].
ii. La mise en œuvre du droit de l’environnement.
Non seulement le droit des espèces protégées a introduit en 2006 de vastes possibilités de déroger aux prescriptions protectrices posées par la loi, mais encore l’Administration fait une interprétation particulièrement extensive de ces dérogations. La notion de raison impérative d’intérêt public majeur, directement issue de l’article 6§4 de la directive Habitats naturels, n’est pas d’une grande précision, mais les doubles adjectifs « impératif » et « majeur » indiquent que le champ de cette dérogation est des plus étroits et qu’un seul « intérêt public » ordinaire ne saurait justifier une telle dérogation.
La Cjue a notamment jugé que la notion « d’intérêt public majeur (…) doit faire l’objet d’une interprétation stricte » ce qui implique « que soit démontrée l’absence de solutions alternatives (…) même si elles étaient susceptibles de présenter certaines difficultés »[41].
Il semble pourtant que l’Administration délivre très largement les dérogations sur ce motif qui en vient même à être dénaturé, comme le montrent les quelques décisions du juge administratif en la matière[42]. Ainsi le préfet du Var a-t-il délivré une telle dérogation pour l’aménagement d’une extension d’un centre d’enfouissement des déchets. Le Tribunal administratif de Toulon[43] fait parfaitement la distinction entre un simple intérêt public, qui lui paraît en l’espèce « indiscutable », et une raison impérative d’intérêt public majeur dont il écarte l’existence. Le Tribunal administratif de Dijon suspend une telle dérogation délivrée pour l’aménagement d’une zone d’activité en précisant que l’intérêt public majeur prévu par la loi se limite à « des cas exceptionnels dans lesquels la réalisation d’un projet se révèle indispensable et ou aucune autre solution d’implantation ne convient »[44].
De son côté, le préfet de la Manche, avait délivré une telle dérogation pour l’aménagement d’une portion de 2×2 voies dans un site Natura 2000. Cette dérogation a été annulée pour défaut de motivation, mais la position du rapporteur public sur le fond ne manque pas d’inquiéter : « il nous semble difficile de ne pas considérer le passage d’une 2×2 voies déclarée d’utilité publique comme étant au nombre des raisons impératives d’intérêt public majeur »[45]. De façon plus contestable encore, des dérogations ont été délivrées pour permettre l’extension de carrières[46], dont l’intérêt public paraît minime, notamment en matière d’impact sur l’emploi. Si ces installations classées bénéficient d’une autorisation préalable, elles ne sont revêtues ni du sceau de la déclaration d’utilité publique ni de celui de la déclaration d’intérêt général.
Afin de ne pas heurter les intérêts économiques, les contrôles administratifs environnementaux s’adoucissent. La baisse du nombre de fonctionnaires n’en est malheureusement pas la cause principale. L’inspection de l’environnement (ex-installations classées) ne procède d’ailleurs plus à des contrôles, mais à des « visites », dont le nombre diminue régulièrement depuis plusieurs années[47]. Dans le cadre de certaines législations, ces contrôles ne peuvent en aucun cas être inopinés, s’agissant par exemple de la vérification des engagements contractuels au sein de sites Natura 2000[48]. Une proposition de loi du 1er avril 2014, déposée par 60 députés[49], qui ne sera certes pas adoptée, mais traduit l’air du temps, tendait à interdire purement et simplement les contrôles inopinés en matière d’installations classées agricoles.
Pire, il arrive à l’Etat de contractualiser avec les exploitants pour encadrer les contrôles de police. La légalité de cette contractualisation en matière de police est au minimum douteuse. Ainsi, le préfet de la Vendée a conclu avec la Fdsea de ce département un « protocole de bonnes pratiques des contrôles terrain du secteur agricole par les services et opérateurs de l’Etat »[50]. Il est notamment question dans ce protocole de « limiter le nombre de contrôles », lequel précise que « les contrôles font l’objet d’une information préalable auprès de l’exploitant », auquel il est fait part « de l’objet du contrôle, de la date et de l’heure prévue »!
C’est également l’accès au juge qui a tendance à être limité, pour éviter de sanctionner les atteintes au droit de l’environnement. Les dispositions spéciales du contentieux de l’urbanisme (art. L. 600-1 et suivants) se sont multipliées pour tenter de faire échec à la saisine du juge administratif en matière de permis de construire et permis d’aménager[51]. Parmi celles-ci, beaucoup ont conduit à limiter l’accès au juge, notamment des associations de protection de l’environnement, ou adapter les pouvoirs du juge, afin de protéger de son intervention des décisions illégales, le tout sous couvert de sécurité juridique. Ainsi la loi du 13 juillet 2006 interdit les recours d’associations spécialement constituées pour s’opposer à un projet déterminé[52]. Dans les années qui ont suivi, l’arsenal anti-recours s’est considérablement renforcé : les art. L. 600-1-2 et L. 600-1-3 réduisent les possibilités de recours des riverains contre les autorisations d’urbanisme en déterminant de façon restrictive leur intérêt pour agir. Les art. L. 600-5 et L. 600-5-1 facilitent les régularisations d’autorisations d’urbanisme par le juge pour éviter les annulations pures et simples pourtant inhérentes aux canons du recours pour excès de pouvoir ; l’art. L. 600-7 autorise les conclusions reconventionnelles au bénéfice du titulaire de l’autorisation d’urbanisme.
Côté judiciaire, la répression de la délinquance écologique reste à un niveau très bas. Il n’existe pas de statistique fiable en la matière[53], notamment par ce que l’on sait que la plupart des infractions environnementales ne font l’objet d’aucun constat. Dans un rapport de 2003, la Cour des comptes a relevé « une défaillance à peu près totale de l’action répressive prévue par les textes à l’égard des pollueurs »[54]. Il est impossible d’évaluer le nombre d’infractions commises, mais entre 60 et 70 000 seraient recensées chaque année[55], 18 000 seulement constatées par PV d’infraction, dont 85% classés sans suite et environ 10% soit 1800 seulement donnant lieu à condamnation, le plus souvent avec des peines non dissuasives au regard des avantages économiques retirés par les délinquants. Le fait que 46% des infractions soient constatées par l’Oncfs, autrement dit la moitié en matière de police de la chasse, donne une idée de l’immensité des lacunes dans le domaine du contrôle judiciaire.
Rien n’est fait pour que les Parquets prennent enfin au sérieux la délinquance écologique et saisissent les tribunaux répressifs. Pas plus d’incitation pour que la délinquance écologique soit simplement constatée. De façon très surprenante, les Dreal ne constatent que 2% de la délinquance écologique. C’est dire que certains domaines ne font quasiment pas l’objet de contrôles judiciaires. Et encore la ministre de l’Ecologie donne-t-elle l’ordre aux agents de l’Oncfs de ne pas verbaliser les chasseurs qui chasseraient au delà de la date de fermeture de la chasse aux oies[56]. La transaction pénale est généralisée par l’art. L. 173-12 du Code de l’environnement réduisant là encore la saisine du juge répressif.
Dans ce contexte, les multiples interventions du législateur pour augmenter les sanctions pénales en matière de délinquance écologique ne constituent que de la poudre aux yeux. Ainsi le délit de destruction d’espèce protégée est punissable (article L. 415-3 C.env.), depuis la loi Grenelle II, de 15 000 euros d’amende et d’un an de prison, au lieu de 9 000 euros et six mois d’emprisonnement. On ne connaît aucune décision judiciaire en la matière qui ait prononcé une peine d’emprisonnement, même avec sursis.
Comme si cette situation était encore trop favorable à la répression et qu’il fallait désengorger les juridictions pénales, une ordonnance du 11 janvier 2012[57] vient généraliser à toutes les infractions environnementales la procédure de la transaction pénale. Dans le cadre de cette transaction pénale, les mesures de remise en état ne sont que facultatives.
[1] Le Monde, 25 septembre 2014, p. 6 ; communiqué de presse de l’Organisation météorologique mondiale (Onu) n° 980 du 6 novembre 2013 ; voire +4°C dès 2060 selon la banque mondiale Fnaut-infos n° 221 janvier 2014 p. 7.
[2] Communiqué de presse du Giec du 13 avril 2014.
[3] 10ème rapport biennal de l’Ong Wwf ; Le Figaro, 1er octobre 2014 p. 11.
[4] Voir notamment à ce sujet Romi R., « Recomposer ou décomposer le droit de l’environnement ? » in Dr. Env., n° 218 décembre 2013 p. 406.
[5] Codifiés aux articles L. 146-4 et L. 146-6 du Code de l’urbanisme.
[6] Constant O., « La part modale du fret ferroviaire passe sous la barre des 10% en France », 13 janvier 2015, Portail Transport et Logistique WKTL. Alors qu’en Allemagne, la part modale du fret ferroviaire est passée de 18,4 à 23,1% de 2003 à 2013.
[7] Y compris de procédure contentieuse : le défaut d’étude d’impact donne accès au référé suspension dit automatique (L. 122-2 C.env.) mais pas le défaut d’étude d’incidence sur les milieux aquatiques.
[8] Directive du 27 juin 2001.
[9] Respectivement déterminé par les art. R. 122-20 C.env. et R. 123-2-1 C.urb.
[10] Sur présentation d’un dossier succinct, et après analyse de l’autorité administrative, prenant alors une décision faisant grief, et donc susceptible de recours.
[11] Voir les 28 vastes rubriques mentionnées à l’art. R. 414-19 C. env.
[12] Article L. 414-4-VI C. env.
[13] Braud X., « La gestion intégrée des zones côtières et le droit de l’urbanisme littoral en France », Vertigo, Hors-série n° 18, décembre 2013. (Revue disponible sur Internet).
[14] Article 49 de la loi du 3 août 2009, article 249 de la loi du 12 juillet 2010, décret du 12 juillet 2011 suivi de quatre arrêtés ministériels !
[15] Braud X., « La réforme de l’agrément du 12 juillet 2011 : des objectifs louables, une occasion manquée ? », RJE, n° 1/2012 p. 63.
[16] Krolik Ch., « Vers un principe de non régression de la protection de l’environnement », AJDA, 18 novembre 2013, p. 2247.
[17] « L’environnement, terre d’élection du droit souple ? Entretien avec Jean-Marc Sauvé », Dr. Env., n° 217 novembre 2013, p. 366.
[18] CJCE, 25 novembre 1999, Comm. c/ France, Dr. env., n° 75 p. 6.
[19] http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/index.php?77/133.
[20] Huitelec R., « Grenelle de l’environnement et Srcae ou comment paver l’enfer de bonnes intentions », Dr. Env., n° 181 août 2010, p. 253.
[21] Inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, élaboré à partir de 1982 sous l’égide du ministère de l’environnement.
[22] Décret du 31 décembre 2013 qui élève de 450 à 2000 porcs le seuil de l’autorisation, voire à 4000 en cas de regroupement d’installations existantes.
[23] « Je suis d’accord pour travailler et discuter sur l’allègement des procédures Icpe comme cela a été fait en filière porcine » déclare Stéphane Le Foll au congrès de la fédération nationale bovine, in Ouest-France, 6 février 2014, page agriculture.
[24] Article 90 et suivants de la loi du 12 juillet 2010.
[25] Décret n° 2011-984 du 23 août 2011.
[26] R. 553-1 et s. du code de l’environnement introduits par le décret du 23 août 2011.
[27] D’autant que ces émissions croissent. Voir notamment « Les français polluent l’air à peine moins qu’il y a 30 ans », Les Echos, 26 avril 2013. Les émissions de gaz à effet de serre par l’automobile ont augmenté de près de 10% en 30 ans.
[28] Art. 11 de la loi Grenelle I et art.153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
[29] Martin S., « Les conséquences de la suspension de l’écotaxe », Revue de droit des transports, décembre 2013 p. 43.
[30] L’Echo du rail, n° 381 septembre 2014, p. 2.
[31] CGI, art. 278 et 278 bis issus de la loi de finances rectificative 2012.
[32] Sénat, rapport n° 297 de Mme Odette Herviaux et M. Jean Bizet.
[33] R. 411-6 du code de l’environnement issu d’un décret du 4 janvier 2007.
[34] Article 6§4, directive Habitats naturels et Cjce, 10 mai 2007, Comm. c/ Autriche, n° C508-04.
[35] Voir notamment Caudal S., La fiscalité de l’environnement ; Paris, Lgdj, coll. Systèmes ; 2014 ; p. 120.
[36] Article 265 s. du code des douanes introduit par la loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
[37] La commission Rocard préconisait en 2008 30€ la tonne dans un premier temps pour atteindre 100€ la tonne en 2030.
[38] 18 centimes par litre par rapport à l’essence, contre une moyenne de 11 centimes dans l’UE.
[39] Circulaire du 28 septembre 2012 NOR : BUDD1235621C BO Douanes n° 6949 du 28 septembre 2012 ; 3 centimes par litre durant 3 mois septembre, octobre et novembre 2012 avec sortie progressive du dispositif.
[40] Article 20 de la loi du 29 décembre 2012.
[41] Cjce, 26 octobre 2006, Com. c/ Portugal, Cons. n° 35, 37 et 38.
[42] TA Toulouse, 10 juillet 2014 et TA Rennes, 17 octobre 2014, Dr. Env. n°231 p. 63, voir aussi notes suivantes.
[43] TA Toulon, 26 août 2010, SNPN, AJDA, 28 mai 2011, p. 60. Conclusions M. Revert.
[44] TA Dijon, 27 février 2013, M. Antonio Meijas de Haro et autres, n° 1300303.
[45] TA Caen 9 avril 2010, Ass. Manche-Nature, n° 0902310. Conclusions M. Dorlencourt, p. 3
[46] Ex : autorisation du 4 octobre 2010 délivrée par le préfet de Saône-et-Loire à la société Granulats Bourgogne Auvergne ; arrêté du préfet de la Haute Garonne n° 2010-07 du 2 décembre 2010 dans le cadre de l’extension de la carrière de Martres-Tolosane du groupe Lafarge ciments.
[47] 27 000 visites de contrôle en matières d’installations classées en 2008, 24 000 en 2011.
[48] R. 414-15 C. env. exclut les contrôles inopinés.
[49] PPL n° 1851 du 1er avril 2014 visant à instaurer une information préalable des agriculteurs sur tous les contrôles.
[50] Protocole signé le 5 septembre 2014 par le préfet de la Vendée et le président de la Fdsea de la Vendée.
[51] Voir notamment Billet Ph., « La neutralisation du contentieux de l’urbanisme », Jcp-A, 13 janvier 2014 p. 52.
[52] Article 14 de la loi portant engagement national pour le logement, codifié à l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme.
[53] Réponse ministérielle de M. Manuel Valls, J.O. Sénat 22 novembre 2013, p. 11773.
[54] Rapport, Cour des comptes mai 2003, p. 625 : http://www.cpepesc.org/POLICE-DE-L-EAU-Action-repressive.html.
[55] « Les infractions au droit de l’environnement constatées en 2012 par la gendarmerie nationale, l’Oncfs et l’Onema », Rapport 2013 disponible sur Internet.
[56] Lettre de Ségolène Royal du 28 janvier 2015 adressée au directeur général de l’Oncfs « vous donnerez des instructions aux services départementaux (…) la verbalisation prendra effet à compter du lundi 9 février ».
[57] Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 codifiée notamment à l’article L. 173-12 du code de l’environnement et précisé par décret n° 2014-368 du 24 mars 2014 codifié aux articles R. 173-1 et s. du même code.
À propos de l’auteur