Dernière sortie 2025 des éditions l’Épitoge :
Présentation par :
Mathieu Touzeil-Divina & Clément Benelbaz
Enseignants-chercheurs en droit public,
membres du Conseil d’Administration du Collectif L’Unité du Droit
Au nom de l’objectivité scientifique recherchée, tout questionner en universitaires. La question n’a pas été que théorique ou symbolique. Elle s’est imposée à nous lorsque nous avons, au Collectif L’Unité du Droit, imaginé, en 2018, d’entreprendre un quadriptyque d’étude(s) sur des hommes et des femmes politiques dans leurs rapports et leurs expressions au(x) droit(s).
Devions-nous n’aborder « que » des personnalités avec lesquelles nous étions familiers ou, à défaut, en accointance politique a priori ? N’avions-nous pas, concrètement, envie de n’étudier « que » des figures républicaines de renom pour les célébrer ; le Collectif L’Unité du Droit, notamment, ayant affiché dans ses statuts son attachement aux valeurs républicaines ?
Rapidement, la réponse à ce questionnement fut négative.
De Jaurès à Michel. Ainsi, si questionner Jean Jaurès (1859-1914) & le(s) droit(s) s’est comme « imposé » à nous en 2019 parce qu’il s’agissait de célébrer l’anniversaire de sa naissance et ce, tout particulièrement à Toulouse où, depuis 2015, notre association et ses éditions se sont installées, cette célébration n’a pas été – loin s’en faut – un panégyrique, une ode à la République et au républicain socialiste ne mettant en avant que ses plus célèbres et célébrés combats.
C’est au contraire, en universitaires et en scientifiques, – tendant à – et recherchant l’objectivité que nous avons construit notre programme et les contributions qui en ont été publiées[1]. Et dans cet ouvrage nul n’a masqué ou tu ses critiques et ses commentaires même lorsqu’ils venaient écorner la figure du « héros national », bien au contraire.
Ce sont ses paradoxes idéologiques, ses rapports parfois conflictuels au Droit et à sa défense, ses ambiguïtés en matière de Laïcité, notamment, que nous avons voulu analyser et non – précisément – célébrer.
Les études du cycle ainsi imaginé ne sont pas et n’ont pas vocation à être des glorifications ou des louanges pas plus qu’elles ne doivent être des condamnations ad hominem.
En ce sens, lorsque nous avons entrepris, entre 2020 et 2023, une étude collective consacrée à Louise Michel (1830-1905) & le(s) droit(s), n’avons-nous pas été attendri par cette figure tutélaire du roman communard la décrivant comme une icône qui l’a qualifiée et sanctuarisée de « vierge rouge ». Bien au contraire, l’ouvrage qui en est issu[2] ne dissimule et ne minore aucune critique. Il a même donné lieu, chez certains auteurs et certaines autrices, à des découvertes d’écrits et de prises de positions juridiques de la part de Louise Michel qui ont considérablement entaché le « mythe » qui s’était construit autour d’elle par toute une génération d’hommes et de femmes de gauche.
En ce sens, ses positionnements (et singulièrement son absence de prise à partie) sur la colonisation algérienne ou encore en matière de religions nous ont singulièrement étonné et l’ouvrage n’a pas manqué d’aborder et de critiquer ces éléments.
Maurras & le soufre. Il n’y avait donc a priori aucune raison, en juristes, en universitaires, en scientifiques mus par la recherche de l’objectivité et malgré nos a priori humains (et souvent politiques ou dits de valeurs), de questionner une personnalité aussi complexe mais aussi sulfureuse que Charles Maurras (1869-1952).
Pourtant, nous le savons et l’assumons, aborder et mentionner Maurras dans la sphère publique en 2024, même avec cet argumentaire scientifique et ces précautions universitaires, questionne et questionnera.
D’aucuns y verrons une célébration et d’autres une condamnation sinon une seconde mise à mort alors qu’il ne s’agit ni de l’un ni de l’autre de ces objectifs subjectifs.
Notre démarche est ainsi en opposition frontale à celle du colloque « Un autre [sic] Maurras » organisé en juin 2023 par l’association des amis de la Bastide des chemins de paradis et la Nouvelle Revue Universelle, avec le soutien non dissimulé (et au moins non hypocrite) des amis et des promoteurs de L’Action française. Pour les contributeurs à cette manifestation (dont notre collègue le professeur Frédéric Rouvillois[3]), il s’est manifestement agi de célébrer Maurras quoi qu’il ait fait, écrit ou dit. L’un des militants (et secrétaire général adjoint) de L’Action française, Francis Venciton, déclare même, lors de ce colloque[4], « on ne naît pas maurassien, on le devient »paraphrasant ainsi une autre célèbre phrase politique qui aurait fait bondir les féministes manifestement absents lors de ce symposium et pour cause : il ne s’est pas agi (même si des universitaires y participèrent) d’un colloque académique mais objectivement d’une action militante d’anniversaire en la mémoire et en la faveur maurassiennes. Gérard Leclerc[5], l’un des coorganisateurs de la célébration militante, assume même sans détours académiques mais avec une volonté idéologique maurassienne affirmée qu’intituler ainsi la rencontre « un autre Maurras » véhiculait un but simple : « dans mon « autre » Maurras » explique-t-il, « il n’est pas question de l’Affaire Dreyfus, il n’est pas question d’antisémitisme, il n’est pas question de Vichy »jusqu’à imaginer l’homme comme un « autre » gauchiste !
Tel ne fut pas notre objectif et imaginer Maurras sans mentionner Vichy et son poids et son influence moraux sur la période, sans aborder frontalement son antisémitisme viscéral nous semblent, précisément, non seulement grave mais dangereux.
Cela dit, le soufre qui entoure tant et encore Maurras en 2024 est tel que plusieurs contributeurs ont renoncé à participer au présent ouvrage par peur – nous ont-ils affirmé – d’y voir leur nom associé. Pourtant, étudier Maurras ce n’est pas l’encenser.
Maurras, auteur d’exception(s). Certes, nombreux, au fil de ces pages, condamnent des propos (par ailleurs aujourd’hui pénalement illégaux) et s’opposent frontalement à un certain nombre de valeurs maurassiennes et de prises de positions. Toutefois, l’ouvrage n’entend pas condamner ou célébrer a priori Maurras dans ses rapports au(x) droit(s) : il s’y est agi de le questionner en juristes et en linguistes.
En outre, sans aller jusqu’à oser une phrase et un parallèle tels que l’engagement à séparer l’homme de l’œuvre, il faut – selon nous – objectivement reconnaître un certain nombre de qualités littéraires et créatrices à la personnalité ici étudiée.
La plume de Maurras, sa verve, son sens – dirait-on de façon contemporaine – de la punchline sont – objectivement – exceptionnels.
On ne s’ennuie jamais en le lisant (y compris, du reste, parce qu’au regard des idées politiques cette fois de nombre des auteurs du présent opus, Maurras irrite et révulse) et ses qualités d’écrivain ne peuvent être niées. En outre, sa connaissance des hommes politiques mais aussi de l’actualité juridique et normative qui lui était contemporaine ne peut qu’impressionner. Charles Maurras est un sachant, y compris en Droit et notamment en organisation administrative et politique territoriale comme en témoigne son étude sur la décentralisation[6]. Charles Maurras est un intellectuel français et Maurras a de véritables idées et même des propositions et des critiques s’agissant du Droit, des droits, et des institutions politiques, singulièrement quand elles sont, à ses yeux, trop républicaines et donc (selon lui) corrompues. Maurras est ainsi, pour le juriste, un auteur aux doctrines prolixes (et parfois paradoxales sinon contraires).
Maurras & le(s) droit(s). Cet ouvrage se veut donc académique, c’est pourquoi seuls des enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs y ont contribué, afin de lire et de comprendre la doctrine de Maurras sous le prisme du droit, mais aussi de la confronter à d’autres doctrines, et au Droit.
Corinne Bonafoux traite d’abord de l’« historiographie de L’Action française : un objet historique éclaté et controversé ? ».
Dans une première partie, il s’est agi d’étudier Maurras face au(x) droit(s) :
- Mathieu Touzeil-Divina présente « Maurras & le Parlement : un combat antiparlementaire au nom d’une Monarchie fantasmée » ;
- Fabrice Bin s’intéresse à « Maurras et l’impôt » ;
- Clément Benelbaz expose « Maurras & la laïcité dans le Dictionnaire politique et critique »;
Dans un second temps, est abordée la question de Maurras face aux doctrines :
- Julia Schmitz confronte « Maurras & Hauriou » ;
- Patrick Charlot, « Maurras & Péguy » ;
- Roman Bretel présente enfin « Un ami de Maurras aux origines du droit du patrimoine culturel : Maurice Barrès et La grande pitié des églises de France ».
Certes, ces contributions n’épuisent pas les questions que soulève Maurras, il y aura sans doute des oublis, peut-être des erreurs, mais tel est le propre des universitaires : aborder tous les auteurs, toutes les doctrines, tous les sujets, tous les styles, selon une approche critique, pluraliste, et interdisciplinaire.
Il s’agit d’un des objectifs du Collectif l’Unité du Droit, que nous avons essayé d’honorer.
[1] Touzeil-Divina Mathieu, Espagno-Abadie Delphine, Schmitz Julia & C.C. (dir.), Jean Jaurès & le(s) droit(s) ; Toulouse, L’Épitoge ; 2020 ; vol. IV de la coll. « Histoire(s) du Droit ».
[2] Touzeil-Divina Mathieu, Benelbaz Clément, Cerda-Guzman Carolina, Jaoul Mélanie & Koubi Geneviève (dir.), Louise Michel & le(s) droit(s) ; Toulouse, L’Épitoge ; 2023 ; vol. V de la coll. « Histoire(s) du Droit ».
[3] Qui déclara en début de sa contribution s’être « régalé » à la lecture d’écrits maurrassiens et anti-maurassiens (en l’occurrence à propos d’un roman dystopique) :
https://www.actionfrancaise.net/2024/08/24/colloque-un-autre-maurras-3/.
[4] Ibidem.
[5] Ibidem.
[6] Maurras Charles, L’idée de la décentralisation ; Paris, Librairie de la Revue encyclopédique ; 1898 et à son propos : Augustin Jean-Marie, « Le débat entre Charles Maurras et Joseph Paul-Boncour sur la décentralisation » in La controverse ; Paris, Slc ; 2020 ; p. 603 et s.
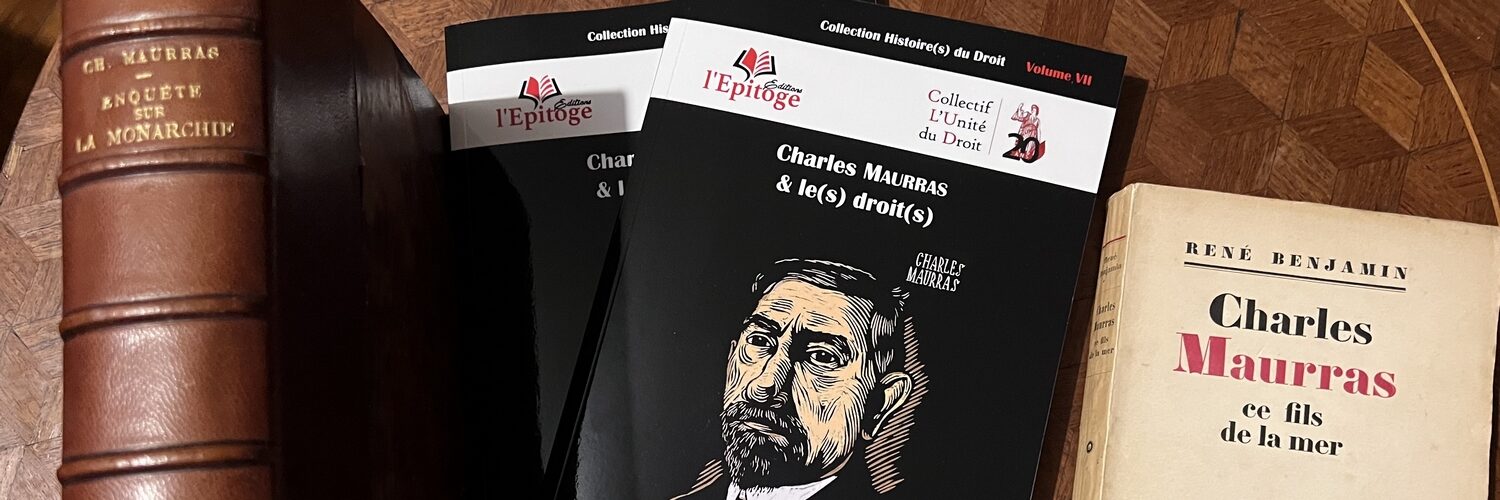
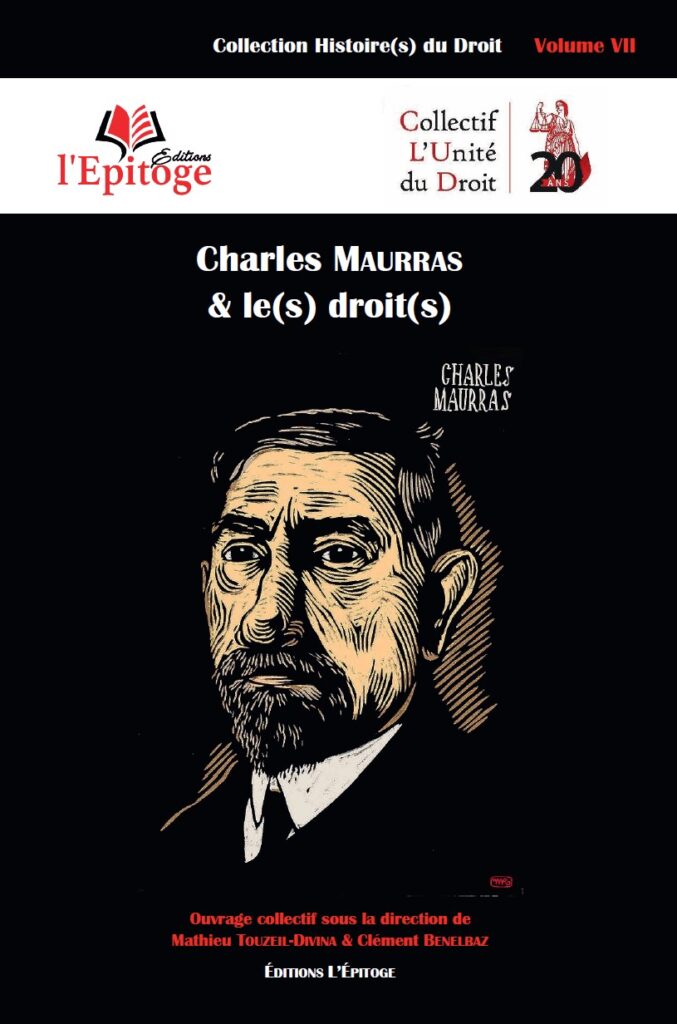


À propos de l’auteur